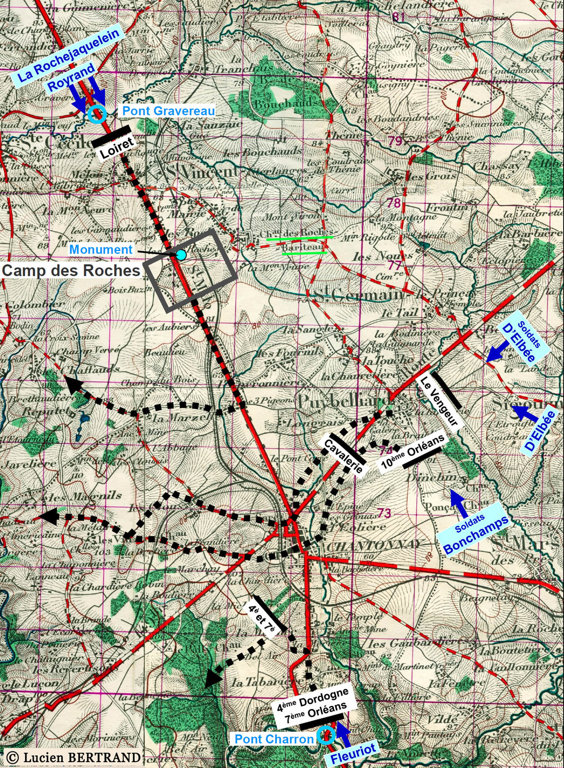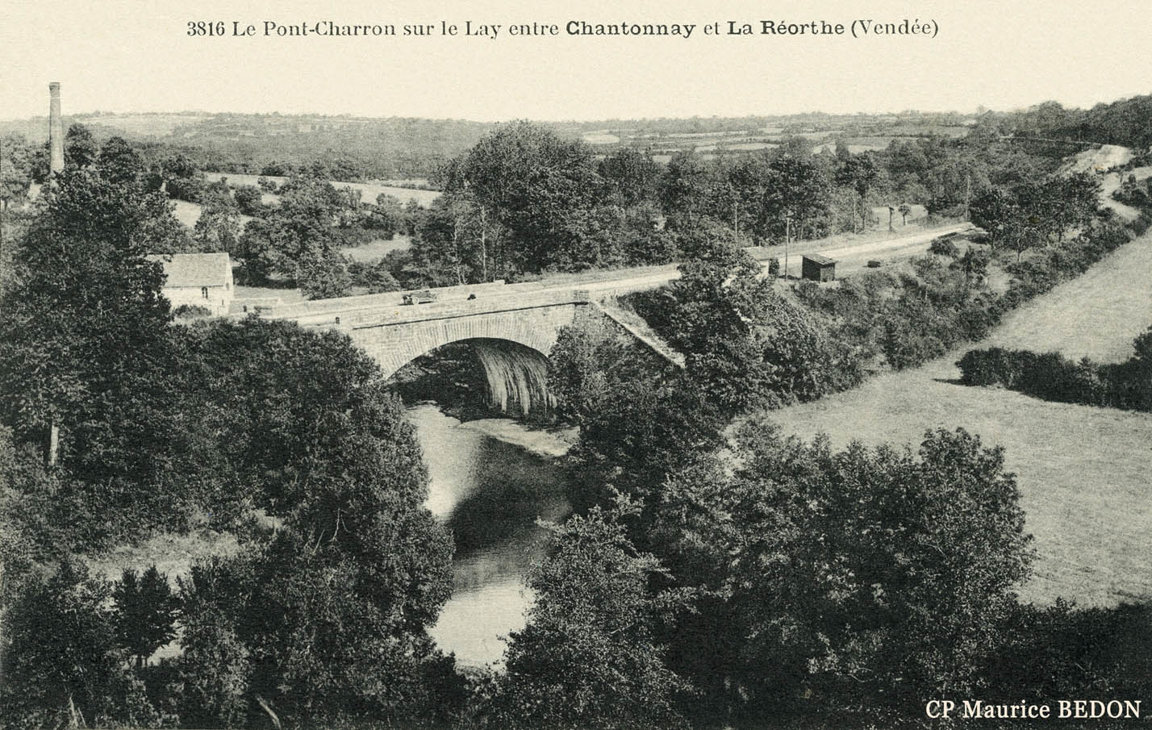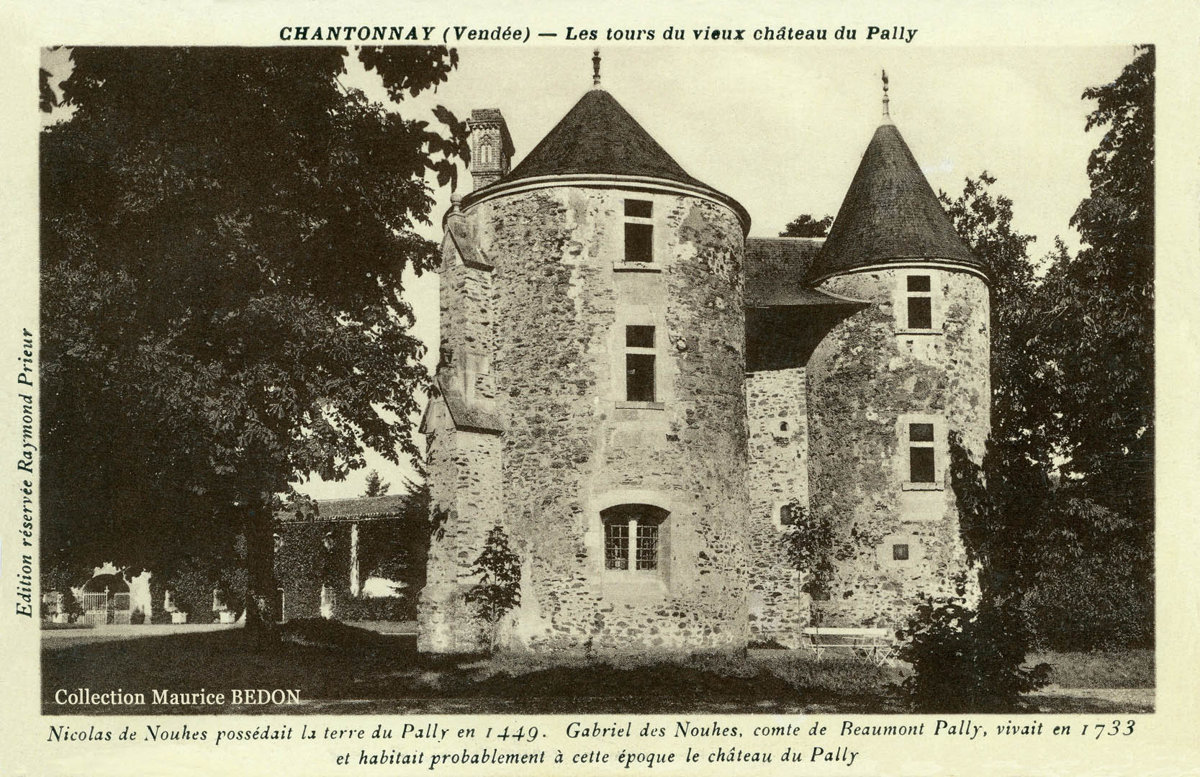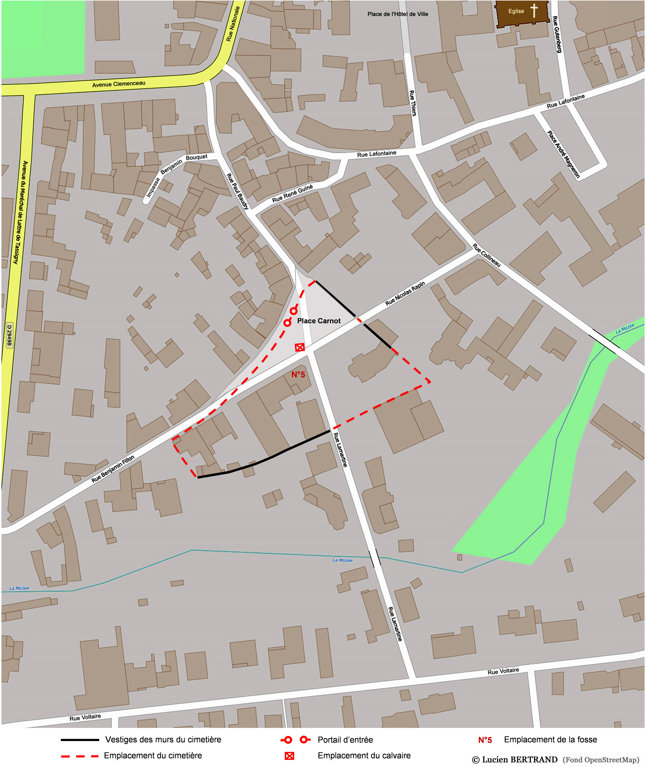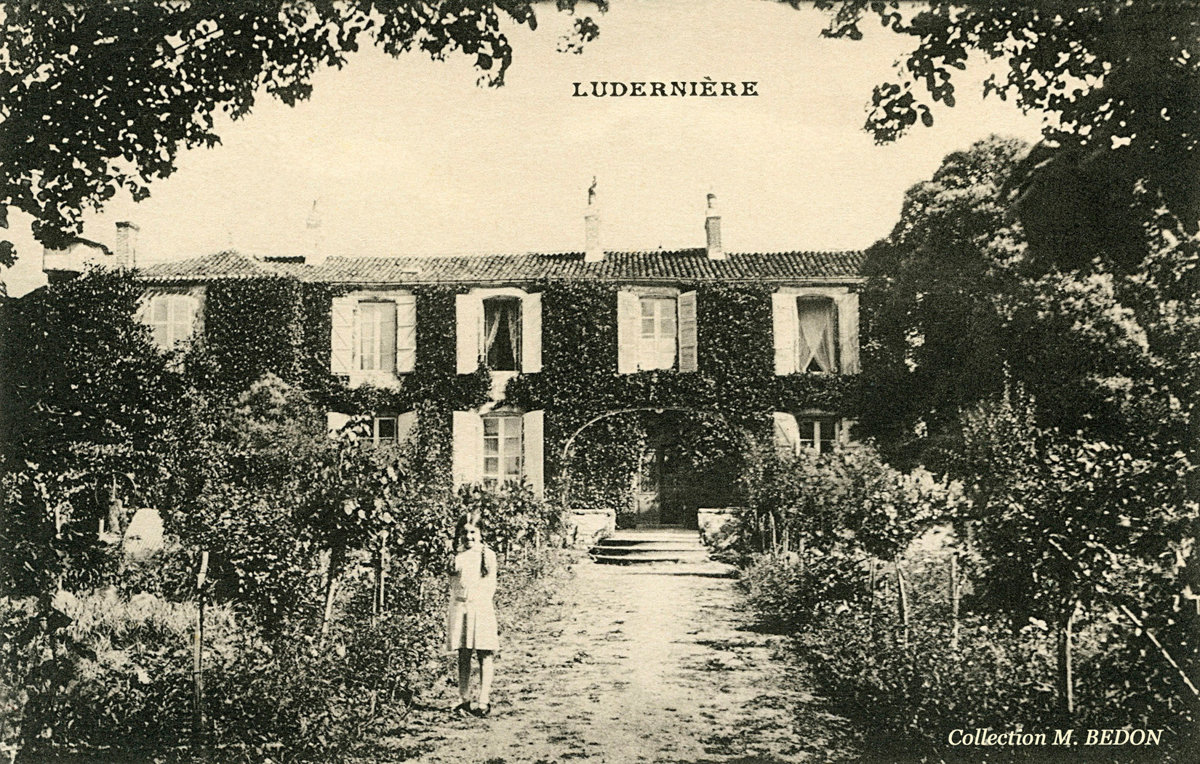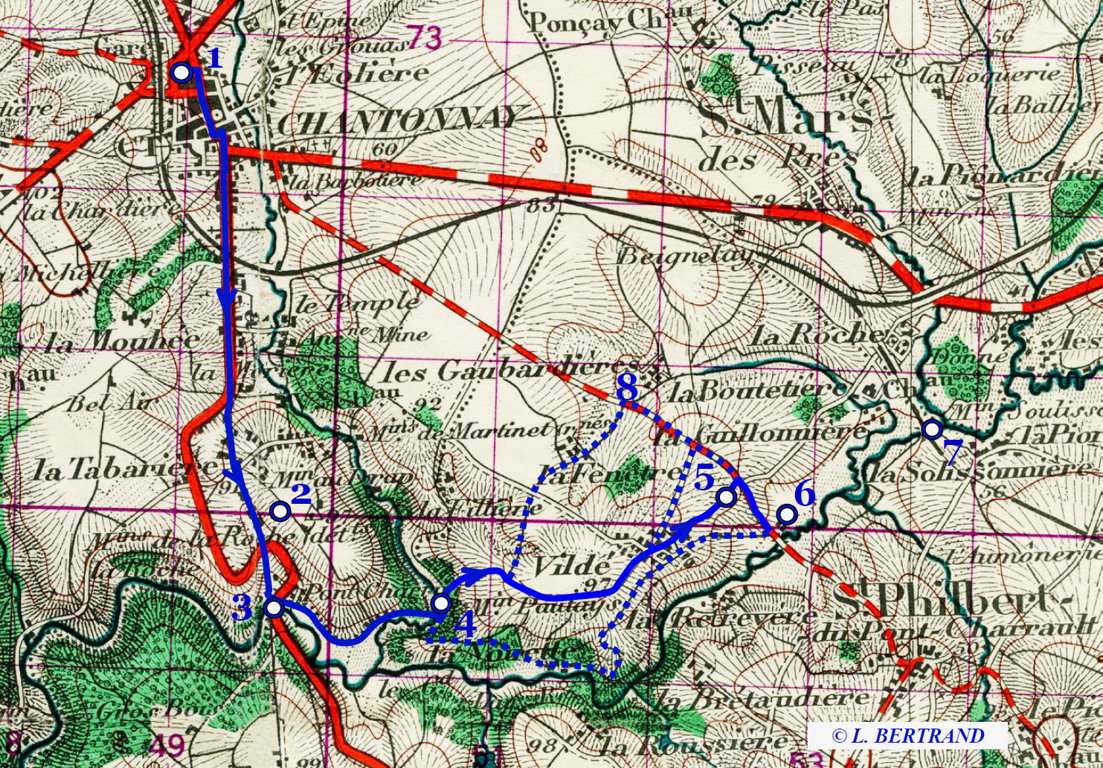LA CAPTURE DE CHARETTE (23 Mars
1796)
En ce début d’année 1796, après les combats et les redditions successives,
le chevalier François Athanase Charette de la Contrie n’a plus autour de lui
qu’une poignée de derniers fidèles et est constamment pourchassé par près de 30 000
soldats républicains. Le général Hoche avait d’ailleurs demandé au général
Grigny « Tâchez de prendre Charette,
ne lui laissez aucun repos. Employez les ruses…. ». Cerné de partout,
il se trouve dans un périmètre de plus en plus restreint aux alentours de
Rocheservière, contrée qui lui est favorable et où il a ainsi moins de chance
de se faire trahir.

1. Charette, tableau de J. Baptiste
Paulin-Guérin (1826) 2. Charette d’après un dessin du XIXème
Il a bien reçu une proposition de rencontre émanant du citoyen Guinel,
aide de camp du général Grigny, en vue d’une suspension d’armes. Le rendez-vous
est prévu à la cure de Mormaison le 21 mars 1796 à 9 heures du matin (1er
germinal de l’an IV). La proposition lui est parvenue par l’intermédiaire (en
toute innocence) d’Amiaud, l’ancien vicaire de cette paroisse. Flairant de loin
le guet-apens, il s’est bien gardé de s’y rendre mais se trouve néanmoins toujours
dans les parages. Le lendemain 22 mars, il se heurte à la colonne commandée par
l’adjudant-général Mermet près de Saint-Philbert-de-Bouaine. Réussissant à
s’échapper avec 45 hommes environ, il parcourt à pied à peu près quatre lieues (16 km) en direction des
Lucs-sur-Boulogne.
De cette manière, il se présente avec ses hommes en fin de journée chez
Jean Delhommeau à la métairie de la Pellerinière,
située au nord de la commune des Lucs. Il est trempé jusqu’aux os et harassé de
fatigue. Après s’être séché devant le feu, il s’endort sans savoir qu’il s’agit
là de sa dernière nuit d’homme libre. Le lendemain matin 23 mars 1796,
autrefois jour du Mercredi Saint, mais aujourd’hui 3 germinal de l’an IV de la
République, il déjeune d’un frugal repas d’œufs durs à 7 heures du matin quand
la sentinelle prévient de l’approche de Bleus. Ils arrivent, en effet, par le
village voisin des Gâts, les soldats du commandant Gauthier, qu’ils croyaient
avoir semé la veille. Il faut partir et très vite :
- « Allons, mes braves enfants, c’est
ici qu’il faut se battre jusqu’à la mort et vendre chèrement sa vie ».
Accompagné des soldats
qui lui restent, il se dirige vers le Nord-Est et va franchir la rivière la
Boulogne à la chaussée du moulin à eau de Gâtebourse.
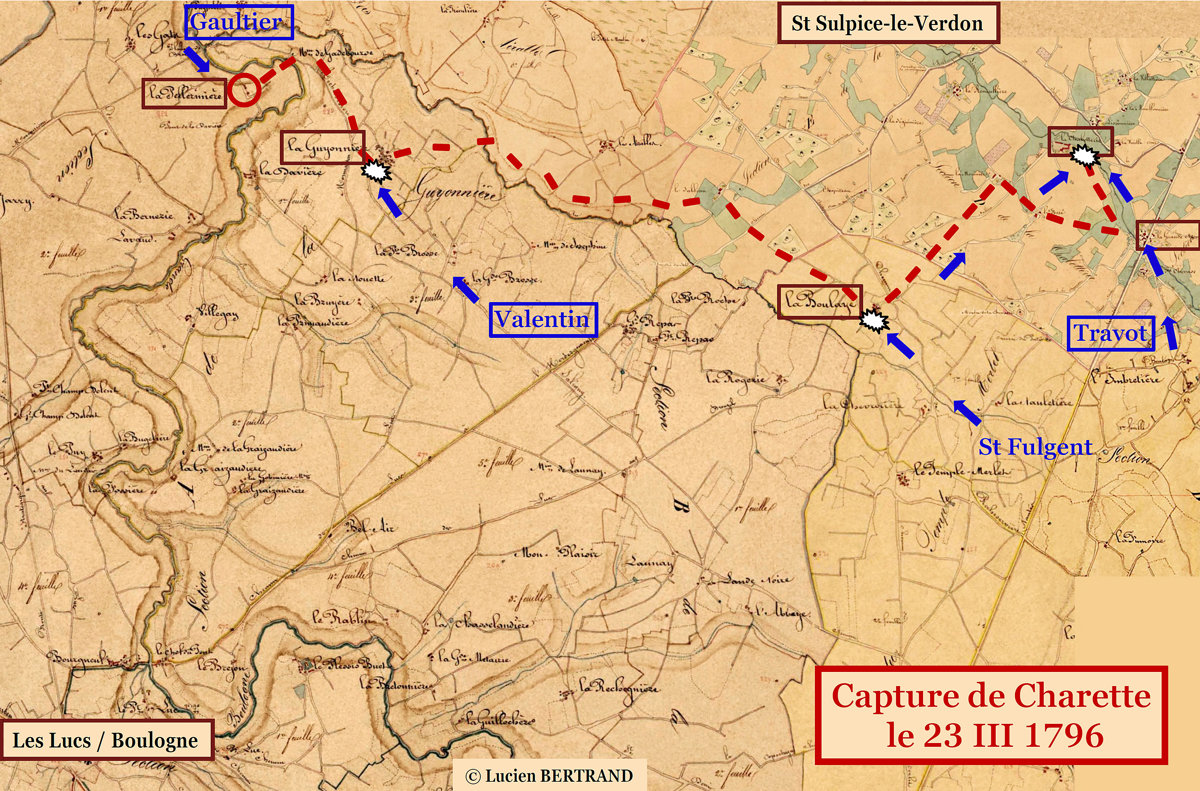
Le parcours de Charette avant sa capture.
Ensuite, à partir de cet endroit, il s’enfuit en sautant des « échaliers »
et en passant dans des chemins creux. Les Bleus semblent avoir disparu :
-« Allons, ils ne nous auront pas cette
fois encore ».
Il descend alors plus sereinement par le chemin se dirigeant vers La
Guyonnière. Mais, arrivé au bout du village, il se trouve nez à nez avec un
groupe d’autres soldats bleus. Il s’agit cette fois-ci de la demi-brigade des
Vosges commandée par l’adjudant général Valentin, forte d’une centaine d’hommes
et venant des Lucs-sur-Boulogne. Le combat est inévitable et il commence à
s’engager dans le village.
Charette est la véritable cible des tireurs, car il est reconnaissable
au panache blanc de son chapeau. Un des soldats de sa troupe, Pfeiffer, lui
demande alors son chapeau et sans attendre la réponse, il s’en empare et le met
sur sa propre tête. Ce geste héroïque lui coûte la vie. Il est tiré à vue,
abattu et les soldats s’acharnent déjà sur lui, certains de la victoire. Ils
doivent toutefois déchanter, ce n’est pas Charette. Tout en tirant sur leurs
adversaires, les Vendéens perdent certains des leurs, mais réussissent tout de
même à se dégager. Ils disparaissent dans la nature et partent en direction du
ruisseau de « la Rue ».
Après avoir franchi ce petit cours d’eau, l’objectif de Charette est de
se diriger vers l’Est pour atteindre la forêt de l’Essart dans la commune de
Saint-Denis-la-Chevasse qui pourrait constituer un abri sûr. Il emprunte des
chemins qui suivent plus ou moins le tracé de la rivière. Il arrive ainsi à la
ferme du Sableau avec deux des siens
et il y reste quelques instants pour se reposer. Cette halte est de courte
durée car Valentin et cinq grenadiers y arrivent déjà. Dans la précipitation de
son départ, Charette oublie ses deux pistolets sur la table. Et la course
reprend toujours en direction du bois des Essarts vers l’Est.
Ses soldats regroupés, il arrive maintenant au village de La Boulaye. Il est onze heures et demie
du matin environ quand il a une nouvelle surprise : à cet endroit il se heurte
à un détachement de 80 hommes du bataillon le Vengeur commandé par Dupuis, chef
de poste à Saint Fulgent. Quelques coups de feu sont échangés sans résultat et Charette,
une fois encore, réussit à s’échapper mais est obligé de changer de direction. Les
Vendéens partent maintenant vers le Nord dans la direction du château de la Chabotterie.
(Cf. Plan ci-dessus)

Le Village de la Chevasse vers 1910.
Néanmoins, l’objectif de Charette reste toujours de se diriger vers le
bois de l’Essart, maintenant pas trop éloigné. Aussi, arrivé à la ferme des Morinières, les Bleus semblant avoir
été semés, il reprend la direction Est et traverse ainsi la ferme du Fossé. Et
dans la même direction il arrive ainsi sans difficultés au village de La Grande Chevasse. A cet endroit il
prend le temps de manger un morceau de pain dans une des maisons et s’apprête à
prendre la direction du village de l’Imbretière. Quand tout à coup la
sentinelle aperçoit sur le chemin une troupe de soldats venant de cet endroit
et se dirigeant vers eux. Il s’agit du général Jean-Pierre Travot à la tête
d’un bataillon de 350 chasseurs. Partis de Chauché, ils arrivent précisément du
bois de l’Essart où ils ont effectué une battue et se rendent au château de la
Chabotterie pour y déjeuner et y prendre du repos.
Au XIXème siècle, au cours de cet épisode, l’omniprésence
des troupes républicaines surgissant toujours juste au moment opportun est
apparue très suspecte. Certains ont évoqué une trahison et se sont même essayés
à en découvrir les coupables possibles. En réalité l’absence de réels moyens de
communication à l’époque rendait cette hypothèse tout à fait invraisemblable.
L’armée était tout simplement informée de la présence de Charette dans la contrée
et elle a mis les moyens dont elle disposait alors pour pouvoir le capturer.
Charette n’a donc plus d’autres possibilités que de revenir sur ses pas
et de s’enfoncer dans les bois de La
Chabotterie, alors beaucoup plus importants qu’ils ne le sont aujourd’hui.
Mais Travot, qui le cherche depuis longtemps et met tout son
acharnement à le capturer, n’est absolument pas décidé à le laisser filer une
fois encore. Il en va de son avenir militaire !

Le Bois de La Chabotterie : carte
postale de 1898.
Il envoie alors ses chasseurs à cheval en avant pour couper la route du
héros vendéen, part lui-même vers la Chabotterie pour l’attendre et laisse le
commandant Vergèz dans le pré de « la Muse » surveiller les taillis. Dans
la fébrilité, il perd son chapeau de général, bicorne à plumes tricolores. Les
premiers coups de feu échangés ont alerté les soldats de la colonne de Valentin
qui suivaient Charette de loin. Ceux-ci accourent pour se joindre au dispositif
et contribuent ainsi à fermer efficacement l’étau. Cette fois-ci les Vendéens
sont véritablement cernés. En vain, ils essaient de ressortir du taillis, de se
frayer un passage vers la Chabotterie ou de revenir vers leurs pas.
Vergèz qui a perdu son cheval (et ses souliers dans la boue) est le
premier à apercevoir Charette. Il s’écrit sans en être tout à fait convaincu - « Voici Charette ! C’est Charette ! ». Il tire
plusieurs coups de feu dans sa direction et lui occasionne une blessure à la
tête et une autre qui lui a littéralement labouré l’épaule droite. Pourtant le
général vendéen tente encore de s’enfoncer dans les fourrés.

Charette s’écroule dans les bois.
Le sang qui s’écoule de sa blessure au front le rend pratiquement
aveugle, il ne peut écarter les branches, ses forces l’abandonnent, il perd
connaissance. Son domestique Bossard, qui l’avait chargé sur ses épaules, est à
son tour abattu. Le chevalier Samuel de Lespinay de la Roche d’Avau prend alors
le relais mais ne parvient qu’à le conduire près de la grosse cosse d’un arbre
coupé à l’orée de la forêt et à peu de distance des jardins du château de la
Chabotterie (cette cosse de bois, conservée religieusement, a ensuite malheureusement
été détruite en décembre 1870 par un bucheron non informé de son importance).
Les Bleus arrivent aussitôt, le chevalier de Lespinay tue le premier
mais meurt à son tour. Charette a repris connaissance mais n’est plus capable
de fuir. Vergèz, à coups de sabre, lui entaille le poignet, lui coupe trois
doigts de la main gauche et réussit à le désarmer. Mais il n’est pas encore absolument
sûr de celui qu’il a arrêté.
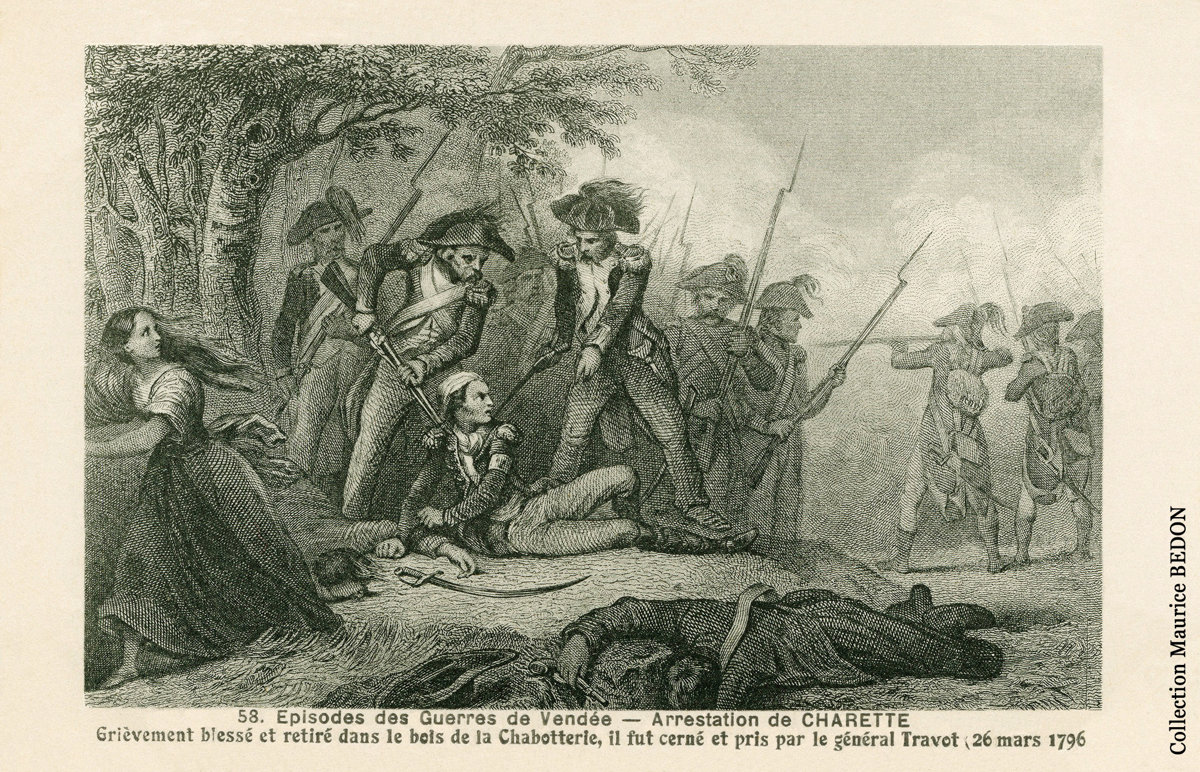
L’arrestation de Charette.
Le général Travot, attiré par les coups de feu et le bruit, arrive à ce
moment là. Il se saisit du prisonnier à bras le corps et lui crie :
- « Comment
t’appelles-tu ? »
Devant l’absence de réponse du blessé, le chasseur Jannet Bauduère des
Sables d’Olonne lui dit :
- « Pouvez vous vous
soulever un peu, mon général, que je voie sa figure ? », puis après l’avoir reconnu :
- « Tenez ferme, c’est notre
homme »
Le général vendéen est relevé et Travot lui demande à nouveau :
- « Où est Charette ? »,
il lui répond : « Le voilà »
Travot, qui a déjà cru tant de fois le tenir, mais en vain, insiste
pour être sûr :
- « Est-ce bien
lui ? »
- « Oui, Foi de Charette »
Après ces quelques mots échangés, deux soldats portent le blessé en
dehors du bois. Les autres convergent aussitôt de partout pour voir le
spectacle et crient « Vive la
République » et « Vive
Travot ». Le prisonnier qui n’avait pas reconnu le général bleu (car
ce dernier a perdu son chapeau à plumes tricolores) lui demande :
- « Où est le
commandant ? »
- « C’est moi », -
« Serais-tu donc Travot ? », - « Oui »
- « A la bonne heure,
c’est à toi seul que je voulais me rendre »
Rassuré il adresse avec noblesse ses félicitations à son vainqueur,
conformément aux traditions de l’ancien régime. Travot le remercie, non moins
courtoisement.
Il est à ce moment précis midi et demie ce mercredi 23 mars 1796 et en
réalité le combat considéré symboliquement comme le dernier de La Guerre de
Vendée n’a guère duré plus d’un quart d’heure.

L’arrivée à La Chabotterie par les jardins.
Pour établir le bilan de cette affaire, disons que des 46 Vendéens
présents environ en début de journée, 10 ont été abattus durant la course, 17
sont morts à la Chabotterie, 3 (dont Charette) ont été faits prisonniers puis
fusillés ultérieurement, 16 à peu près seraient donc parvenus à s’échapper
avant la fin.
Charette étant blessé plusieurs fois et trop faible pour marcher, les
chasseurs vont le porter jusqu’au château de la Chabotterie tout d’abord en
improvisant une civière avec deux fusils. Au château, ils vont l’installer dans
la cuisine située un peu en contrebas, devant la grande cheminée pour qu’il
puisse sécher ses vêtements. Les officiers comme les soldats vont toujours lui
montrer une grande déférence, dont il ne manque pas de les remercier
courtoisement. Pour prouver sa satisfaction il offre même cérémonieusement son
sabre au général Travot.
A ceux qui le questionnent sur les raisons de sa reprise des armes, il
répond que les promesses faites et non tenues par la République en sont la
cause. Et quand on lui demande pourquoi il s’est laissé faire prisonnier au
lieu de se donner le mort il réplique :
-
« Mais le suicide est un acte de
lâcheté ! Je me suis battu pour ma religion, et j’aurais commis un crime
contre les lois divines, si je me fusse détruit moi-même. Au surplus, je prouverai
que je ne crains pas la mort ».

La cuisine de la Chabotterie.
Après un bref repas et plusieurs heures de repos, aux alentours de 16
heures 30, tout le monde se prépare à prendre la route. Malgré ses blessures, Charette
est maintenant capable de remonter à cheval et ses geôliers ont pour mission de
le conduire au comité des Sables d’Olonne. On se remet donc en chemin vers
cette destination, en passant tout d’abord par le bourg des Lucs-sur-Boulogne
et en prenant ensuite la route du Poiré-sur-Vie.
Arrivés à proximité de ce bourg, alors qu’ils ont déjà parcouru une
vingtaine de kilomètres, ils passent devant le logis de Pont-de-Vie. Il est 19
heures, la nuit approche, il semble préférable et beaucoup plus sûr de passer
la nuit à cet endroit. On s’y arrête donc. Charette y demande simplement une
soupe à l’oignon et s’endort paisiblement.

1. La statue du général Travot à La
Roche-sur-Yon (fondue en 1942). 2. Façade du logis de Pont-de-Vie au Poiré
Le lendemain matin 24 mars 1796 (jour du Jeudi Saint) Travot reçoit de
nouveaux ordres lui demandant de conduire le prisonnier non plus aux Sables
d’Olonne, mais à Angers. On reprend donc aussitôt la route mais dans l’autre
sens .Le convoi revient aux Lucs-sur-Bologne et traverse le bourg de Montaigu
vers 11 heures. Il arrive en fin de journée à Cholet pour y passer la nuit. Il
faudra toute la journée du lendemain vendredi 25 pour se rendre jusqu’à Angers.
En arrivant dans cette ville, Charette est emmené directement à l’hôtel
particulier dit de Lantivy résidence du général Hédouville. Ce dernier, entouré
de tous les officiers de son état-major, le reçoit avec beaucoup de courtoisie
avant qu’il ne soit conduit en prison.
![]()

Le vieux château d’Angers
Le samedi 26, le docteur Lachèze est appelé pour soigner le blessé car
ses plaies commencent à s’infecter et le font souffrir. Il lui refait ses
pansements ; on l’aide à se laver sommairement et à nettoyer ses
vêtements. Redevenu présentable il peut se rendre au banquet offert en son
honneur par le général Hédouville. Il y a peu, certains officiers ont pu se
faire ordonner de commettre des horreurs ; la Terreur terminée, les traditions
militaires de l’ancien régime reprennent déjà leurs droits.
Charette mange de fort bon appétit et participe aux conversations avec
beaucoup d’aisance. Le soir on le conduit au vieux château d’Angers.
De nouvelles instructions arrivent, le prisonnier doit maintenant être
conduit à Nantes. Le lendemain matin dimanche 27 mars (jour de Pâques) vers
neuf heures du matin il est embarqué dans une canonnière avec les généraux
Travot, Valentin et Grigny pour descendre la Loire jusqu’à Nantes. Le voyage va
durer pas moins de 16 heures. On aperçoit ainsi Chalonnes, Ingrandes, Saint-Florent-le-Vieil,
Ancenis, Champtoceaux. Le prisonnier s’est il ainsi remémoré les étapes de l’Épopée
Vendéenne. En tous cas, régulièrement d’autres canonnières républicaines
saluent leur passage en signe de victoire.
Il fait totalement nuit quand on arrive enfin à Nantes, vers une heure du
matin. Une compagnie est là sur le quai pour présenter les armes. Charette est
directement conduit dans la prison du Bouffay toute proche, ce lieu sinistre
qui venait de connaitre tant de drames dans un passé tout récent.
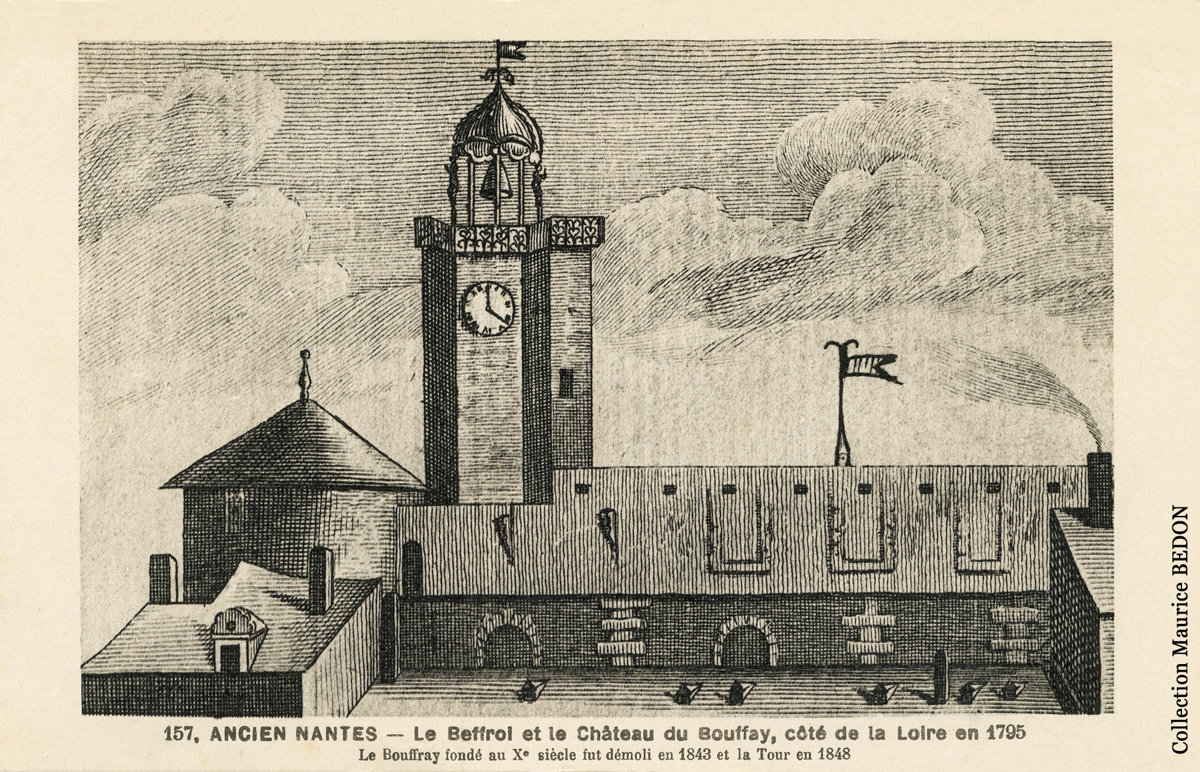
Gravure représentant l’ancienne
prison du Bouffay (détruite en 1847).
Dans une des salles, épuisé par ses blessures et la fatigue du voyage, il
se laisse tomber sur un lit de camp. Le lendemain matin lundi 28 mars, le
général Duthil commence par le soumettre à un long interrogatoire. Or le bruit
courait alors dans la ville de Nantes et les campagnes environnantes que le
prisonnier n’était pas Charette lui-même, mais un de ses soldats qui s’était
sacrifié à sa place. Le général Duthil a donc l’idée de promener son prisonnier
dans les rues du centre ville, précédé de la garnison en grand uniforme, des
tambours et des généraux républicains. Les Nantais ont un peu de mal à
reconnaître le prestigieux cavalier charismatique en ce malheureux blessé, le
bras en écharpe, la tête enveloppée dans un mouchoir tâché de sang et aux
vêtements sales. Toutefois, ils font ce que l’on attend d’eux, ils le conspuent
copieusement. Epuisé, le prisonnier s’évanouit et doit être ranimé dans une
maison voisine. Il dit alors aux officiers présents : « Si je vous avais pris, je ne vous aurais pas traité de cette
façon ; j’aurais préféré vous fusiller tout de suite ». A son
retour à la prison, il dîne et s’endort paisiblement.
Le lendemain mardi 29 mars 1796 (9 germinal de l’an IV), dès 9 heures
du matin, il comparait devant un Conseil de Guerre, composé de huit officiers
de tous grades et réuni dans une des salles de la prison. Considéré comme
« le fléau de la Patrie », malgré la défense de son avocat Villenave,
il est condamné à mort après deux heures seulement d’audience. Son seul souhait
est d’avoir la possibilité de se confesser et pour ne pas mettre en danger la
vie d’un prêtre réfractaire, il accepte de recevoir un prêtre constitutionnel. Peu
après, sa tante, sa belle-sœur et sa sœur sont autorisées à venir lui rendre
visite. La dernière lui annonce qu’un prêtre réfractaire se tiendra à l’une des
fenêtres de l’ancienne rue Saint-Georges habillé en noir avec un mouchoir blanc
à la main.
Vers 16 heures le cortège se met en marche, escorté par les généraux
républicains et les baïonnettes des soldats. Charette, qui a mis sur sa tête un
foulard de soie rouge, marche d’un pas ferme en récitant « le Miserere » en compagnie du confesseur qu’on lui a
attribué : l’abbé Guibert. Mais, arrivé « rue Georges », il
aperçoit ce que sa sœur lui avait annoncé. Il courbe alors la tête et reçoit
l’absolution d’un prêtre conforme à ses convictions.

Gravure représentant le mort de
Charette place Viarmes à Nantes.
Le défilé finit par arriver sur la place des Agriculteurs (actuelle
place Viarmes), ce même espace où Jacques Cathelineau avait reçu une blessure
mortelle lors de l’attaque de Nantes le 29 juin 1793. 5 000 hommes se sont
déjà installés en formant les trois côtés d’un carré fermé par un mur de
clôture en pierres. Un roulement de tambour annonce l’arrivée du cortège et les
18 soldats prévus pour constituer le peloton d’exécution viennent se placer au
centre du dispositif. Le condamné s’applique à rassurer son confesseur « J’ai bravé cent fois la mort, j’y
vais pour la dernière fois ». Il refuse catégoriquement de se mettre à
genoux, de porter un bandeau sur les yeux et crie aux soldats en montrant son
cœur : « Visez là, c’est là qu’il
faut frapper un brave ».
Les détonations retentissent dans un grand silence ; le corps du
supplicié reste d’abord droit puis s’affaisse dans une mare de sang. Le général
Duhil fait chanter la Marseillaise puis défiler les troupes. La population se
disperse, tout est fini !
Enfin pas tout à fait ! Car, même mort, Charette va continuer à
causer des soucis aux autorités républicaines. Celles-ci avaient autorisé le
sculpteur Casanne à prendre un moulage en plâtre de son visage. Mais la rumeur
courant que l’artiste avait échangé le corps, ils l’ont fait arrêter et
interroger. En outre, pour être certains que ses partisans ne l’avaient pas
enlevé, et vérifier du même coup sa présence, ils vont aller exhumer le corps
qui avait été enterré dans un terrain vague près de la rue de Rennes, servant
de cimetière pour les soldats et les condamnés.
En revanche, une porte en bois située sur le mur de l’exécution avait
reçu 7 des 18 balles tirées par le peloton d’exécution. Elle a été retirée
prestement et déménagée précieusement. Elle se trouve aujourd’hui au château de
la Contrie chez les descendants de la famille de Charette.

1. La Croix de la place Viarmes à Nantes. 2. La Croix de la Chabotterie à Saint
Sulpice-le-Verdon
Pour commémorer le centenaire de l’exécution de Charette, on inaugura
le 28 mars 1896 une croix érigé place Viarmes à Nantes, à l’emplacement de son
supplice. Un Sacré-Cœur occupe le centre de la croix de granit et des fleurs de
lys décorent les extrémités des bras de cette croix. Une plaque posée sur le
socle est elle aussi ornée de fleurs de lys. On peut y lire : « Ici a été fusillé / pour son Dieu et
son Roi / le général Vendéen / Charette de la Contrie / 29 mars 1797 ».
Par la suite, au début du XXème siècle, la croix a été
déplacée et installée dans un coin entre deux immeubles. C’est dans cette
position que nous la montre la carte postale ci-dessus, vers 1910. Plus
récemment la croix a repris approximativement sa place initiale sur la place
proprement dite.
Dans le même esprit, une simple croix provisoire en bois a tout d’abord
été installée dans les bois de la Chabotterie à Saint-Sulpice-le-Verdon en 1892. A l’initiative d’Alain
de Goué propriétaire du château, elle a été remplacée le 6 août 1911 par une
nouvelle croix en granit implantée à trois mètres seulement de l’endroit précis
de la capture de Charette. Celle-ci est l’œuvre de M. Dupeux entrepreneur à
Nantes et de Vallet sculpteur. Comme à Nantes, une fleur de lys est sculptée à
l’extrémité de chacun des bras de la croix proprement dite et un Sacré-Cœur à
la croisée. Sur une plaque, posée au centre du socle, on peut lire : « ici fut pris par le général Travot,
le général Vendéen François Athanase CHARETTE de la Contrie le 23 mars 1796
+ ». En outre, sur un listel figurant sur le piédestal, on
distingue : « Pour ma religion,
ma patrie et mon roi » (interrogatoire de Charette à Nantes le 29
mars, jour de sa mort). On aperçoit encore, au pied de la croix, un petit
blason portant les armoiries de la famille et qui semble se lire héraldiquement
ainsi : « d’argent au lion
rampant de sable, armé et lampassé de gueules, accompagné en pointe de trois
merlettes du même, becquées et onglées du même, posées deux et un »,
sommé d’une couronne de marquis. Sur la partie supérieure du socle sont enfin
sculptés en faisceau, d’une part un vieux fusil, une faux, un pistolet, un
médaillon fleurdelisé et d’autre part un sabre, une pique et un drapeau.

Inauguration de la Croix de la
Chabotterie le 6 VIII 1911.
L’inauguration de cette croix, le 6 août 1911 a commencé par une
grand-messe dans l’église de Saint-Sulpice-le-Verdon célébrée par le curé de la
paroisse l’abbé E. Michaud accompagné du révérend Ch. Fargeau missionnaire
diocésain. L’assistance s’est ensuite rendue en procession jusqu’à la
Chabotterie, en chantant la liturgie des Vêpres, les litanies de la Vierge et
le chant de « Je suis Chrétien,
voilà ma gloire…. ». A 13h 45 le cortège, regroupant environ 4 000
personnes, arrive enfin devant le calvaire recouvert d’un voile fleurdelisé. Le
curé Michaud procède à la bénédiction solennelle et lit la lettre de SE Monseigneur
Clovis Catteau Evêque de Luçon accordant une indulgence plénière de 50 jours.
Puis la foule se presse pour embrasser le calvaire pendant que la chorale
entonne une « Cantate à Charette »
sur l’air de « La Vendéenne ».
Cette cérémonie religieuse est suivie d’un congrès royaliste durant
lequel vont prendre successivement la parole :
- René
Vallette, Directeur de la célèbre revue du Bas-Poitou,
- Jacques
de la Débuterie,
- M. de la
Vrignais, Député de la circonscription,
- Le comte
Eugène de Lus-Saluces, Chef du Comité Régional,
- Le comte
Amédée de Béjarry,
- Le
docteur Paul Bourgeois, Président du Conseil Général de la Vendée,
- Paul
Robain, Directeur du comité de l’Action Française,
- Le comte
de Chabot,
- Le
général baron de Charette, Président de la manifestation,
-
Alain de
Goué, propriétaire du lieu.

LES
BATAILLES DE MONTAIGU ET DE SAINT-FULGENT (1793)
Située au nord du
département de la Vendée, Montaigu était à la fin du XVIIIème siècle
la première cité un peu importante que l’on rencontrait en sortant de la ville
de Nantes par le cours royal se dirigeant vers La Rochelle (actuel RD 137). Dès
le début de la Révolution elle devint chef-lieu d’un district en 1790 et sera
même par la suite chef-lieu d’arrondissement sous le Ier Empire,
avec siège d’une sous-préfecture (dans une maison située 12 rue du Vieux Couvent).
Au début des Guerres de Vendée, cette ville servit également de quartier général
à Charles de Royrand général en chef de l’Armée du Centre.

La maison qui servit de
Sous-Préfecture.
Dès le tout début de l’Insurrection
Vendéenne, elle est le théâtre d’évènements importants et significatifs. Les
autorités républicaines de Montaigu, se sentant menacées par la venue probable
des insurgés, ont demandé du secours à leurs collègues du Directoire de
Mortagne-sur-Sèvre. On leur envoie alors un détachement d’une trentaine de
gardes nationaux, conduits par le commandant Douhet. Le 12 mars 1793, quand ces
derniers arrivent du côté de l’Est par l’ancienne route de Tiffauges, ils sont
surpris, très rapidement défaits et capturés par un groupe de jeunes insurgés,
près de l’étang du château actuel des Barillères.
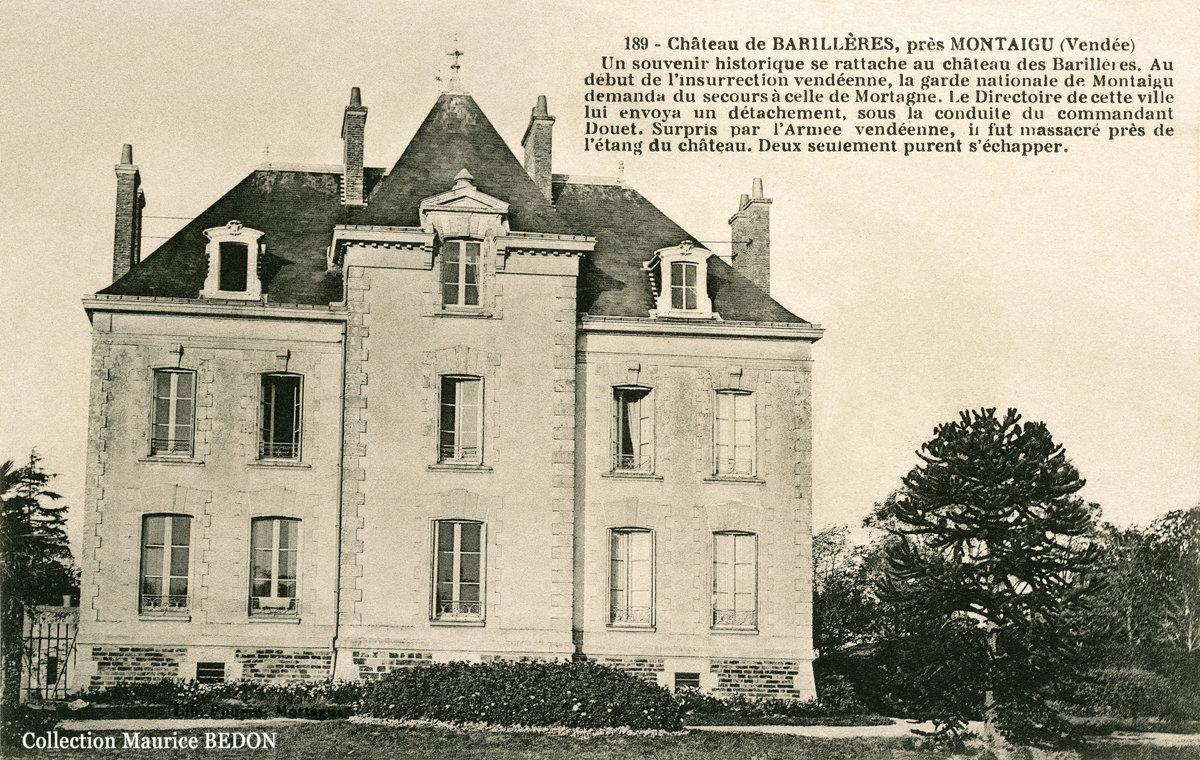
Le château
des Barillères à St Hilaire-de-Loulay.
Le lendemain mercredi 13
mars vers 11 heures, les choses deviennent plus sérieuses. D’autres Vendéens,
au nombre de 400 environ, provenant des communes voisines de La Guyonnière, La
Boissière, Treize-Septiers et La Bruffière, arrivent du côté de Meslay à l’Est
et attaquent la cité vers le lieu dit « Petit Sabot ». Les troupes
républicaines, comprenant environ 200 hommes avec deux canons, réussissent tout
d’abord à les repousser. La carte géographique publiée ci-dessous nous permet
de situer tous les lieux des différentes opérations.
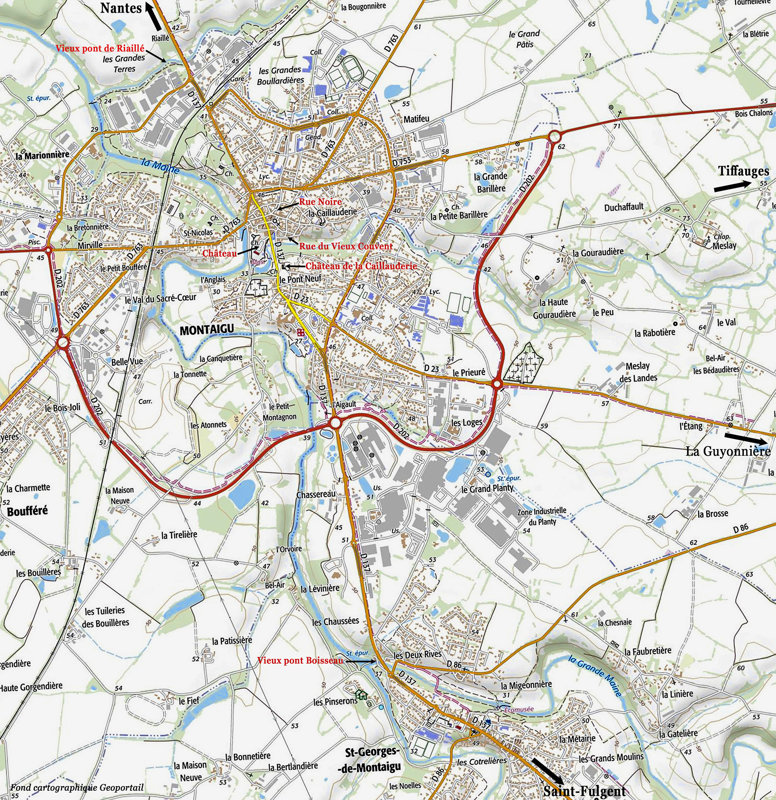 Montaigu et ses alentours.
Montaigu et ses alentours.
Pendant ce temps là,
une nouvelle bande de paysans insurgés, originaires des villages de Saint-Hilaire-de-Loulay
et conduite par le sacristain Poiron, arrive à son tour et cette fois-ci par le
Nord de la ville. La garnison républicaine rapidement débordée, après une première
canonnade, décide finalement de se replier en direction du vieux château féodal
car celui-ci est jugé plus facile à défendre, du fait de ses murailles et de ses
douves. Mais les Vendéens, connaissant l’existence d’un passage du côté de la
rivière, contournent la fortification par l’Ouest, empruntent le souterrain et
surgissent de cette manière directement dans la cour de la forteresse, rendant ainsi
les canons inutiles. La garnison est totalement surprise et sa défense complètement
désorganisée. Elle est donc obligée de rendre les armes aux environs de quinze
heures.

Le vieux château de
Montaigu aujourd’hui.
Malheureusement, après
leur victoire assez facile, les Vendéens joyeux se répandent dans les rues de
Montaigu et vont s’occuper à vider les caves des maisons appartenant à des « patriotes »,
comme ils le feront hélas trop souvent surtout au début de l’insurrection. Ensuite,
naturellement ivres (et pas que de la victoire !), les esprits
s’échauffent de plus en plus. Les habitants de Saint-Hilaire-de-Loulay sont particulièrement
excités, ils dépouillent de leurs uniformes les prisonniers faits depuis la
veille et les entrainent avec eux.
Nous allons pouvoir les
suivre dans la cité à l’aide du premier plan cadastral, réalisé quelques années
seulement après l’insurrection en 1814 et reproduit ci-dessous. Il nous permet
de bien nous représenter la cité de cette époque et en particulier le château
féodal beaucoup plus séparé de la ville qu’il ne l’est aujourd’hui.
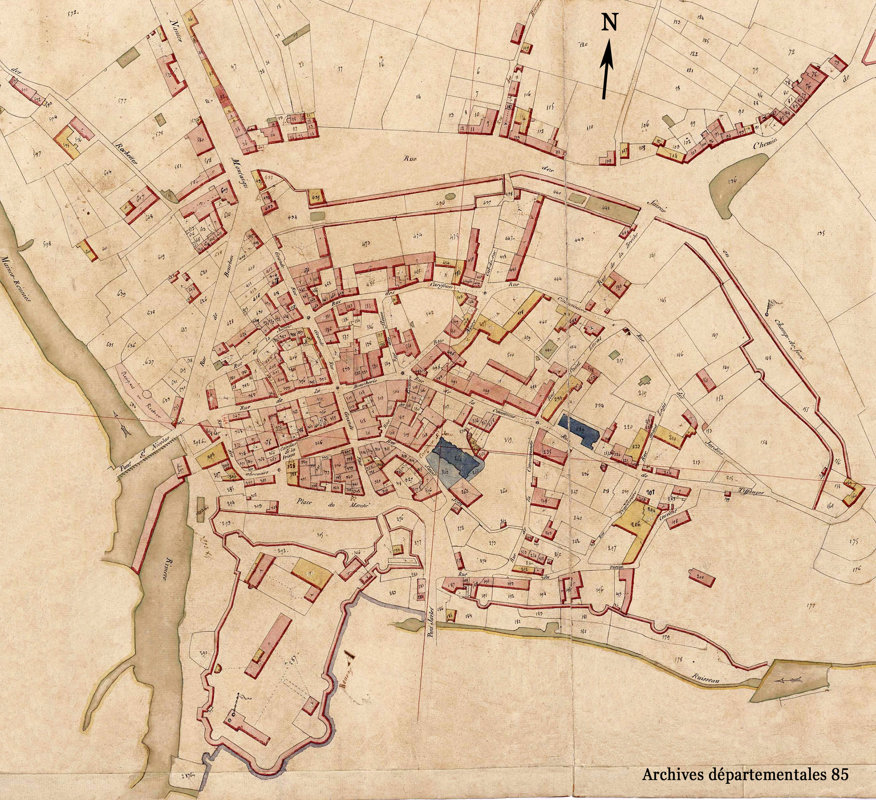
Le bourg de Montaigu sur
le cadastre de 1814.
Partant à travers la
ville, les insurgés vont aller s’en prendre au prêtre constitutionnel (« jureur »)
de la ville Claude Bouche, ancien vicaire d’Ardelay, qui avait remplacé depuis
1791 l’abbé Jacques Raillon curé réfractaire. Il est fait prisonnier mais
réussit à s’échapper puis à s’enfuir à Fontenay-le-Comte. Le presbytère a moins
de chance : situé rue Chauvinière, il est pillé et incendié.
Les soldats et les
prêtres jureurs ne sont pas les seules personnes détestées, bien au contraire, d’autres
familles de patriotes se sont distinguées par des décisions très impopulaires
dans une ville où les opinions sont très opposées. Une famille en particulier
symbolise à elle seule toutes les décisions imposées par la force et les mesures
révolutionnaires honnies : les Thiériot. Se sentant en danger, Madame
Thiériot et ses deux filles réussissent à s’enfuir, ainsi que ses deux fils qui
s’échappent de la ville. Les insurgés se dirigent effectivement vers leur logis
de la Caillauderie au Sud de la ville. Ils n’y trouvent que le père, Hardoin-Aimé
Thiériot, docteur à l’hôpital Saint-Jacques. Malade à son domicile, il est mis
dans un fauteuil devant la façade et fusillé avec les autres prisonniers.
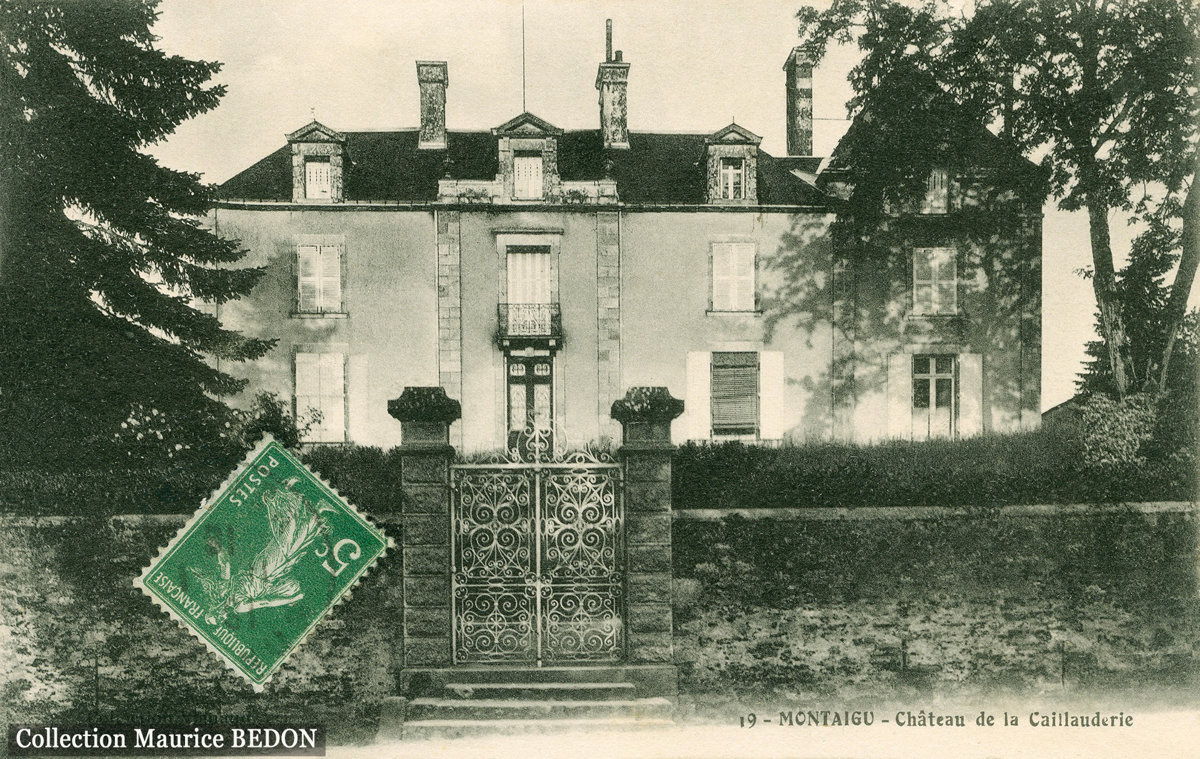
Le château actuel de la
Caillauderie.
Revenus au calme, les Vendéens
prennent soin dès lors de mettre en place un comité royaliste chargé de
l’administration de la ville ; mais son travail consiste surtout à gérer
les conséquences de la guerre sur la vie quotidienne. En effet c'est une ville
où : - le culte n’est plus du tout célébré, - l’enseignement n’est plus
assuré, - les services de la poste ne fonctionnent plus, - les communications
ne se faisant plus rendent le commerce très difficile, - les arrivées de
prisonniers compliquent encore la situation.
C’est à ce sujet et durant
cette période que se place un événement resté célèbre. Les prisonniers bleus,
toujours plus nombreux, compliquaient sérieusement le problème des vivres dans
la ville. Aussi à Montaigu on a l’idée d’envoyer trois prisonniers à Nantes,
avec mission de négocier avec le comité républicain de Nantes un échange de
prisonniers. Cette tentative est un échec car les Nantais refusent catégoriquement
et par principe tout marché avec « les brigands » le 14 mai. Un des
trois prisonniers, Pierre Haudaudine, très respectueux de la parole donnée,
tient à revenir en prison à Montaigu. Il fera par la suite partie des 5 000
prisonniers graciés par Bonchamps à Saint-Florent-le-Vieil le 18 octobre et,
reconnaissant, il réussit lui-même à sauver Madame de Bonchamps de l’exécution.
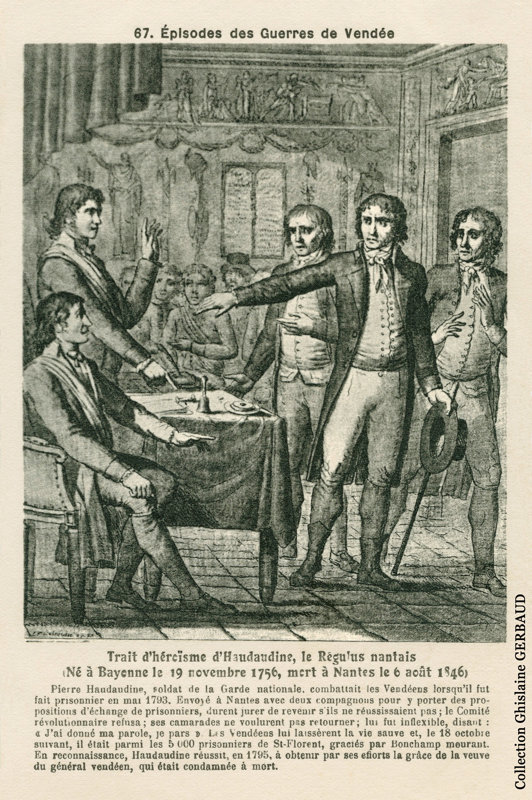
L’histoire de Haudaudine.
La guerre civile proprement
dite, toujours proche, va revenir directement à Montaigu dès le mois de
septembre 1793.
Le dimanche 15
septembre en effet, le général Charette de la Contrie, avec son armée et des
milliers de refugiés, pénètre dans la ville de Montaigu. Comme il est poursuivi
depuis Léger par les armées républicaines de Beysser et de Canclaux, il ne s’y
arrête pas longtemps, se repliant vers Cugand et Clisson. Les Bleus se dirigent néanmoins
vers Montaigu.

Le vieux pont de Riaillé
vers 1900 (aujourd’hui disparu).
Le lendemain lundi 16
septembre 1793 au matin, la ville se trouve pratiquement encerclée par les
soldats mayençais. Le général Kleber occupe le flanc gauche, le général Beysser
le droit et le général Aubert-Dubayet le centre. La faible garnison vendéenne
n’est pas de taille pour pouvoir résister efficacement. Elle a tout d’abord
fait couper des arbres sur les routes et détériorer des ponts pour rendre
difficile la progression des Républicains. Elle fait tout de même une résistance
désespérée à Kleber (qui arrive de Remouillé) au Nord au pont de Riaillé et à
l’ancien pont voisin, là où le cours royal (actuelle RD 137) franchit le
ruisseau du Gournet. Elle finit par se replier vers Tiffauges et à se regrouper
avec l’armée d’Anjou pour ce qui sera la bataille de Torfou. Les soldats mayençais
de Beysser, vainqueurs de cette « première bataille » s’emparent alors
de la ville et la livrent à un véritable pillage en règle.

La vieille ville de
Montaigu, gravure du XIXème siècle.
Après leur éclatante victoire
sur l’avant-garde des Mayençais, commandée par Kléber, à la bataille de Torfou
le jeudi 19 septembre 1793, les armées vendéennes se reposent un peu le
lendemain à Tiffauges. Les généraux tiennent un conseil de guerre à cet endroit
et décident de poursuivre les Mayençais de façon à essayer de les rejeter hors
du territoire de la Vendée Militaire. Charrette et Lescure iront donc attaquer la
colonne cantonnée à Montaigu puis ils se retourneront pour aller aider
Bonchamps à les déloger de Clisson. Il s’agissait là d’un projet ambitieux qui
demandait par conséquent une application très stricte.

Charette. Lescure.
Comme prévu samedi 21
septembre, les troupes se mettent en route. Neuf kilomètres plus loin, à
Treize-Septiers, elles se divisent en deux groupes, le premier oblique vers la
Guyonnière pour prendre Montaigu par le Sud, le second commandé par Joly se
dirige en avant-garde directement vers l’Est de la ville. Cette dernière est
toujours occupée par le général Jean-Michel Beysser qui, ignorant encore le
résultat de la bataille de Torfou, s’y croit parfaitement en sécurité avec 8 000
hommes. Joly et ses hommes rencontrent la première ligne républicaine dans les
faubourgs et sous un feu violent l’oblige à se replier en direction du centre
ville. Totalement surpris, Beysser fait alors donner l’artillerie contre les 6 000
hommes qui arrivent maintenant avec Lescure et Charrette. Les vendéens, selon
leur habitude, rendent les canons inefficaces en se couchant par terre, à
chaque fois juste avant le tir des boulets et en avançant ensuite juste après
très rapidement pendant la préparation d’un second tir. Ils parviennent ainsi à
neutraliser les artilleurs sans défense et à s’emparer des canons.

Le vieux château de
Montaigu au XIXème siècle.
Les Républicains
essayent, comme la première fois, de se regrouper dans l’enceinte du château
mais en vain, il est trop tard. Joly investit déjà la forteresse où se trouvent
encore 500 Bleus, notamment les grenadiers. Le représentant Cavaignac réussit tout
de même à éviter l’anéantissement total de la colonne républicaine. Au bout
d’une heure de combat, Beysser ordonne la retraite en direction de Nantes, la
cavalerie ayant déjà ouvert la marche dans cette direction. Blessé, il parvient
toutefois à organiser la retraite de ses effectifs en direction de Nantes en
particulier des 79éme et 109ème régiments d’infanterie.
Arrivé au pont de Remouillé, situé juste après la limite des départements de Vendée
et de Loire-Inférieure, il réussit finalement à stopper à cet endroit les
assauts incessants des vendéens qui l’ont poursuivi jusque là.

Extrait du plan cadastral
de Remouillé en 1813.
Le comité de Salut
Public à Paris ne pardonnait que très rarement à ses généraux vaincus, quelle
que soit leur valeur ou les services rendus antérieurement. Le général Beysser
fut donc par la suite accusé et tout naturellement condamné à la guillotine.
A Montaigu, le
lendemain dimanche 22 septembre, Lescure et ses soldats angevins vont assister
à la messe célébrée par un prêtre réfractaire dans l’église Saint Jean-Baptiste
de Montaigu. Pendant ce temps-là, certains des hommes de Joly dévastent le château
mais sont heureusement empêchés par leurs chefs d’aller commettre d’autres
exactions en ville. Selon l’érudit Dugast-Matifeux, certains prisonniers
républicains capturés dans la forteresse auraient alors été exécutés et leurs
cadavres jetés dans le puits voisin.
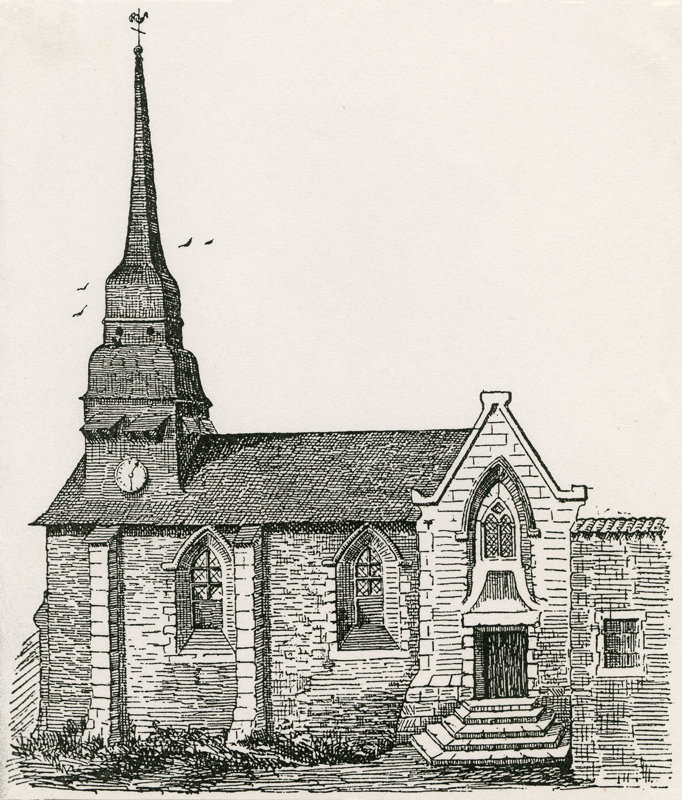
L’ancienne église de
Montaigu (reconstruite en 1863).
Alors que les généraux
tiennent conseil dans le château, des lettres envoyées par les 600 habitants de
Saint-Fulgent les appellent au secours pour venir délivrer la ville des troupes
bleues qui l’ont envahie et y sèment la terreur. L’opération n’est peut être pas
trop risquée, mais elle contredit le plan arrêté en commun à Torfou et risque
de laisser Bonchamps seul se faire écraser par les Mayençais à Clisson.
Charette et Joly sont pour, Lescure contre, mais il va finir par se laisser
convaincre par ses collègues.
Les armées quittent aussitôt
Montaigu pour se diriger vers le Sud en direction de Saint-Fulgent, distant de
20 kilomètres et en utilisant le grand cours (anciennement « royal »
et actuel RD 137). Ils passent ainsi dans l’après-midi, sans encombre, le vieux
pont Boisseau sur la rivière la Maine juste à l’entrée de Saint
Georges-de-Montaigu. A cet endroit, ils sont déjà repérés par les éclaireurs de
l’armée républicaine.

Le vieux pont Boisseau à
St Georges-de-Montaigu.
Aussi, leurs ennemis
prévenus les attendent de pied ferme un kilomètre avant l’entrée Nord du bourg
de Saint-Fulgent. Ils sont commandés par le général Mieskouski. Il est 17
heures quand la bataille s’engage par un duel d’artillerie, qui dure près de
deux heures et n’aboutit pratiquement à aucun résultat. A 19 heures, alors que
la nuit tombe, les tambours vendéens contournant le bourg des deux côtés vont
sonner, faisant croire à des attaques d’encerclement. Les Bleus se replient
alors en ordre en direction du centre ville. Charrette, suivi d’un tambour
battant la charge, de Joly et de Savin, les prend en chasse vigoureusement dans
la longue rue principale de Saint-Fulgent.

La
longue rue principale de Saint-Fulgent.
La nuit est maintenant
tombée et c’est un violent combat au corps à corps qui se déroule dans la rue
de Saint-Fulgent plongée pratiquement dans l’obscurité. Pour effrayer leurs
adversaires les Blancs hurlent sans cesse « Vive le Roy » et leurs
cris sont amplifiés par l’écho produit par les maisons construites en rangs
serrés. Planchot, un farinier de la Gaubretière, utilisant cette espèce de
petite flûte locale appelée « flageolet », joue sans cesse par
dérision et d’une manière lancinante le chant du « ça ira ». Quand
son cheval est abattu, il va s’asseoir sur une borne et continue à jouer. Selon
les écrits de la marquise de La Rochejaquelein cette même action aurait bien été
réalisée, mais par un certain Rynks, un jeune Suisse appartenant à la cavalerie.
Malgré l’heure tardive, on continue à se fusiller presque à bout portant. Dans
l’obscurité, les soldats des deux camps puisent parfois des balles dans les
mêmes fourgons militaires, pour s’entretuer ensuite.

La Bataille de Saint-Fulgent
(Album Vendéen).
Les bataillons
républicains « Le vengeur » et « l’invincible », malgré
leurs noms prétentieux, sont presque entièrement anéantis. Le général
Mieskouski a perdu la meilleure partie de son armée, après huit heures de
combats effroyables. La bataille se termine pratiquement dans les jardins d’un
grand logis situé au centre du bourg. C’est aujourd’hui le parc de l’actuelle
Mairie de Saint-Fulgent. La tradition familiale affirme que c’est à cet endroit
qu’est tombé un de nos ancêtres du côté maternel. Ne pouvant continuer à
résister, les Républicains survivants se décident à faire retraite en direction
des Quatre-Chemins de l’Oie. On raconte qu’un habitant de Saint-Fulgent nommé
Monnereau tue un Bleu à l’aide de sa
fourche, lui prend son fusil et s’en sert pour abattre ensuite seize fuyards. Pourtant,
cette victoire masque mal un fait bien plus important : Bonchamps, sans le
soutien attendu, n’a pas réussi à refouler les Mayençais qui menacent encore la
Vendée. Aux yeux de l’état-major vendéen, Charette en portera la
responsabilité. Il n’y aura plus désormais d’opérations communes.

Le parc actuel de la
Mairie à St-Fulgent.
Durant la Guerre de
Vendée, il faut bien considérer que les deux camps n’ont jamais vraiment fait
jeu égal. Alors que les Bleus constituent une véritable armée disciplinée, les
Vendéens forment un groupe de paysans volontaires qui viennent pour participer
aux batailles et puis retournent chez eux ensuite pour effectuer les travaux
agricoles. De ce fait, il leur est très difficile de tenir garnison. Ils
laissent donc pratiquement sans réelle surveillance des villes qu’ils ont pourtant
conquises très chèrement.
Ainsi dès le 27 septembre,
l’armée du général Kléber vient camper au nord de Saint-Hilaire-de-Loulay sans éprouver
la moindre difficulté. Et trois jours plus tard le 30 septembre 1793, ne
rencontrant pratiquement pas de résistance, son armée entre dans Montaigu et
s’y installe.
L’amiral Louis-Charles
du Chaffault comte de Besné, habitant ordinairement le château de Meslay à la
Guyonnière, se trouvait ce jour là dans la maison de sa fille au N°2 de la rue
Noire. Il fut accusé, par dénonciation, d’avoir dirigé les Vendéens d’une
fenêtre du 1er étage. En fait, dans cette rue étroite et écartée des
opérations, il était matériellement impossible de diriger quoi que ce soit. Il
n’en fut pas moins aussitôt arrêté et conduit à la prison de Luzançay près de
Nantes. Il y mourut dans le plus complet dénuement le 29 juin 1794 (11 messidor
de l’an II). Sa fille Pélagie veuve de Louis Le Maignan de Lécorce, se sentant
menacée, rejoignit les armées vendéennes, participa à la Virée de Galerne et y
périt.

La maison du Chaffault, 2
rue Noire à Montaigu (à droite).
L’armée républicaine
installa une garnison importante à Montaigu et conserva cette fois-ci sans
encombres la ville jusqu’à la fin du conflit. Elle restera ville de garnison
jusqu’à la fin du Ier Empire. Pourtant, lors des évènements de
novembre 1799, le comte Constant de Suzannet tenta de prendre la ville mais ne
put dépasser Meslay.

LA BATAILLE DE TORFOU (19 septembre 1793)

La colonne de Torfou en 1900.
Cette carte postale, portant le numéro 32 (écriture rouge), compte
parmi les premières que le célèbre photographe Eugène Poupin de Mortagne-sur-Sèvre
a réalisées (celle-ci vers 1900). Elle est intéressante à un double titre
puisqu’elle nous montre, outre la colonne, le curieux véhicule hippomobile dont
se servait l’éditeur pour ses déplacements professionnels ainsi que trois
jardiniers probablement du château voisin du Couboureau. Ces derniers seraient
venus entretenir les espaces verts aux abords de la colonne.

L’armée de Mayence.
1°- La Bataille :
Après la capitulation de Mayence, le 23 juillet 1793, la Convention avait
décidé d’envoyer, contre les Vendéens, les troupes qui venaient d’être libérées
en échange de la promesse de ne pas servir contre les puissances coalisées. Ces
soldats, surnommés de ce fait les Mayençais et considérés comme
« invincibles », étaient placés sous les ordres du général en chef Jean-Baptiste
Aubert Dubayet secondé par les généraux Louis-Antoine Vimeux, Beaupuy, François
Haxo et Jean-Baptiste Kléber pour l’avant-garde. Ils étaient arrivés dans la
ville de Nantes le vendredi 6 septembre 1793. Pendant dix jours ils s’étaient
chargés de nettoyer de l’insurrection les abords de Nantes. Dès le 16 septembre,
Charrette s’était fait attaquer par eux à Montaigu. Parvenu à se dégager, il
avait compris l'importance de la menace.
Le 18 septembre 1793, les Mayençais occupent la ville de Clisson où
vient s’installer également l’état major de l’armée des côtes de l’Ouest
commandée par le général Jean-Baptiste de Canclaux. L’après-midi même, Kléber
avec son avant-garde de 2000 hommes décide de se diriger vers Gétigné, Boussay
et Torfou.

Infanterie républicaine 1793-1794. Soldat
Mayençais.
En effet ses ordres sont de suivre la Sèvre Nantaise par le chemin de
Boussay et de Torfou, pour ensuite faire sa jonction avec le général
Jean-Michel Beysser qui, lui, doit venir de Montaigu. Ensemble ils doivent
ensuite aller prendre la ville de Mortagne-sur-Sèvre et son parc d’artillerie.
Au matin du jeudi 19 septembre 1793, vers 9 heures du matin près de
Boussay, Kléber, est attaqué par un groupe de cavaliers de Charrette qui
n’engage pas le combat plus avant et s’échappe vers Torfou. Les Mayençais arrivent
ainsi avant 10 heures sur le plateau de la Métairie qui domine le terrain, au Nord-Ouest,
devant Torfou. Bien entendu ils empruntent l’ancienne route et traversent la
rivière sans encombre au gué dit du Bon-Débit. A cet instant, Kléber est
parfaitement sûr de lui car il est convaincu de n’avoir devant lui que l’armée
de Charrette.

Le gué du Bon-Débit : comparaison
d’une photo aérienne actuelle avec l’ancien plan (source Portail IGN).
Malgré les importantes modifications du paysage depuis le XVIIIème
siècle, tout particulièrement à cet endroit, à la suite des constructions de
nouvelles voiries et d’une ligne ferroviaire, le gué du ruisseau du Bon-Débit
est encore visible aujourd’hui. Sur la photo aérienne ci-dessus, les
différences de couleur de la végétation (marquées par des flèches) font
apparaître en certaines saisons le tracé exact de l’ancien chemin que les Bleus ont emprunté.

La passerelle au gué du Bon-Débit en
2017.
Depuis le plateau de la Métairie, le général fait bombarder le clocher
de l’église de Torfou et les maisons environnantes par ses canons utilisant des
boulets incendiaires au souffre. Il s’agit évidemment de l’ancien clocher
puisque l’église actuelle a été construite au XIXème siècle. Prise
de panique, une grande partie de la population fuit la ville vers l’Est en
direction des troupes vendéennes. Ce sont les chasseurs qui sont chargés de
prendre la ville. Contenus quelques temps, ils réussissent ensuite à faire
reculer les 300 soldats de Charrette jusqu’à la sortie de la ville puis à les
faire fuir. A ce moment là Kléber se croit vainqueur et va s’avancer au delà de
la ville en direction de l’Est.

L’entrée ouest de Torfou vers 1905.
Prévenues, plusieurs Armées Vendéennes sont déjà présentes sur le
terrain depuis la veille. Elles ont bivouaqué, dans la nuit du 18 au 19
septembre, le long de la route de Montaigu à Cholet : Charles de Royrand
au sud près de Tiffauges, puis Louis de Lescure et Maurice d’Elbée au centre. Charles
de Bonchamps, blessé, n’arrivera avec ses hommes que le lendemain matin et prendra
l’emplacement le plus au Nord. A minuit, sur un autel improvisé, l’abbé Bernier
a célébré, dans la plus grande ferveur, une messe au lieu dit « la foire
du Couboureau » non loin du château du même nom et du site de la célèbre
bataille.

Le porte drapeau de la paroisse de La
Verrie. Soldat Vendéen.
A la sortie du bourg de Torfou en direction de l’Est, les soldats bleus
se sont divisés en trois formations de combat :- 1° un bataillon vers le
Nord-Est en direction approximativement du lieu dit La Fontaine, - 2° les
grenadiers sous les ordres de Bouin-Marigny vers le Sud-Est en direction de la
Barre - et 3° l’infanterie commandée par Kléber lui-même, au centre par le Bas-Bourg.
Les grenadiers sont les premiers à rencontrer les maraichins de
Charrette. Ils les ont déjà délogés de Torfou et ceux-ci sont impressionnés par
la tenue et la discipline de cette armée qui avance en ligne et que rien ne
semble pourvoir dévier de son objectif. Il faut dire que jusqu'à présent ils
avaient surtout rencontré des soldats issus pour la plupart de la levée en
masse, sans véritable expérience militaire. Ces jeunes gens étaient surtout
différents d’eux parce qu’ils s’étaient soumis à la fameuse loi de levée en
masse, alors que cette dernière était responsable du déclenchement de la
rébellion dans l’Ouest. Les troupes de Charette fléchissent, reculent et se
sauvent.
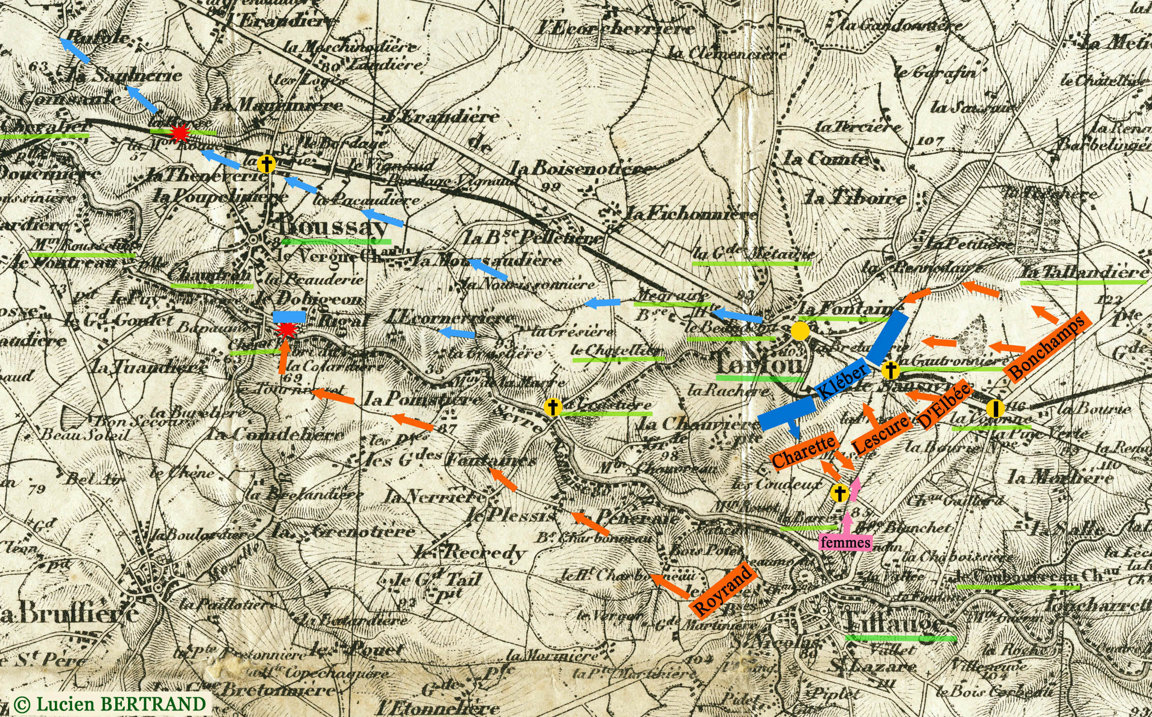
Plan de la Bataille de Torfou.
Les femmes des combattants (et parfois même leur famille), que nous
appellerons par simplification les Vendéennes alors qu’elles sont originaires
de tous les départements de la Vendée Militaire, sont restées en prières à
l’arrière. Certaines se sont mises à l’abri dans l’enceinte du château féodal
de Tiffauges. D’autres sont présentes dans les rues de Tiffauges ou sur la
route. Les plus hardies se sont avancées jusqu’à la chapelle Saint-Julien près
de la Sèvre et même dans un chemin du vallon de la Barre tout près de la ligne
de front. Cette petite route, « le chemin du pâtis » est souvent
appelé aujourd’hui « la route des Femmes ». Placées à cet endroit,
elles voient soudain venir en courant des petits garçons épouvantés précédant
de peu des hommes en fuite qui arrivent en criant « sauve qui peut ».

Le château féodal de Tiffauges.
Profondément choquées, les femmes s’empressent spontanément de leur
barrer la route, les insultent copieusement : « lâches..., gredins..., soldats de deux sous... ». Elles
les convainquent de repartir au combat, au besoin les frappent avec des fourches,
des bâtons, des cailloux ou leurs sabots. Louis Brochet dans son ouvrage cite
« la mère Giraudelle » (Jeanne Giraudeau) de Montaigu, comme étant
particulièrement virulente. C’est précisément cet épisode qu’Alfred du
Chasteignier a représenté dans son tableau consacré à la bataille de Torfou, et
qui est reproduit ci-dessous. Certaines femmes vont même s’élancer pour
participer au combat. Perrine Loyseau de la Gaubretière abat trois Bleus à l’aide
d’un sabre dont elle vient de s’emparer. Les hommes, penauds, s’arrêtent et commencent
à rebrousser chemin. Charrette a vu la scène, il accourt à cheval et
s’adressant à ses hommes leur crie « Qui
m’aime me suive, puisque vous m’abandonnez, je vais moi-même vaincre ou
mourir ». Les fuyards repartent immédiatement rejoindre leurs
compagnons qui résistaient encore.

La bataille de Torfou, tableau
d’Alfred du Chasteignier.
Pendant ce temps là, au centre, l’infanterie s’est avancée vers l’Est
en direction de la Gautronnière en suivant globalement l’ancien chemin. Elle ne
dépassera jamais le niveau du lieu-dit La Frogerie. En effet, elle vient de
rencontrer l’armée du généralissime d’Elbée. C’est à ce moment que Kléber se
rend compte, avec surprise, qu’il est en face de plusieurs armées Vendéennes et
que la journée ne sera pas une simple promenade militaire. Il a d’ailleurs été
blessé d’un coup de feu assez tôt et malgré son épaule fracassée, il est resté
diriger les opérations. Les Mayençais en rangs serrés chargent à la baïonnette
et enfoncent assez facilement les groupes de paysans. Lescure, voyant le danger,
descend de son cheval et saisissant un fusil s’écrie avec bravoure « Y a-t-il quatre cents hommes de bonne
volonté pour mourir avec moi ». Mille sept cents se seraient présentés
immédiatement, originaires de Courlay, Les Aubiers, Yzernay et Les Echaubrognes.
Le capitaine Jean Bourasseau lui répond : « Allez, Monsieur le Marquis, nous vous suivrons où vous
voudrez ». Ils se forment en colonne et s’élancent à l’assaut des Bleus
en poussant leur célèbre cri de guerre « Rembarre ».
Ils vont tenir ainsi pendant deux heures ce choc terrifiant. Ce qui fera dire à
Kléber, avec son accent alsacien : « Tiaple,
ces prigands se pattent pien ».

Charrette d’après le tableau de
J-Be Paulin-Guérin (1827). Maurice Gigost d’Elbée d’après le tableau de J-B
Paulin-Guérin (1827). »
Bonchamps, par la route de Cholet et de La Romagne arrive maintenant
sur le champ de bataille avec son armée. Grièvement blessé, il est porté par
ses hommes sur une civière mais il tient, comme Kléber, à rester à son poste et
à diriger la manœuvre. Très loin de combattre en ligne, ses soldats se
dispersent sur le terrain en un apparent désordre pour se regrouper brusquement
au moment de l’attaque. Bonchamps est à la recherche d’un chemin, celui
provenant de la Tallandière, pour envoyer une partie de ses hommes tourner les Bleus
sur leur flanc gauche et couper leurs lignes. La fougue de ces troupes fraîches,
arrivant dans une bataille déjà très éprouvante, déstabilise les Mayençais qui
fléchissent devant elles.
Kléber lui-même raconte la suite des événements dans son rapport
adressé à la convention nationale : « …à
peine la fusillade se fit-elle entendre sur nos derrières que tous les yeux se
dirigèrent de ce côté et que quelques voix s’écrièrent « nous sommes
coupés ! ». Ce fut dans cet instant que Boisgérard, le chef d’état
major, s’apercevant que l’artillerie n’était pas assez couverte, voulut
disposer d’un des bataillons de la droite, qu’il voyait n’être point occupé. Ce
bataillon se mit en mouvement pour se porter en arrière ; mais avec trop
de précipitation sans doute, puisque son mouvement fit croire qu’il se
retirait. Il ne fut que trop suivi. Ce fut en vain que les braves s’efforcèrent
de faire rester chacun à son poste, rien ne put arrêter le désordre…».
La décision de déplacer une division du sud pour l’envoyer renforcer
celles du nord est militairement judicieuse, mais à ce moment-là elle est mal
interprétée par les autres bataillons qui pensent qu’il s’agit là des prémices
de la retraite. D’autant que les soldats sont découragés car toutes leurs farouches
attaques se heurtent à la détermination des Vendéens qui sont de plus en plus
maîtres du terrain. Malgré des prodiges de valeur et de ténacité, les Mayençais,
débordés par le nombre, fléchissent. Les exhortations du conventionnel Merlin
(dit de Thionville), représentant du peuple en mission, ne les empêchent pas de
reculer. Kléber écrira également dans son rapport à la convention
nationale : « Jamais on ne
vit un combat, un acharnement plus terrible, les rebelles combattaient comme
des tigres et mes soldats comme des lions ! ». Il vient de
comprendre qu’il a désormais peu de chance de remporter la victoire mais qu’il
lui faut avant tout sauver son armée. La certitude de remporter une victoire sur
ces groupes de paysans était telle que le désarroi est immense dans le camp des
dirigeants républicains. Certains officiers désappointés et de peur de tomber
aux mains des « Brigands », préfèrent se brûler la cervelle. Les
Mayençais, tout en se défendant, retraversent Torfou en flammes et se déplacent
en assez bon ordre vers Boussay. « Malgré
l’extrême difficulté des chemins et le nombre toujours croissant de leurs
ennemis, ils se remettaient en bataille et reculaient successivement de trente
en trente pas, faisant des feux de file semblables aux roulements de
tambours. ». L’armée laisse en fait beaucoup de morts sur le terrain.

La croix de la Barre. La croix de la Gautronnière.
Les pertes humaines pour la totalité de l’affrontement dit de Torfou
(retraite comprise), estimées à 4000 personnes au XIXème siècle, sont
évaluées plus raisonnablement, à notre époque, à environ 1000 hommes pour les Bleus
morts et grièvement blessés, soit la moitié des effectifs engagés et à 600 pour
les Vendéens. Avant de poursuivre les évènements de la journée, nous ne
quittons pas Torfou sans avoir observé les deux calvaires implantés sur les
lieux mêmes des combats (cf. photos ci-dessus) :
Le
calvaire au lieu-dit La Barre (dit « croix des Blancs ») a été élevé
en 1839 par la famille Grimaud pour commémorer les combats sanglants de la
bataille de Torfou et les massacres de 1794. L’inscription suivante est gravée
sur le montant de la croix : « 1839/
GRI/ MA/ UD / ». Il a été béni en 1840 par l’abbé Charles
Foyer curé de Torfou et lui-même rescapé de cette bataille.
Le
calvaire au lieu-dit La Gautronnière (dit « croix des Bleus ») a été
érigé en 1837 par Pierre Rautureau, à côté des charniers où ont été déposés les
soldats républicains morts en septembre 1793. Pierre Rautureau avait eu la
chance rare d’être épargné par ces derniers.

Place de Torfou devant la chapelle
Notre-Dame de Lourdes en 1905.
Cette magnifique carte postale, très animée, nous montre une place de
Torfou où se situe la chapelle Notre-Dame de Lourdes. On en aperçoit le côté à
droite du cliché. Cet édifice a été construit par l’abbé Béziau curé de Torfou,
grâce à des dons, pour plusieurs raisons et en particulier pour servir
d’ossuaire aux victimes Vendéennes de la révolution. Il s’agit surtout de
victimes des colonnes infernales en 1794, mais aussi de quelques soldats de la
bataille de 1793. Elle a été consacrée le Lundi de Pâques 14 avril 1879 par le Révérend
Père Abbé de Bellefontaine.
2°- L’Armée du Centre :
Pendant la durée de la bataille, Royrand avec une partie de l’Armée du
Centre avait été tenu en réserve près de la route à proximité du bourg de
Tiffauges, pour pouvoir intervenir en cas d'arrivée de renforts républicains
venus de Montaigu. Et il tardait à ses hommes de se rendre utiles. Certains
historiens douteraient parfois de la présence personnelle de Royrand à Torfou,
mais l'Armée du Centre était de toute façon représentée à cette bataille.
Amédée de Béjarry officier de l’armée de Royrand et donc témoin
oculaire écrit dans ses Mémoires : « M de Royrand et une partie de l’armée du centre se portèrent
rapidement, par la rive gauche de la Sèvre, vers le pont de Boussay, afin de
couper aux républicains la retraite vers Clisson. L’armée de Kléber eût été
anéantie par ce mouvement, si ce général n’avait trouvé dans le bataillon qu’il
s’était hâté d’y envoyer un chef, Schwardin, qui combattit jusqu’au dernier
homme et qui par son dévoûement, sauva le reste de l’armée ». Évidemment c’est le fils d’Amédée de Béjarry qui écrit et son petit-fils qui
publie en 1884, mais c’est conformément aux notes laissées par le père. De plus,
nous avons personnellement parfois trouvé Amédée de Béjarry peu précis en ce
qui concerne les lieux-dits mais nous ne l’avons jamais encore pris en défaut
sur la stratégie générale. En outre, ce qu’il nous explique est parfaitement logique.
Pour pouvoir tomber sur les arrières des Républicains, l’armée de Royrand
devait les contourner en passant par la rive gauche de la Sèvre puis traverser
la Sèvre pour arriver devant eux. Il leur fallait donc trouver un passage sur
la rivière à la hauteur de Boussay, et bien au-delà de la Grossière. C’était
une stratégie identique à celle que venait de tenter Bonchamps à l’autre bout
du champ de bataille. N'oublions pas que les Vendéens avaient sur les
Républicains l'avantage de pouvoir disposer de guides connaissant bien les
lieux.
Les écrits de plusieurs historiens à partir du XIXème siècle
laissent penser que le sacrifice de Chevardin pourrait avoir eu lieu plutôt en
direction de Gétigné : Pitre-Chevalier en 1851, Louis Brochet en 1902 et
Emile Gabory en 1963 par exemple. En revanche la version de Béjarry est sous
entendue chez Beauchamp en 1807, Crétineau-Joly en 1840 et plus près de nous,
elle est très clairement adoptée par l’abbé Billaud en 1967 et notre ami Philbert
Doré-Graslin en 1992, par exemple.

Le pont actuel de Boussay dit Sainte-Radegonde.
Amédée de Béjarry parle « du » pont de Boussay, mais il ne
s’agit évidemment pas du pont actuel, dit Sainte-Radegonde, qui est visible sur
la photo ci-dessus. Cet ouvrage d’art avec quatre arches en pierres a été
édifié en 1858, en même temps que les nouvelles voiries.

Le Pont de Boussay sur l’Album
Vendéen.
Il aurait alors pu s’agir de celui qui est représenté sur la gravure
ci-dessus extraite du célèbre et précieux « Album Vendéen »
(1856) ; Mais, il n’en est rien car, Thomas Drake a fait figurer un petit
pont conduisant de la rive droite (côté Boussay) à un moulin situé sur une
petite île ; mais ne traversant pas toute la rivière (à l’image du pont
d’Avignon). Cette disposition ne se retrouve exactement qu’au lieu-dit Feuillou
à un kilomètre environ en amont. D’ailleurs, la disposition des maisons
construites aux alentours le confirme totalement. Il est donc probable de Drake
a recherché un point de vue artistique pouvant fournir une image esthétique
plus que la rigueur historique. On notera au passage que le moulin et les maisons
visibles sur le croquis sont tous représentés à l’état de ruines. C’est sans
doute pour faire « authentique » car cela ne devait plus être le cas
vers 1850.

La Sèvre au moulin de Charrier.
Il existait bien un petit pont ou une passerelle en bois au lieu dit
Charrier à 300 mètres
en amont du pont actuel. La carte de Cassini (vers 1760) ne l’indique pas, mais
c’est normal, puisque ce dernier ne fait jamais figurer les chemins mais
seulement les routes principales, et donc pas non plus les petits ponts sur les
dits chemins.
 Extrait de la carte de Cassini 1760.
Extrait de la carte de Cassini 1760.
De grosses pierres apparaissent encore aujourd’hui en ce lieu dans la
rivière, mais ce n’est peut-être pas une preuve suffisante car on en trouve un
peu partout dans la Sèvre, qui est même appelée « rivière de
pierres » en plusieurs endroits, en particulier à Mortagne-sur-Sèvre
et tout près d’ici à Chaudron. En revanche, sur les cartes postales anciennes
datant de 1905 environ, l’alignement des piles du pont passerelle est
parfaitement visible, sans ambiguïté, dans la rivière (cf. carte ci-dessous).

L’ancien pont de Charrier vu du
pont Sainte-Radegonde.
Ce pont figure bien sur le cadastre dit napoléonien de la commune de
Boussay mais on le devine seulement sur celui de La Bruffière, de l’autre côté.
Or le cadastre était un document dont l’objectif était de représenter les
parcelles pour des raisons fiscales. Les voiries en limite de carte (sur les
rivières limitrophes par exemple) n’y étaient pas toujours dessinées. Si ce
cadastre a la plupart du temps été effectivement établi sous la Restauration ou
le règne de Louis-Philippe, comme à La Bruffière (1819), à Boussay par contre, il
date de 1809. Il est donc peu probable que durant cette période (de 1794 à
1808) où tout était à reconstruire, on ait eu le temps et l’argent pour créer
des ouvrages nouveaux. On pourrait donc en déduire qu’un petit pont, ou une
passerelle en bois, existait bien à Boussay au XVIIIème siècle. S’il
y en avait assez peu à cette date, au siècle suivant par contre, on en a multiplié
le nombre sur la Sèvre, pratiquement à tous les moulins pour faciliter l’activité
économique de ces derniers (Feuillou, et Chaudron par exemple). D’ailleurs le
dessin du pont de Charrier sur le cadastre est complètement différent de ceux des
autres passages et permet de le différencier des barrages (Bapaume) et des chaussées
avec gué (Chaudron, Dobigeon, Feuillou) relevant des moulins à eau. On ne
manquera pas de remarquer sur l’assemblage des deux cadastres ci-dessous qu’à La
Bruffière on a esquissé sur l’original le projet de tracé de la nouvelle voirie
en direction du pont Sainte-Radegonde.
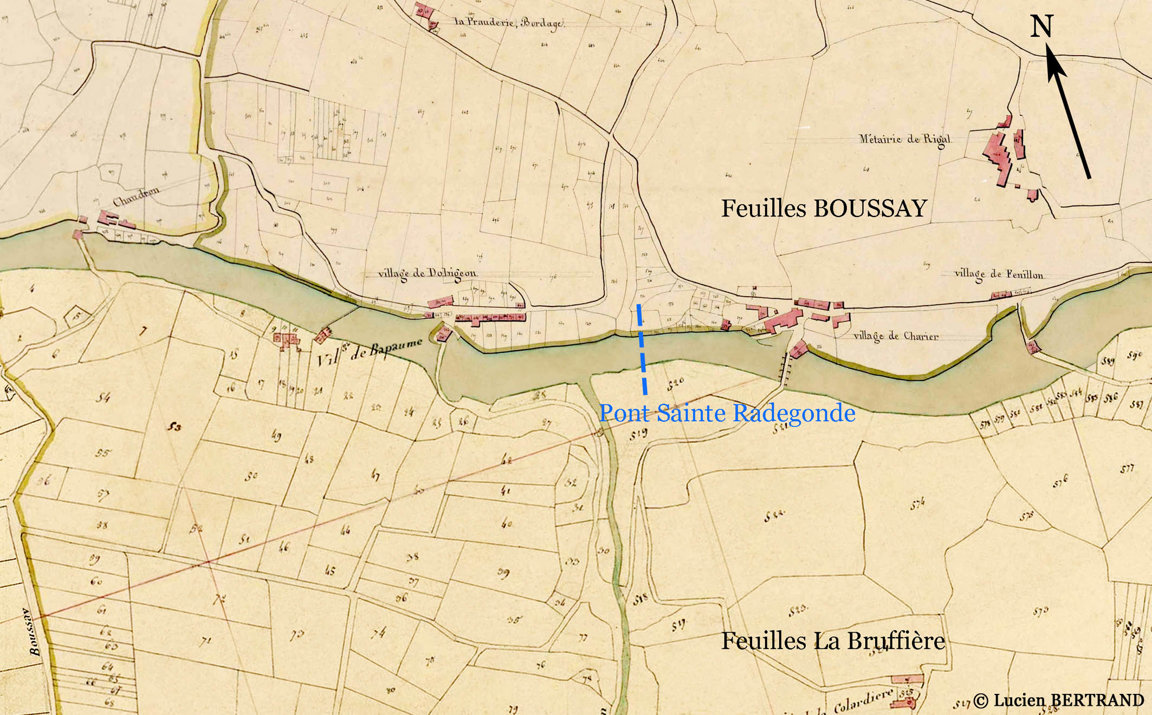
Assemblage d’extraits des cadastres
de Boussay et de La Bruffière.
Kléber, là où il est
venu se placer un instant au début de la retraite, sur une partie élevée au
lieu-dit Le Châtelier, a naturellement eu la possibilité (avec sa longue vue)
d’apercevoir les Vendéens marchant à pas pressés sur le chemin de l’autre côté
de la rivière. Si Royrand avait réussi sa manœuvre, il aurait pu ainsi encercler
l’armée adverse, la mettre en péril, et lui couper toute possibilité de repli
stratégique en direction de Clisson. C'est-à-dire remporter une victoire
complète alors que la bataille de Torfou est souvent qualifiée de « victoire en
demi-teinte ». De ce fait, c’est bien ici, et à ce moment là, que Kléber devait
impérativement « sauver » son armée à n’importe quel prix. Ensuite, lors
de la déroute, à chaque passage de pont, il lui faudra seulement retarder
les poursuivants pour « protéger » l’armée dans sa fuite. Il est donc
plus que probable que c’est à cet endroit qu’il a envoyé un de ses officiers
défendre à tout prix ce passage avec un bataillon de 100 hommes, Antoine Chevardin
(Schwardin) lieutenant-colonel aux chasseurs de Saône, par exemple, ou un autre.

Le chemin emprunté par les soldats de
l'Armée du Centre à la Bruffière.
La phrase célèbre « Faites-vous tuer à la tête de ce pont
avec votre bataillon et sauvez l’armée » a-t-elle bien été prononcée ?
Il y avait peu de témoins pour l’entendre et Kléber lui-même n’en parle pas clairement
dans ses mémoires ! Il est probable qu’elle a été inventée postérieurement
comme certaines des phrases historiques célèbres telles que celle attribuée à
Cambronne lors de la bataille de Waterloo en 1815 : « La garde meurt mais ne se rend pas ». A la fin de cette
guerre, la convention nationale allait transformer ses soldats en instruments
pour ses crimes contre l’humanité, elle avait donc terriblement besoin de
véritables héros à mettre en exergue, quitte à arranger un peu la vérité. De
toute façon, cette phrase a au moins le mérite de résumer parfaitement la
situation.
En tous cas, les combats
au passage de Boussay ont bien été particulièrement violents. Nous savons par
ailleurs que des soldats de notre contrée y sont morts ou blessés. Quelqu’un
que nous connaissons bien, pour l’avoir rencontré par ailleurs et parce que
c’est l’ancêtre d’un de nos amis, Louis-Ambroise Barreau capitaine de paroisse
de Sainte Cécile (Vendée) y a été très grièvement blessé. Il a été sauvé par
ses hommes qui l’ont ramené chez lui au village des Chaffauds, où il est mort
(mais seulement 38 ans plus tard le 30 juillet 1831 !).
La bonne question qu’il
convient de se poser est de savoir ce qu’a bien pu faire ensuite Royrand avec
une partie de l’armée du Centre, après avoir été bloqué à la Sèvre, on ne nous
le dit nulle part ! Est-il revenu sur ses pas jusqu'à Tiffauges pour
retourner ensuite à la bataille vers Torfou ? C’est fort peu probable, car
il serait arrivé trop tard. A-t-il au contraire essayé de trouver des passages possibles
sur les gués voisins, ou suivi la Sèvre plus loin, vers le lieu dit Rousselin ou
beaucoup plus loin encore au village de Chevalier ?
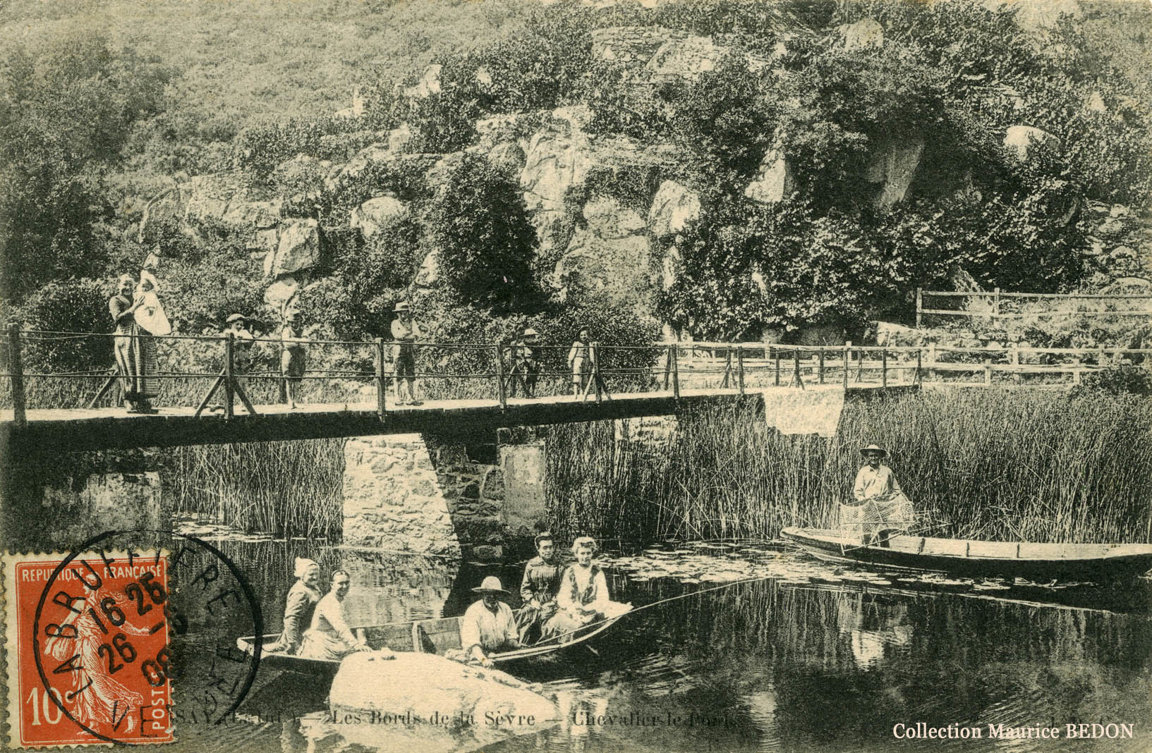
Le petit pont de Chevalier vers 1905.
Nous sommes personnellement
tenté de penser, qu’après avoir défendu le passage pendant plus d’une heure, au
moment de la retraite, alors que l’armée était désormais parvenue au niveau de
l’aval de ce lieu, les très rares soldats républicains survivants auraient pu
abandonner le pont dont la défense n’était désormais plus vraiment utile.
Royrand aurait alors pu passer pour se joindre aux autres armées harcelant les Bleus
dans leur retraite. Nous savons en effet, par des souvenirs, que plusieurs
soldats de l’armée du Centre y ont participé activement.

Les Grottes de Sœur Hélène à Boussay.
Dans la légende de la
carte postale ci-dessus (N° 22, début de l’année 1903), le célèbre photographe
local Eugène Poupin de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée) se fait l’interprète des
traditions locales en racontant qu’une religieuse se serait cachée pendant
toute la Révolution Française dans les grottes de la falaise de Boussay à
Chaudron. Or, ce lieu-dit est distant de moins d’un kilomètre de Charrier,
c’est le moulin suivant en allant vers l’aval de la rivière. Cette religieuse
aurait soigné des blessés issus des deux camps, restés sur le terrain. Pourtant,
le règlement de l’Armée du Centre prévoyait, en principe, que les soldats
auraient dû être transportés à son hôpital de campagne le plus proche, c’est à
dire à Saint Laurent-sur-Sèvre. Ainsi, cette tradition du cru vient ajouter du
crédit à la thèse de violents combats survenus à proximité, au bord de la
Sèvre.
Le même Eugène Poupin a
placé l’épisode de Chevardin et du pont de Boussay dans la légende d’une autre de
ses très nombreuses cartes postales (N° 331), réalisée à la fin de l’année 1903.
Cette dernière représente un minuscule pont rustique traversant un petit
ruisseau dans la commune de Boussay sur la rive droite de la Sèvre. Cet endroit
était en fait situé à la limite du périmètre de la bataille et se trouve
aujourd’hui sur le sentier de randonnée aménagé parallèlement à la Sèvre, dit
« des Trois Provinces ».
Et curieusement, il
reparle du même épisode dans la légende d’une autre de ses cartes postales
consacré à la croix du Chemin des Morts dont nous reparlerons plus loin. Cet
autre cliché a été photographié le même jour que le précédent puisqu’il porte
le numéro juste suivant (N° 332).
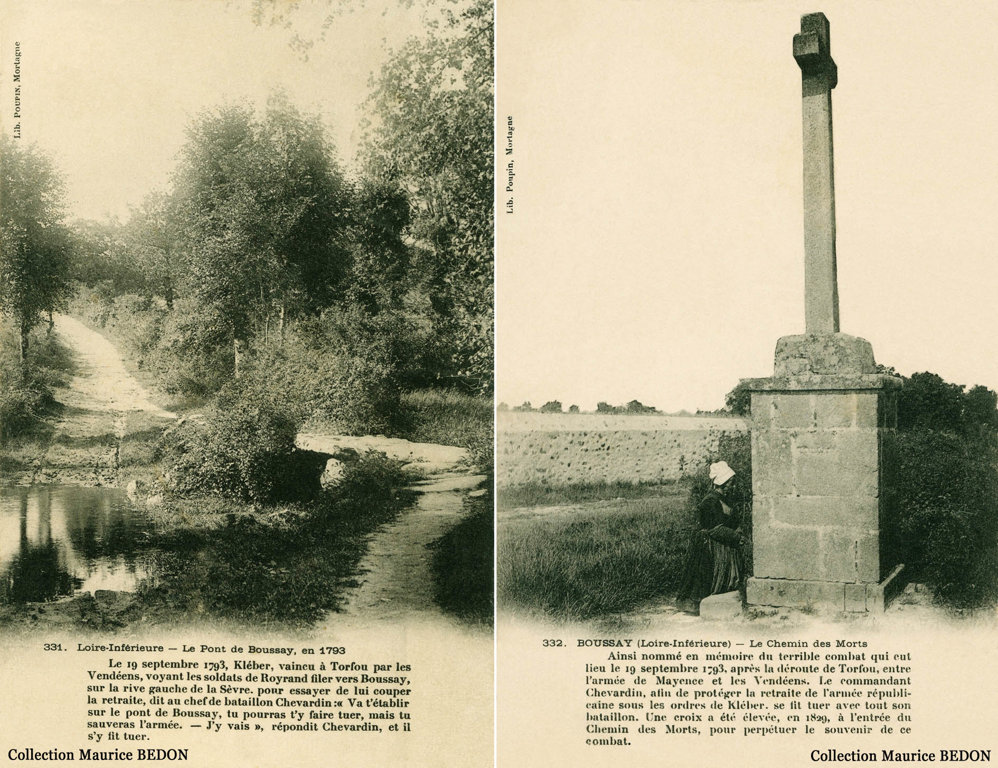
Petit pont du sentier. Croix du chemin des morts.
3°- La Retraite :
Après cette digression,
nous allons maintenant retrouver Jean-Baptiste Kléber qui vient d’abandonner
son poste d’observation près du Châtelier pour diriger la retraite de son
armée, ou tout au moins de ce qu’il en reste, en direction de Gétigné. On peut
lire la suite du récit dans son même rapport : « Quant à nos quatre pièces de canon, il parut impossible, au
premier coup d’œil, de les faire rétrograder dans les défilés horribles qui
conduisent à Torfou : cependant, chacun mettant la main à l’œuvre, elles
furent conduites encore assez loin ; mais, un caisson de la tête venant à
se briser, tout resta en stagnation jusqu'à ce que le général en chef, prévenu
par des ordonnances envoyés successivement par Merlin et par moi, vint nous
porter un renfort…. ».
Avec prudence, il essaye
visiblement de faire croire aux conventionnels que l’artillerie, abandonnée sur
place (vers la Maigrière) a été sauvée, alors qu’il n’en est rien. Il est
constamment harcelé par les Vendéens qui sont aux trousses de son armée, d’un
côté ou de l’autre. Peu à peu, il est contraint d’abandonner ses charriots de
bagages, de vivres et de réserve de munitions. Le repli stratégique est devenu
successivement, une retraite puis une déroute, elle va finir comme une débâcle.
A défaut d’utiliser uniquement l’ancien chemin, il en suit au moins largement
la direction. Et de ce fait, à chaque fois qu’il va falloir franchir un
ruisseau quelconque à l’aide d’un pont ou d’un passage, cela va provoquer un
goulet d’étranglement. Et certains de ses soldats vont encore devoir se sacrifier
pour permettre à leurs camarades de passer sans trop de difficultés.
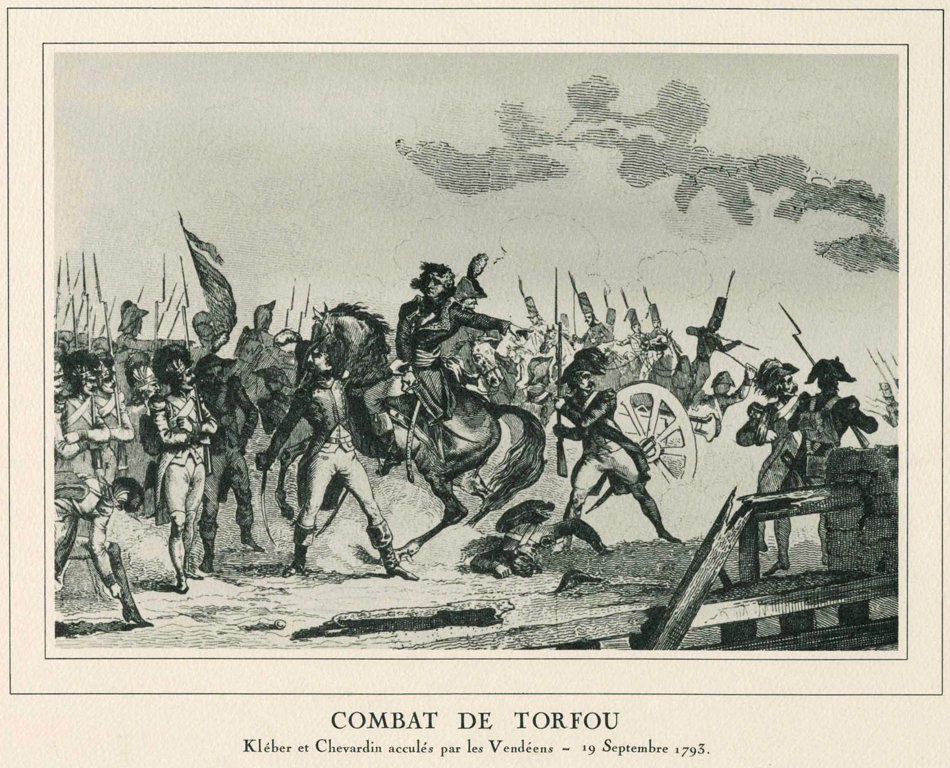
Kléber lors de la retraite de Torfou.
Le cas va surgir très
rapidement à 1 kilomètre
500 après la sortie du bourg de Boussay, juste après les villages de La Herse et
de Maison-Rouge pour la traversée du ruisseau. Il ne s’agit pourtant que d’un
bien modeste cours d’eau et d’un vallon pas très profond. Le petit pont actuel
ne comporte qu'une très modeste arche. Et nous sommes alors à la fin de l’été,
c'est-à-dire globalement en période de basses eaux malgré les pluies des
jours précédents! Les maraichins de l’Armée de Charrette, avec une
« pigouille », ont l’habitude de franchir des fossés autrement plus
larges ! Comment Kléber aurait-il pu laisser deux canons en batterie à cet
endroit alors que nous venons d’apprendre qu’à ce moment il a déjà dû
abandonner son artillerie ? En tous cas, la traversée retarde l’armée et
la rend vulnérable aux coups de ses adversaires, il faut donc retenir les
Vendéens pendant toute la durée de l’opération. Des sacrifices, comme celui
attribué à Chevardin, sont encore necessaires à cet endroit. Cette escarmouche
ajoute donc de nouveaux morts au bilan de cette journée. Ils s’égrainent tout
au long de la route de Torfou, Boussay, Gétigné qui est baptisée, de ce fait,
« chemin des morts ».

Le site du petit pont de la Herse à
Boussay.
En 1829, on a implanté
une nouvelle croix (dite « des morts ») sur une base de calvaire
beaucoup plus ancienne, située au carrefour avec la rue actuelle conduisant à
la gare de Boussay. Nous avons vu tout à
l’heure qu’Eugène Poupin était venu la photographier en 1903, le même jour que
le sentier des Trois Provinces et y avait raconté une seconde fois la même
histoire de Chevardin. En 1997, l’association le Souvenir Vendéen, présidée
alors par Emmanuel Catta, y a fait apposer une plaque portant l’inscription
suivante :
« Croix de la Morinière / Restaurée en
1829 sur le chemin dit des Morts / Le 19 septembre 1793, à Boussay, le long du
grand chemin / de Nantes à Poitiers, au soir de la victoire Vendéenne / de
Torfou, Républicains dits Mayençais et Vendéens s’affrontent / Le général Kléber
ordonne à Antoine Chevardin, chef du / Bataillon de Saône-et-Loire et à ses
chasseurs de retenir / la poussée Vendéenne. Leur mort, qui épargne du désastre
humain, a lieu sur le dit / grand chemin au pont de la Herse / S.V 1997 / ».
Il s’agit là d’une autre
interprétation des mêmes évènements !

Le calvaire dit de la Morinière. La plaque du calvaire.
Les Vendéens vont
continuer à poursuivre les Mayençais depuis Torfou jusqu’à Gétigné, soit sur
une distance de 4 lieues (16 km). Un nouvel affrontement a encore lieu au
moment du franchissement d’une petite rivière avant l’arrivée au bourg. Des
boutons provenant de l’uniforme de soldats républicains ont d’ailleurs été
trouvés à cet endroit.
A Gétigné, Kléber,
craignant d’être totalement débordé, va installer ses troupes sur les hauteurs
de la Garenne. Il y est rejoint par son collègue Louis-Antoine Vimeux avec des
renforts dont Kléber avait adressé la demande à son supérieur Aubert-Dubayer. Une
attaque serait de ce fait beaucoup plus hasardeuse. Charrette voudrait pourtant
attaquer sans tarder mais ses hommes ont déjà commencé à fêter leur victoire en
vidant les caves rencontrées. Ils ironisent déjà : « Ah, bah, ça ne vaut rien cette armée de faïence, ça ne tient pas
au feu ». Les Vendéens tardent ainsi à attaquer et quand les premiers
s’y risquent, ils se font refouler. Ils s’en tiendront là et vont simplement abandonner
la poursuite. La bataille de Torfou est terminée.

Vue générale de Gétigné vers 1905.
4° - Les Commémorations :
Après la révolution, à
l’époque de la Restauration, Arnaud-Michel Jousseaume marquis de la Bretesche,
conseiller général de Maine-et-Loire, officier de Saint Louis et ancien chef de
la division Vendéenne de Montfaucon décida d’élever un monument en souvenir de
la bataille de Torfou. Il avait prévu de le placer dans un endroit bien
visible : le carrefour prévu de la route Clisson, Torfou, Mortagne
(actuelle RD 949) avec celle de Montaigu, Tiffauges, Cholet (actuelle RD 753).
D’autant plus que cet endroit se situait dans le périmètre de la bataille et
touchait le départ de l’allée d’arbres conduisant à son château de Couboureau.

Le château du Couboureau
reconstruit au XIXème siècle après l’incendie de 1794.
La première pierre du
monument a été posée le mardi 19 septembre 1826 (jour du 33ème
anniversaire de la bataille de Torfou) par l’épouse du propriétaire Appolonie
d’Andigné marquise de la Bretesche, en présence de M. de Chantreau Sous-préfet
de Cholet, des Maires et Curés des environs ainsi que des anciens officiers et
combattants des armées Vendéennes de 1793. On notait la présence du comte de
Mesnard, premier écuyer de S.A.R. Madame. Marie-Caroline de Bourbon des Deux-Siciles
duchesse de Berry, belle-fille du roy Charles X, n’avait pu être présente ;
elle viendra ensuite séjourner au château de Couboureau le 6 juillet 1828.
L’édifice, couramment
baptisé « colonne », est en fait un cippe, c'est-à-dire une sorte de
stèle funéraire destinée à rendre hommage aux Vendéens qui sont morts en se
couvrant de gloire à cet endroit. C’est un cylindre en blocs de granit de 8,65
mètres de haut et 1,30
mètre de diamètre posé sur un socle rond de 5 mètres de
diamètre, comprenant quatre contreforts enserrant des bancs en pierre.
« La colonne »
a été terminée en 1827. Initialement, il aurait été prévu des grands bas-reliefs
en bronze représentant la bataille, mais ils n’auraient jamais été réalisés. Malheureusement
juste après 1830, la chute du roy Charles X et le début de la Monarchie de
Juillet, le nouveau Préfet de Maine-et-Loire envisagea de la détruire. Son
collègue de Vendée avait les mêmes projets pour la Chapelle du Mont des
Alouettes et la petite pyramide des Quatre-chemins de L’Oie. Finalement le
Préfet se contenta de faire retirer et détruire les plaques de bronze avec les
noms des généraux, les couronnes de lauriers ainsi que la couronne royale avec
la fleur de lys. On aperçoit encore au niveau du couronnement deux rangées de
trous de fixation. On ne manquera pas de remarquer également sur la carte
postale ci-dessous les panneaux routiers en bois fixés directement sur la
colonne à mi-hauteur à la fin du XIXème siècle.

La Colonne de Torfou vers 1903. Une des deux nouvelles plaques (1975).
En 1975 le Souvenir
Vendéen, présidé alors par Jean Lauprêtre, a fait poser deux nouvelles plaques
de bronze, placées à 180 degrés l’une de l’autre, dans la partie basse de la
colonne. L’une porte l’inscription « Bataille de Torfou / 19 septembre
1793 » et l’autre les noms des cinq généraux Vendéens présents : « D’Elbée, Bonchamps, Charrette,
Lescure, Royrand ».
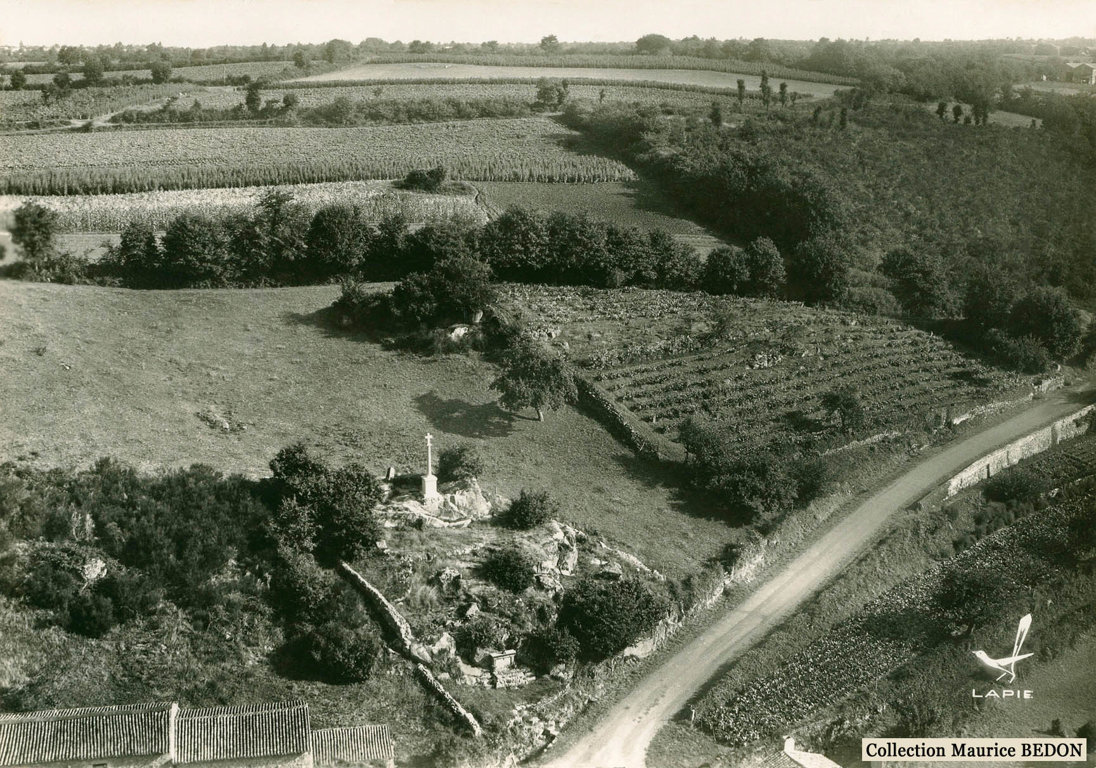
Le site de la Grossière, le calvaire
et l’autel.
La même association
avait réalisé précédemment un monument plus spectaculaire, à l’époque de la
présidence de son fondateur le docteur Charles Coubard : un calvaire et un
autel de pierre au lieu dit la Grossière. C’est en effet, à cet emplacement que
se situe le point triple où les départements de la Vendée, du Maine-et-Loire et
de la Loire-Atlantique se joignent. Et c’était déjà le cas avant la Révolution
avec les provinces du Poitou, de l’Anjou et de la Bretagne. C’est la raison
pour laquelle cette croix a été baptisée : « calvaire des trois
provinces ». Sur la croix, on peut lire sous un double cœur vendéen « J’ai combattu le bon combat / j’ai
gardé la foi ». Plus bas, sur la base de l’autel, une plaque porte
l’inscription suivante, sous le Sacré-Cœur : « Ici se joignent / les trois provinces / Anjou Bretagne Poitou /
d’où a pris naissance en 1793 / la Vendée Militaire / SV 1959 ».
Ce calvaire a été
inauguré le Dimanche 27 septembre 1959 avec environ 2000 personnes et la présence
des Maires et Curés des communes de Torfou, Boussay et La Bruffière.
 Le calvaire des Trois provinces peu
après 1960. L'état actuel du calvaire.
Le calvaire des Trois provinces peu
après 1960. L'état actuel du calvaire.
Le jeudi 14 septembre
2017, en présence des élus municipaux et communautaires, Paul Gilbert Président
de l'Association "Connaissance de Torfou" a inauguré un circuit de
randonnée de 9 km concernant la bataille de Torfou. Ce circuit a été ouvert au
public deux jours plus tard, pour les Journées du Patrimoine 2017. Les premiers
adhérents de cette association : Daniel Bretaudeau, Constant Coulonnier,
Jean-Pierre Brochard, Gaby Fonteneau et Pascal Le Pourlier travaillaient sur ce
projet depuis trois ans et ont pu le mettre en place grâce à l’appui et à
l'aide financière des collectivités locales. Le parcours comprend 10 étapes
avec pour chacune un panneau explicatif, bien illustré et très didactique. Des
aspects ludiques séduiront sûrement les plus jeunes. Nous avons découvert ces
panneaux et les avons appréciés lors de notre récente visite sur les lieux. Il
serait évidemment souhaitable que des initiatives similaires permettent
d'élargir le circuit sur la commune de Boussay en Loire-Atlantique, partie
prenante dans la même bataille.

Le panneau N°2 du circuit de Torfou (illustré par Thomas Bonis).
Chantonnay
le 13 octobre 2017

LA PRISE DE
FONTENAY (25 mai 1793)
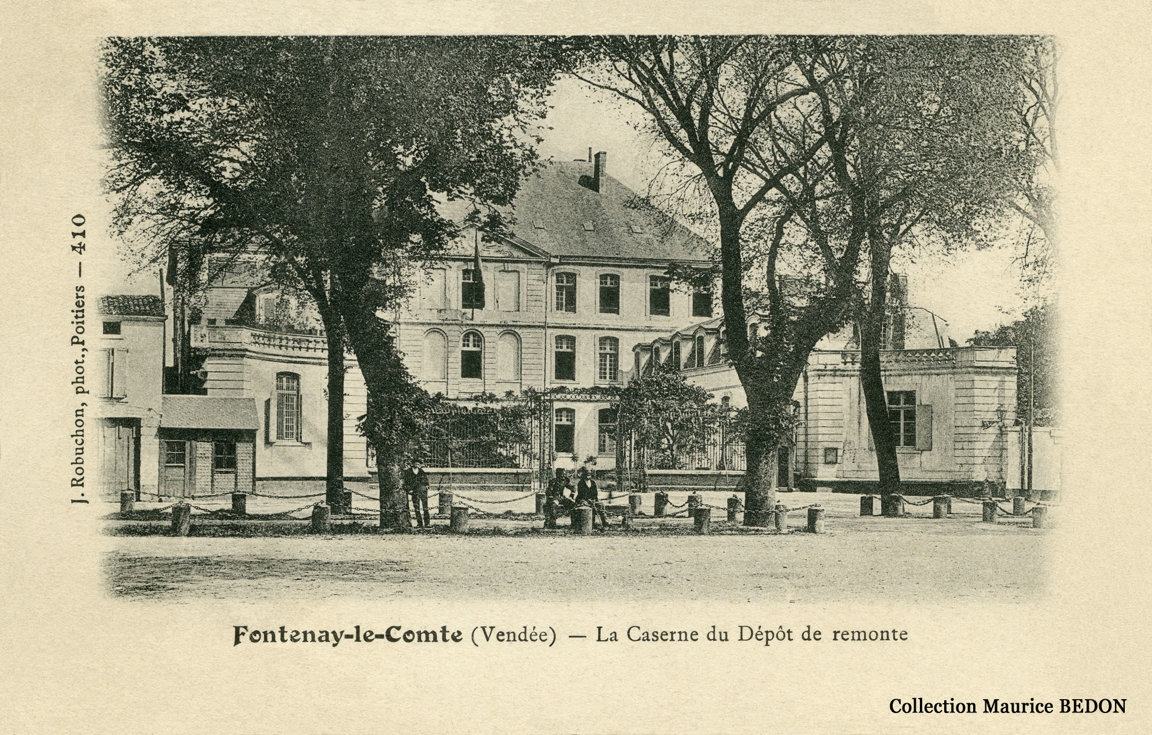
Fontenay : la caserne du XVIIIème siècle.
Avant la Révolution, Fontenay-le-Comte n’était pas « une ville de
garnison », selon le sens que l’on a donné à cette expression au XIXème
siècle. Les troupes étaient, à cette époque, principalement disposées de façon
à faire face aux attaques étrangères pouvant venir des côtes. Les régiments
d’infanterie de ligne (60ème, 77ème, 80ème) étaient
basés à Rochefort, Saint Jean d’Angély et dans les îles de Rhé ou d’Oléron,
sous les ordres du général de Verteuil. Toutefois, sous le règne de Louis XV
une caserne avait été construite dans la capitale du Bas-Poitou. La première
pierre en avait été posée le 1er août 1752 ; et les travaux,
conformément aux plans de l’ingénieur Parent de Curzon, avaient duré 15 ans.
Les hussards du Royal-Bourgogne en 1768 et les hussards de Bercheny en 1777 y
avaient tenu garnison. A partir de 1793, cette caserne va héberger les
différentes armées que la République va envoyer à Fontenay-le-Peuple. Elle
recevra ultérieurement le nom du général Belliard, officier fontenaisien et la
rue où elle se situe le nom de Kléber.
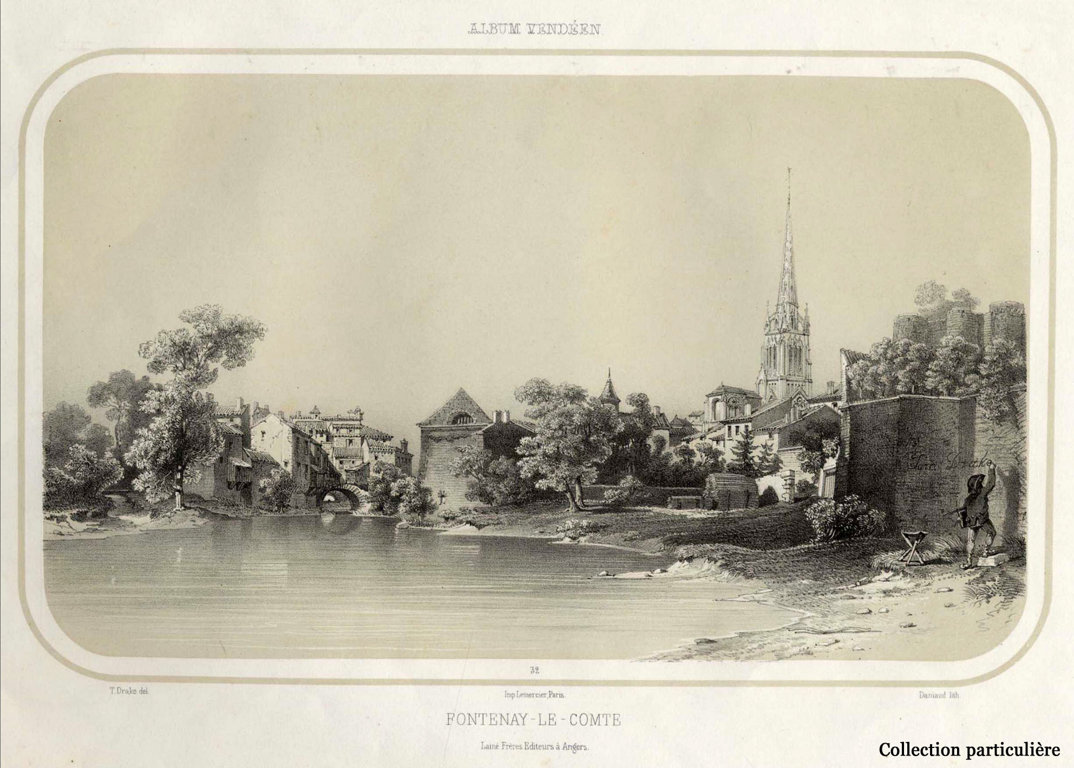
Fontenay-le-Comte : Gravure de l’Album Vendéen.
Dans l’ouvrage « l’Album Vendéen » en 1856, pour illustrer la
bataille de Fontenay, le dessinateur Thomas Drake a choisi, non pas de
représenter la bataille elle-même, mais d’évoquer la ville par une vue du vieux
Fontenay et en particulier du fleuve « la Vendée » à l'ancien pont
des sardines. On remarquera qu’il s’est dessiné lui-même en train de signer son
œuvre sur un mur près du château, à droite de la gravure. Cette lithogravure
nous présente par ailleurs une intéressante vue de la ville au milieu du XIXème
siècle à peu près identique à celle que vont trouver les Armées Vendéennes.
C’est le lendemain de la prise de Thouars (5 mai 1793) que les généraux
vendéens lors d’une réunion d’état-major, après avoir hésité sur le parti à
prendre (Saumur, Angers ou Tours) décident au préalable d’aller libérer le sud
vendéen de l’emprise de l’armée républicaine à Fontenay-le-Comte. Cette
décision n’est pas vraiment approuvée par de nombreux soldats qui préfèrent
rentrer chez eux pour se livrer aux travaux des champs.
Quand ils se mettent finalement en route, le 9 mai, il n’y a plus que
15000 hommes (sur les 25000 présents à Thouars).
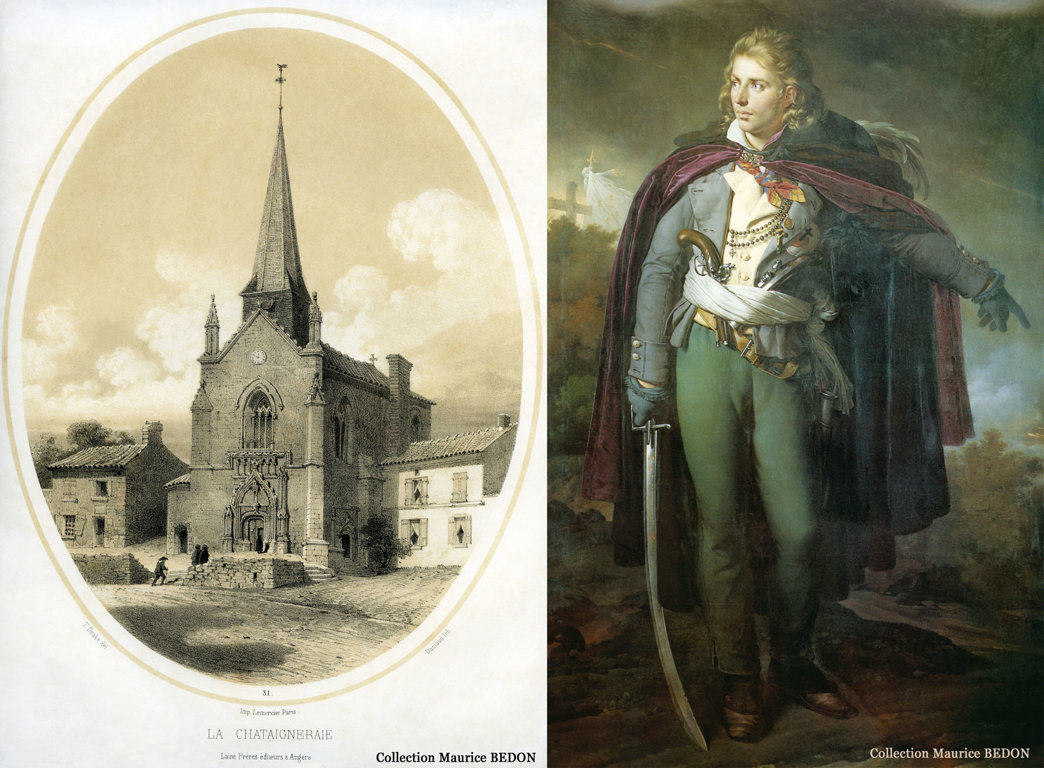
Le bourg et la vieille église de La
Chataigneraie, Montbail 1843. Jacques Cathelineau, tableau A-Louis Giraudet-Trioson 1816.
Pour s’emparer de Fontenay, en arrivant par le Nord, il fallait au
préalable se rendre maître de La Châtaigneraie. Or, le général Alexis Chalbos,
installé dans cette ville depuis le 6 avril, y disposait de 3000 hommes environ
et de 3 canons.
Les Armées Vendéennes, sous les ordres du généralissime Jacques
Cathelineau, arrivent aux abords de La Châtaigneraie le 13 mai 1793 au matin en
trois colonnes différentes. La première vient par Moncoutant et Chantemerle. Chalbos
la rencontre à l’Est du bourg près du Breuil-Barret vers 10 heures. La seconde
colonne arrive par la Forêt-sur-Sèvre et Saint Pierre-du-Chemin et rejoint immédiatement
le combat. En voyant l’arrivée de la troisième par Réaumur, Cheffois et la
route de Mouilleron, Chalbos a compris qu’il avait perdu. Après deux heures de
combat il bat en retraite précipitamment vers Fontenay en laissant peu de
pertes humaines mais en abandonnant ses canons, ses caissons d’artillerie et
des fusils. Les Vendéens rentrent donc victorieusement dans le bourg de La
Châtaigneraie.

L’ancienne mairie, 32 rue du commerce, vers 1905.
Leur première tâche est de délivrer tous leurs compatriotes emprisonnés
par les autorités républicaines. La prison se situe alors dans l’ancien
Baillage Royal utilisé par le District, rue du Palais (actuel N° 32 rue du
Commerce). Ce sont les caves, datant du XIVème siècle qui servent de
cachots. Le bâtiment a été réaménagé par la suite en 1897 pour servir de Mairie;
mais les caves ont été conservées et existent encore aujourd’hui. En
poursuivant leur visite de la ville, les Vendéens trouvent par hasard la
guillotine dans la cour d’une auberge et constatent que le couteau est encore
tâché du sang de la dernière victime.
Une grande fureur s’élève dans les groupes de paysans et un désir de
vengeance se manifeste. Ils commencent par vouloir massacrer leurs prisonniers ainsi
que les patriotes de la ville. Leurs chefs, en particulier Henri de La
Rochejaquelein, veillent à les en dissuader en leur rappelant qu’on ne peut incarner
La Juste Cause en rendant le mal pour le mal et en se vengeant. Les paysans
s’exécutent avec mauvaise grâce. L’abbé Billaud leur prête une formule qui
résume sans doute bien l’état d’esprit du moment: « Nos Messieurs veulent
faire la guerre à leur manière, qu’ils la fassent donc tout seuls ! ».
En compensation, ils vont piller les maisons de tous les patriotes, de
ceux dénoncés ou seulement soupçonnés de l’être. Puis ils s’occupent à vider méthodiquement
les caves du bourg .Le 15 mai ils quittent La Châtaigneraie ; mais ils ne
sont déjà plus que 7000 à se diriger vers Vouvant où ils vont bivouaquer ce
soir là. Il aurait sans doute été prudent de remettre la bataille à une date
ultérieure ; mais Nicolas Stofflet s’y oppose fermement et fait prévaloir
son avis.

L’Église de Vouvant, vers 1875, avant les restaurations. - L’historien
Pierre Gréau à droite, avec des randonneurs devant la plaque .
Le soir à Vouvant les paysans recommencent encore à vider les caves des
patriotes à commencer par celle du curé constitutionnel Guy-André Pineau. Ce
dernier s’en plaindra plus tard au comité en détaillant ce qu’il a ainsi
perdu : « 18 bouteilles de vin muscat, 160 litres de vin d’Anjou, 30 litres de vin blanc de
Bordeaux, 50 litres
de vin rouge de Bordeaux, sans compter
les barriques de vin de pays ». On peut quand même constater, au passage,
que le curé jureur n’avait peut-être pas de paroissiens mais qu’il avait veillé
à avoir une cave bien fournie. Le lendemain matin, 16 mai, les Vendéens
assistent à la messe dite par un prêtre réfractaire dans l’église Notre-Dame de
l’Assomption de Vouvant puis ils se dirigent vers Fontenay.
En 2004, l’association Le Souvenir Vendéen présidée par Jehan de Dreuzy
fera poser une plaque sur le mur de l’église indiquant : « Le 16 et
le 25 mai 1793 / l’armée Vendéenne / en marche sur Fontenay /passa à
Vouvant / Souvenir Vendéen 2004 » (le « passa » peut apparaître
comme un doux euphémisme !).
Sont-ils bien tous en état de combattre ? En tous cas, ils
engagent le combat vers 14 heures dans la plaine avant Fontenay, paysage qui
d’emblée ne leur convient pas. Arrivés à la ferme des Granges, ils sont face
aux soldats de Chalbos qui aligne un effectif de 9000 hommes. Après deux heures
de canonnade, la cavalerie républicaine charge, rompt les lignes vendéennes et les
met en fuite. Le général d’Elbée est blessé et ses soldats découragés
abandonnent le combat puis s’enfuient. Les Républicains poursuivent les fuyards
jusqu’à Baguenard à la lisière de la forêt de Mervent. Au soir du 16 mai 1793,
le bilan de cet échec est assez lourd : les Vendéens laissent sur le terrain
environ 600 morts, 80 prisonniers et une trentaine de canons (il ne leur reste
plus que 6 pièces d’artillerie et peu de poudre). Les Bleus, eux, n’ont perdu
que 10 hommes. La perte psychologiquement la plus dure pour les Blancs est
celle du canon baptisé Marie-Jeanne. Il s’agit d’une pièce d’artillerie portant
les armoiries de Richelieu parfaitement reconnaissable au son, qui a été
conquise à Coron et est devenue le porte-bonheur des Vendéens et le signe de
victoire.
Les Républicains qui vivaient dans la crainte de la prise de la ville
se réjouissent parce qu’ils espèrent que cet échec va marquer la fin de
l’insurrection vendéenne. Le député Goupilleau écrit « L’ennemi est
abattu, j’ai peine à croire qu’il ose jamais se représenter devant nous ».
Les administrateurs déclarent « cette affaire a sauvé le
département ».

Le bourg de Pissotte (l’église date du XIXème).
Les Vendéens sont rentrés chez eux dans le haut bocage et les Mauges
comme chaque fois après un événement important. Mais cette fois-ci, ils sont
pleins d’amertume et de regrets pour cet échec. Après réflexion, ils
considèrent qu’ils ne méritaient pas la victoire. Dieu a puni ses soldats pour
leur conduite indigne, la colère, la vengeance, les exactions, les pillages et
les beuveries. Le désir de se racheter et de rétablir la situation, de libérer
Marie-Jeanne devient prédominant. Par cet effet spontané, qui est une des spécificités
de cette insurrection, les soldats reviennent de partout pour se regrouper et
reformer les armées. Dès le 21 mai, 30000 hommes sont présents, l’armée n’a
jamais été aussi nombreuse et elle marche en direction de Fontenay pour prendre
sa revanche.
Pendant ce temps là, Chalbos, en chassant 300 vendéens, s’était
réinstallé à La Châtaigneraie. Quand il apprend le 24 mai que toutes les forces
Vendéennes marchent vers lui, il abandonne précipitamment cette commune, de
peur que la retraite lui soit coupée et se replie pour défendre Fontenay .Ses
soldats partent à 22 heures, marchent durant la nuit et arrivent le lendemain
matin à 5 heures. Les autorités de cette dernière ville, prévenues au cours
d’un banquet, restent d’abord incrédules, puis la nouvelle se communique
rapidement et la panique gagne l’ensemble de la population.

La rue du Roc à Pissotte (ancienne route).
Les Armées Vendéennes ont bivouaqué aux alentours de Vouvant et le
samedi 25 mai au matin, elles se mettent en route vers Fontenay en passant par
Pissotte. A cet endroit, elles ne sont plus éloignées que d’une lieue (4 kilomètres). Les
paysans commencent à réciter leur chapelet. La route actuelle de La Châtaigneraie
à Fontenay (RD 138 ter) a été construite au XIXème siècle un peu
plus à l’Est que la précédente. Cette dernière a été ensuite convertie en
chemin vicinal et a finalement été supprimée lors du remembrement au XXème
siècle. Il en existe tout de même quelques vestiges. Si on veut mettre ses pas
dans ceux des Vendéens de 1793, il faut aller rechercher les restes de cette
ancienne route dans la rue du Roc puis la rue des Nomades à la sortie de Pissotte.

Le site de la bataille vue des Moriennes, Pissotte se situe au fond à 4
km.
Pour la défense de Fontenay, Chalbos dispose désormais de 6000 hommes
environ. Déjà l’administration a décidé que : « tous les hommes de 18
à 60 ans présents dans la ville doivent se mettre à la disposition du général
afin de participer à la défense de la ville ». Tous les hommes en âge de
porter un fusil et à qui on a pu en fournir un, sont donc là. Il s’agit
toutefois d’un apport plus spectateur que véritablement acteur de la bataille
et qui en outre est susceptible d’aggraver un mouvement de panique. Le général a
eu le temps de mettre ses troupes en ordre de bataille, en éventail au Nord de
la ville. Au centre, la troupe principale est installée sur le plateau des
Moriennes, près de la redoute et devant le Portault (à peu près à l’emplacement
du château d’eau actuel). Un autre corps d’armée est placé à l’Ouest derrière
le lieu dit Les Petites Gourfailles). Un troisième groupe est disposé plus à
l’Est, de l’autre côté de la route de la Châtaigneraie, à proximité du fleuve
La Vendée. Enfin une quatrième troupe attend tout à l’est de la ville près de
la route de Niort et va avoir peu à combattre (Cf. plan de la bataille
ci-dessous).
La photo ci-dessus nous montre le site de la bataille tel que le voient
les Républicains sur le plateau des Moriennes. Ils voient arriver vers eux en
face et à découvert les soldats de Cathelineau, car Pissotte est distant d’un
peu moins de 4
kilomètres.
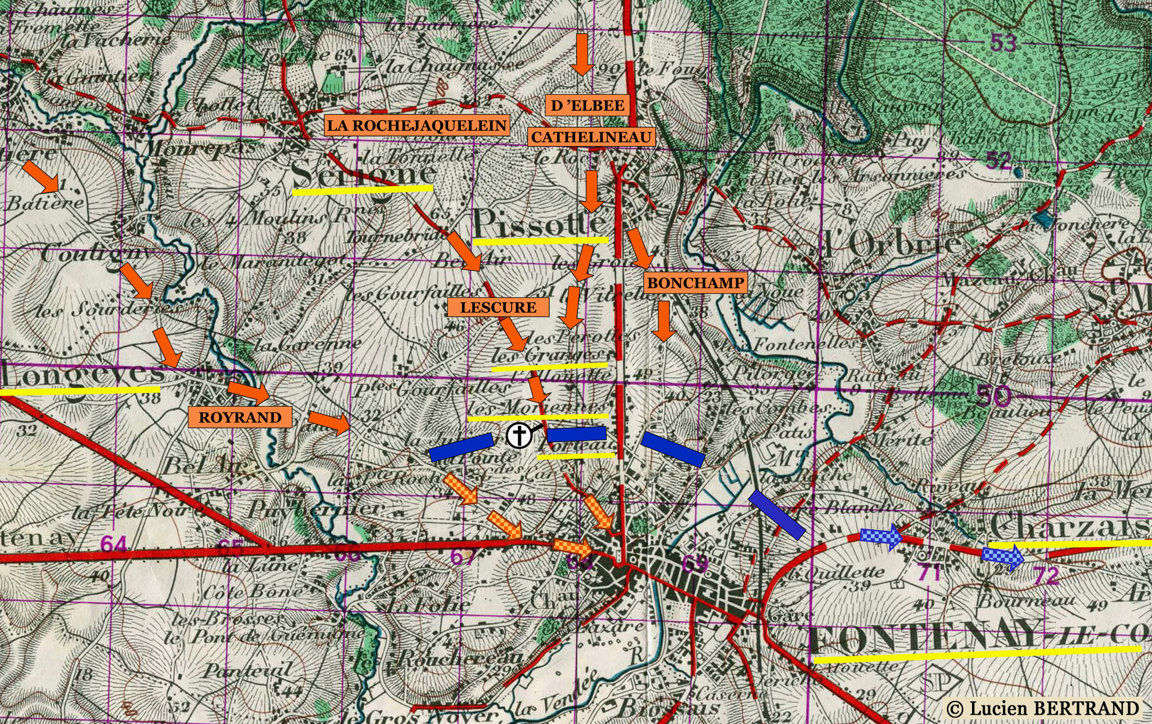
Plan de la bataille de Fontenay.
Pour couvrir un plus large terrain d’action, les armées Vendéennes se
séparent en trois colonnes différentes, à partir de Pissotte. Au centre,
Jacques Cathelineau s’avance en tête des soldats de sa colonne. Il a proposé à
ses hommes qui récitaient leur chapelet d’entonner tous ensemble le
« Vexillia Regis ». Il tient à la main la belle croix en argent
ciselé qu’il portait autrefois aux pèlerinages de Belle-Fontaine en Anjou.
(Elle se trouve aujourd’hui dans la chapelle des Quatre-Barbes à Chanzeaux).
Derrière lui, vient l’armée de d’Elbée ; et La Rochejaquelein dirige
l’arrière garde. A l’Est se trouve la colonne de Bonchamp près de La Vendée.
L’armée de Stofflet le suit. La troisième colonne à l’Ouest, commandée par
Lescure, est partie vers Sérigné pour rattraper la route qui, de cette ville,
va directement à Fontenay. Il avait un peu plus de chemin à parcourir, mais
comme il était parti avant les autres, il va affronter l’ennemi en premier,
vers 13 heures environ.
 Le site de la Bataille pour l’armée de Lescure.
Le site de la Bataille pour l’armée de Lescure.
En regardant la photo ci-dessus, nous sommes dans la position des
soldats de Lescure en 1793. Le paysage de plaine, totalement à découvert, est à
peu près identique à celui du XVIIIème siècle si on retire toutefois
le château d’eau à gauche (« les Moriennes »), l’usine et l’antenne
au centre (« la croix du camp »). On remarque la route venant de
Sérigné tout à gauche de la photo et on la revoit ensuite au centre dans la
direction de la flèche de l’église Notre-Dame.
Les Vendéens ont à ce moment là un vrai problème difficilement
surmontable, ils n’ont pratiquement plus d’artillerie (3 canons seulement), peu
de munitions et encore moins de poudre. A ceux qui l’ont fait remarquer au
général de Marigny, il a répondu : « en face, ils en ont, il suffit d’aller
leur prendre ».

Louis-Marie de Salgues marquis de Lescure, Tableau de
Robert-Jacques Faust-Lefèvre, 1818. Détail du tableau. »
Les Vendéens n’aiment pas du tout ce terrain de plaine entièrement à
découvert, ils hésitent et avancent lentement. Lescure prend alors la tête de
la colonne, à trente pas en avant. Il s’arrête et crie par provocation
« Vive le Roy ». Une batterie de six pièces de canons fait feu sur
lui mais sans l’atteindre. Il s’écrie alors « Mes amis, vous voyez bien
que les Bleus ne savent pas tirer ».
Arrivés à proximité des Bleus, au lieu dit « la Croix du
camp », sous le feu des canons, les soldats de Lescure se mettent à genoux
au pied d’un calvaire et se plongent en prières. Un de leurs chefs, M. de
Beaugé, veut les entrainer, leur montrer le danger encouru et la bataille qui
attend. Lescure qui le voit lui crie : « laissez les prier, ils se
battront mieux après ».
Cette scène lors de la bataille de Fontenay est exactement celle que le
peintre a fait figurer en arrière plan sur le portait de Lescure (photo
ci-dessus). Bien sûr, le paysage montagneux qu’il y a représenté est seulement
issu de l’imagination d’un artiste parisien, tout comme le calvaire très haut
et le piédestal majestueux. Ce détail du tableau a par ailleurs été utilisé
comme logo par l’association « Vendée Militaire ».
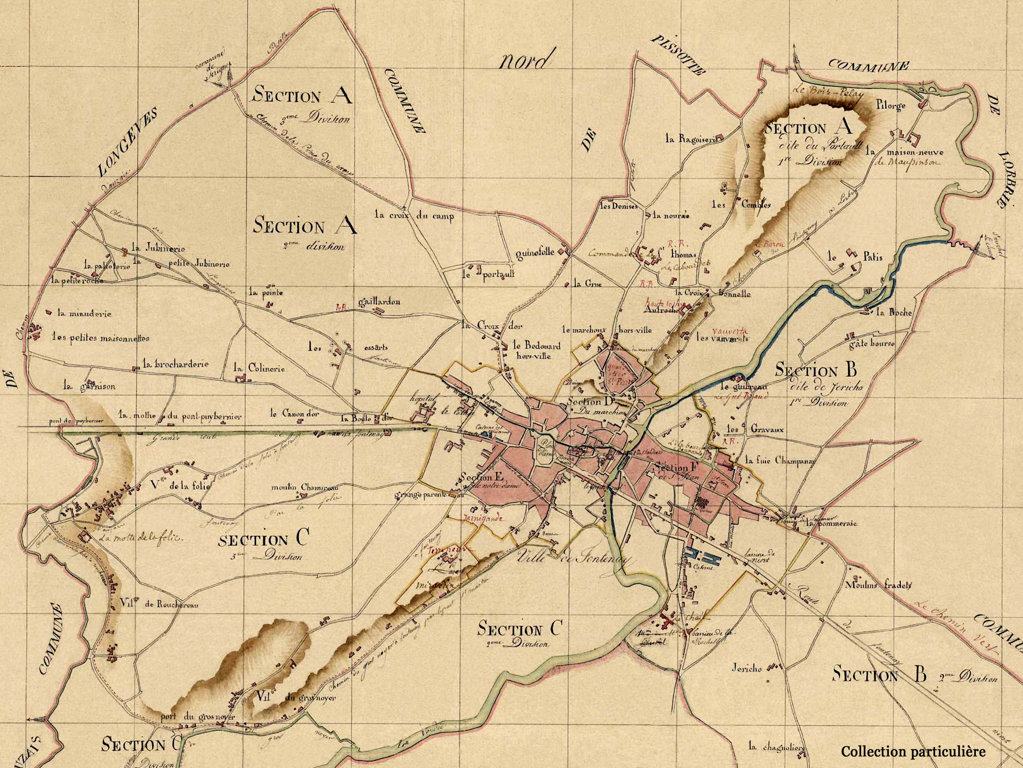
Ancien cadastre du secteur.
Ce plan regroupé, issu des éléments de l’ancien cadastre de Fontenay
dit Napoléonien (1818), nous montre la position exacte de ce petit calvaire de
mission du XVIIIème siècle, au lieu dit « La Croix du
camp ». Ses vestiges ont aujourd’hui totalement disparu. On peut espérer qu’une
association de la Mémoire Vendéenne pourra en reconstruire un prochainement.
Il s’agit tout de même d’un événement non anodin d’une bataille connue.
On peut voir sur la photo ci-dessous le paysage actuel et deviner l’ancien
emplacement exact au carrefour de la route de Sérigné (actuelle rue du général
Leclerc) et de la rue baptisée si opportunément « rue Louis-Marie de
Lescure » (à gauche sur la photo).

Emplacement de la Croix du Camp.
Pour se protéger des dégâts causés par les tirs d’artillerie auxquels
ils ne peuvent plus guère répliquer, les Vendéens ont mis au point un
stratagème. Au moment où les artilleurs allument la mèche, ils se couchent à
terre. Quand le coup est parti et qu’on recharge le canon, ils disposent d’un
court délai pour progresser très rapidement en toute impunité.
En ce début d’après midi, il fait chaud, les Vendéens ôtent leurs
paletots pour foncer sur l’ennemi. Assez rapidement la redoute des Moriennes
est enfoncée, mais les chasseurs de la Gironde commandés par le général Dayat
et les volontaires de Toulouse et de l’Hérault sous les ordres directs de
Chalbos résistent toujours aux Vendéens six fois supérieurs en nombre. La
cavalerie, appelée à la rescousse, refuse d’opérer une charge, sans doute parce
que les positions sont déjà trop compactes. Seuls 20 cavaliers essaient une
percée et échouent ; les autres partent en direction de Niort. Les Bleus
commencent à fléchir.
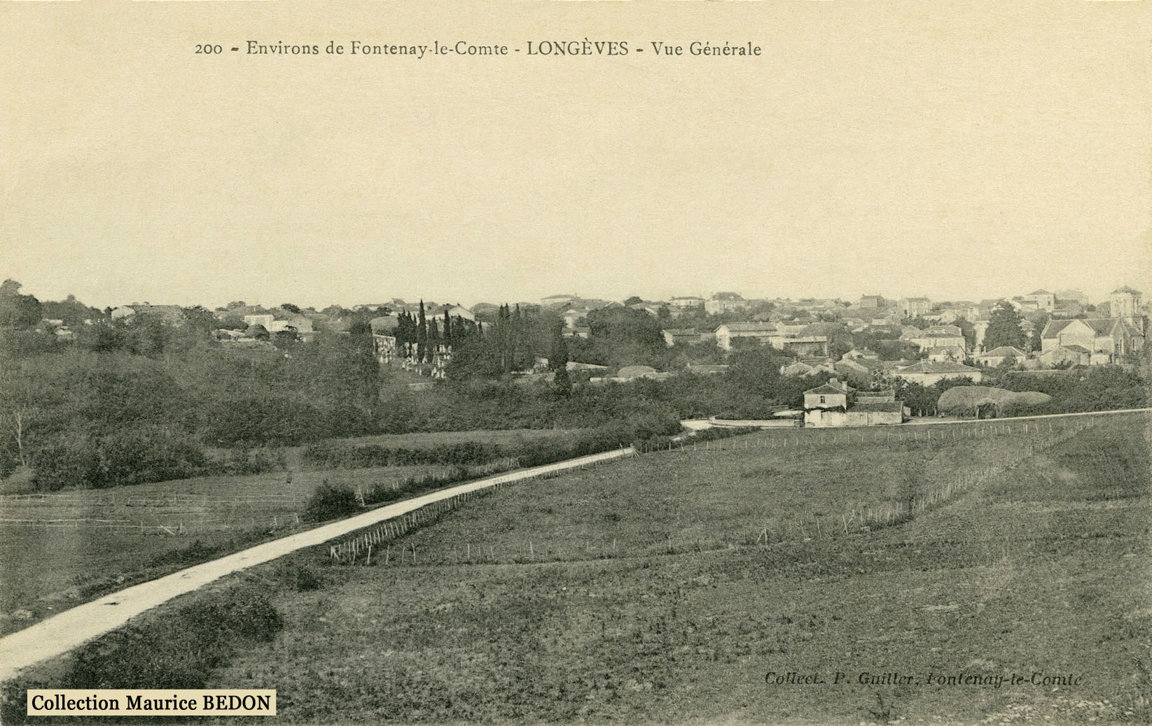
Vue générale de Longèves vers 1910.
C’est à ce moment précis qu’arrive sur le champ de bataille l’Armée de
Royrand ou Armée du Centre, regroupant 4000 hommes environ, commandée par de
Cumont et de Verteuil. Ils avaient beaucoup moins de distance à parcourir que
les Angevins mais ils s’étaient mis en route beaucoup plus tard, le 24 mai à
partir de Chantonnay. Ils arrivent maintenant, après être passés par Mouilleron-en-Pareds,
L’Hermenault et avoir traversé le bourg de Longèves. La plupart des historiens
n’accordent pas de rôle à l’Armée du Centre, estimant qu’elle est arrivée en
retard. Amédée de Béjarry leur répond dans ses « Souvenirs
Vendéens » en citant le récit de Louis-Dominique Ussault :
« Nous arrivâmes au pas de course….Déjà les républicains
commençaient à rétrograder. Notre arrivée, quoi qu’on en ait dit, les
consterna ; à notre vue la déroute fut complète.….Aucun historien ne parle
des services que notre division rendit à cette affaire. Cependant, je n’ai
jamais douté que notre arrivée par la plaine n’ait produit sur Chalbos un grand
effet. »
La bataille a duré à peine une heure et les troupes républicaines se
replient vers Niort ou sont totalement en fuite. Seuls ses canons installés en
ville dans les ruines du vieux château médiéval tonnent encore vers le nord de
la ville en direction de l’armée de Bonchamps. Leurs effets sont plus
psychologiques que réels sur le déroulement de la bataille ; à peine
réussissent-ils à couvrir un moment la déroute.

Les ruines du Vieux château actuellement. La
Barrière de l’Octroi sur le Route de Luçon en 1903.
L’Armée du Centre, suivant la route de Longèves, entre logiquement à
Fontenay par la barrière de l’octroi dite de Nantes, située sur la route de Luçon.
Cette barrière, installée à peu près au niveau du vieil hôpital, et que l’on
retrouve sur la carte postale au début du XXème siècle, n’existe
évidemment plus aujourd’hui. L’armée de Cathelineau pénètre en ville par la
barrière dite de Saumur et les autres armées par toutes les barrières situées
au Nord de la cité.
En faisant le bilan de la bataille, on se rend compte que les pertes
humaines ne sont pas considérables par rapport à d’autres affrontements. Les
Vendéens, qui ont pourtant combattu dans des conditions difficiles, ont peu de
morts. Les Républicains ont perdu moins d’une centaine de soldats dans la
bataille mais ils laissent 3000 prisonniers à leurs adversaires. Ils ont en
outre dû abandonner une grande partie de leur artillerie. Les Vendéens
récupèrent 40 canons environ mais ne trouvent pas celui qu’ils cherchent le
plus, leur mascotte Marie-Jeanne. Ils se rendent alors compte que les Républicains
ont tenu à l’emmener dans leur fuite, sans doute pour les priver d’une partie
de leur victoire.
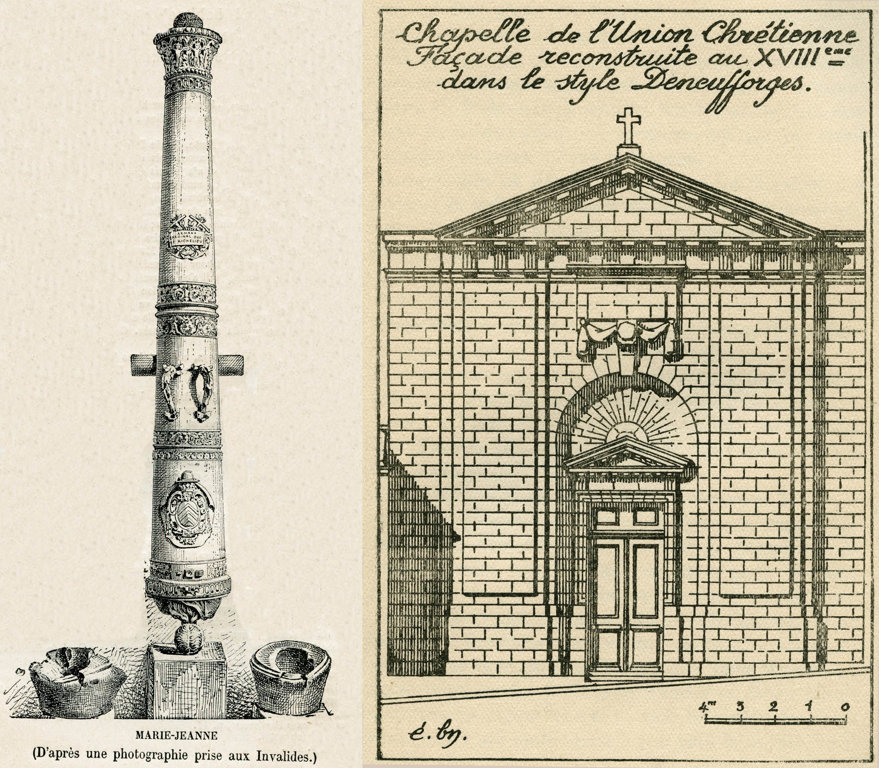
Canon similaire à Marie-Jeanne conservé
au musée de l’Armée à Paris. L’ancien couvent dit de L’Union
Chrétienne.
Une trentaine d’entre eux, conduits par l’intrépide Forêt, partent
prestement par la route de Niort à la poursuite des Bleus. En effet, cent écus
avaient été promis à celui qui le premier mettrait la main sur le canon. Ils
les rattrapent 3
kilomètres plus loin à Charzais, au lieu-dit Les Granges
et réussissent à récupérer le fameux canon. L’affaire est considérée comme
tellement importante que l’on connaît encore aujourd’hui les noms de ceux qui
réussissent le coup de main. Louis Brochet les cite dans son ouvrage « La
Vendée à travers les âges » : Picherit, Loyseau, Rochard,
Delaunay (tous les quatre de Chanzeaux), Jacques Vendangeon (d’Uzernay) et Biot
(de Mouchamps). Amédée de Béjarry précise, non sans une certaine dose de
chauvinisme, que le premier « qui
mit la main sur la fameuse Marie-Jeanne fut un soldat de l’Armée du Centre, qui
s’appelait Riot, de Mouchamps » (en réalité Mathurin Biot). Enrubannée
et décorée de fleurs par les dames, Marie-Jeanne va traverser toute la ville en
cortège et sera même conduite jusqu’à l’intérieur de l’église Notre-Dame. Pendant
ce temps, les cloches des églises de la ville, muettes depuis un certain temps,
ne cessent de sonner à toute volée. Par la suite, ce célèbre canon aurait
disparu dans la Loire devant Saint Florent-le-Vieil, mais le musée de l'Armée
situé à l'Hôtel des Invalides à Paris en montre un exemplaire similaire
(reproduit ci-dessus).

Le bourg de Charzais près de Fontenay.
Si la bataille proprement dite a duré peu de temps, beaucoup de
fontenaisiens vont perdre la vie dans les escarmouches et la confusion de la
déroute. Les administrateurs de la ville et les sympathisants, pris de panique,
se sauvent au plus vite. Deux cavaliers vendéens, à peine armés, n’ont aucune
peine à faire déposer leurs armes à un groupe de 20 volontaires. L’arrivée de
la nuit met heureusement fin aux débordements.
Au moment où il rentre en ville, le général de Bonchamps est blessé au
bras et à la poitrine par un dénommé Staub, concierge de la Mairie. Celui-ci
après avoir sollicité et obtenu la vie sauve du général vendéen, avait repris
son fusil et lui avait tiré dessus. Ecarté des combats, Bonchamps partira en
convalescente au château de Landebaudière à La Gaubretière le 29 mai.

L’église
Notre Dame de Fontenay (XV & XVIème). Le général Charles Melchior de Bonchamps
tableau par Giraudet-Trioson en 1818.
La principale préoccupation des Vendéens est de libérer en priorité,
dès le samedi après midi 25 mai, les nombreux prisonniers enfermés à Fontenay.
C’est Lescure et La Rochejaquelein qui vont se charger de cette tâche. En 1793,
les prisons sont nombreuses à Fontenay et de triste réputation. Conformément
aux principes de la Terreur on a commencé par entasser les prisonniers dans
l’ancien couvent dit de l’Union Chrétienne sur le côté Nord de l’actuelle place
Viète (Cf. gravure située plus haut). Puis, l’espace ne suffisant plus, on a utilisé
les bâtiments de l’ancienne résidence du Gouverneur au XVIème siècle
dits de La Sénéchaussée, situés quai de La Rochefoucauld. En dernier lieu, on a
occupé en plus une maison au N° 1 la rue du Puits-de-la-Vau, qui était pratique
parce qu’elle était située en face du siège du tribunal révolutionnaire (N° 4).
Des maisons particulières avaient même été réquisitionnées pour compléter le
dispositif. On mourrait beaucoup dans ces prisons : de maladie, d’épidémie
et des ravages de la guillotine. Un ancêtre de l’auteur, capturé, est
d’ailleurs mort d’épuisement dans les prisons de Fontenay à l’époque de la
Terreur.
Les Vendéens libèrent ainsi 240 soldats blancs (dont ceux faits
prisonniers le 16 mai), plusieurs prêtres réfractaires, notamment ceux du
Poiré-sur-Vie, Belleville, St Philbert-de-Bouaine, Beaulieu-sur-Mareuil, de
nombreux civils considérés comme suspects, ainsi que La Marsonnière et Pierre
Bibard de la Tessoualle. Certains de ces malheureux devaient être fusillés ou
guillotinés le lendemain même. Trois guillotines fonctionnaient en permanence à
Fontenay. Tombées aux mains des Vendéens, les éléments en bois, que l’on ne
pouvait qualifier de « bois de Justice » à l’époque de cette tyrannie
sanguinaire, sont brûlés dans un feu de joie. En revanche personne ne peut
mettre la main sur les couperets. De peur de la réaction de Vendéens et de
représailles, comme à La Châtaigneraie, il est probable que les Bleus les aient
emportés dans leur fuite.
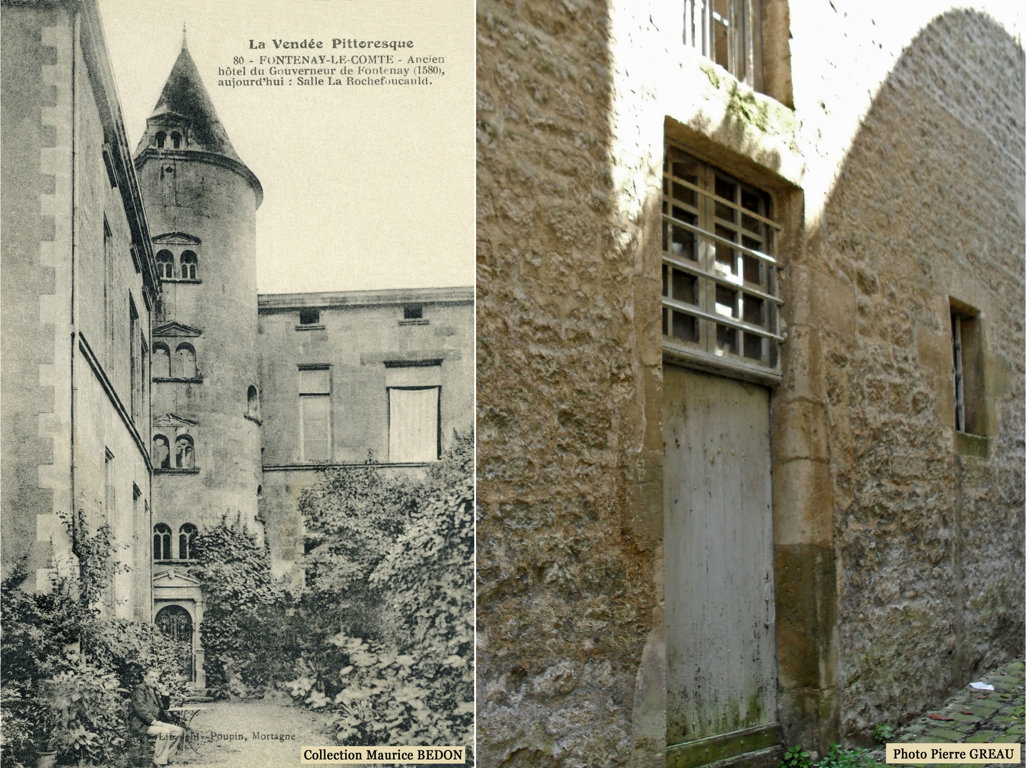
L’Hôtel de la Sénéchaussée (XVI & XVIIème). La
maison de la rue du puits de la Vau.
Dans leur visite de la ville les Vendéens ont trouvé la caisse du
Receveur. Elle se compose de deux caisses remplies du papier monnaie de
l’époque : les assignats. Avant que les officiers n’arrivent, la première
caisse est entièrement pillée par les soldats. Mais, image du mépris qu’avait
le milieu rural pour le papier monnaie, nul ne songe à se l’approprier à titre
personnel. Ils les déchirent, s’amusent à en faire des papillotes et finalement
les font brûler. Les officiers arrivent à temps pour sauver la deuxième caisse
qui contient 900 000 Francs environ toujours en assignats. Comme ils veulent
s’en servir pour payer les subsistances nécessaires à l’armée, ils indiquent à
la main sur les billets de la République : « Bon au nom du Roi ».
Les paysans, qui pour un certain nombre ne savent pas lire, vont
ensuite s’attaquer aux divers papiers et archives des administrations pour les
faire brûler, croyant qu’il s’agit des procès des suspects. Des doubles des
registres paroissiaux, déposés autrefois au Présidial de Fontenay, vont ainsi
disparaître. Les autres, emportés par les fuyards, ne connaitront pas un
meilleur sort, perdus, abîmés par les intempéries ou pourris. Si on ajoute que
les originaux, conservés dans les presbytères, ont été souvent brûlés par les
colonnes infernales. On comprend mieux pourquoi l’état-civil ancien a de
grosses lacunes.

Un assignat de 50 livres de cette
époque.
Le lendemain matin dimanche 27 mai 1793, les Vendéens assistent tous à
une messe solennelle chantée dans l’église Notre-Dame par un prêtre
réfractaire. Elle est suivie d’un Te Deum de remerciements pour la victoire.
Pour la circonstance, on a redonné à l’église son aspect à l’époque de l’Ancien
Régime.
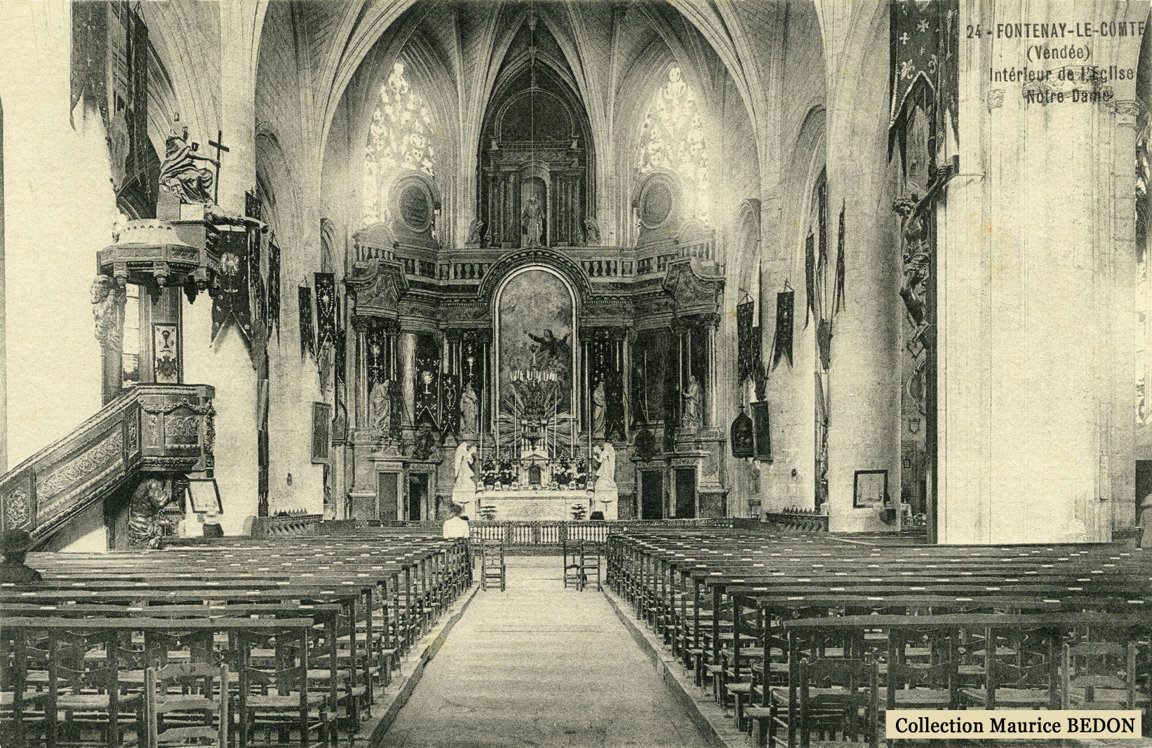
Intérieur de l’église Notre Dame vers 1905.
Les généraux vendéens ont été reçus dans les hôtels particuliers de la
ville. Certains sont les hôtes de Madame de Grimoüard de Saint Laurent. La
maison de Grimoüard, bel exemple de demeure aristocratique fontenaisienne du
XVIIIème, porte sur sa façade la date de 1741 et est située
actuellement au N°11 de la rue Pierre Brissot. C’est à cet endroit, dans la
grande salle du premier étage, du côté du jardin, que les chefs vont se réunir
en conseil de guerre.
Cette pièce servira au XIXème siècle de salle du Conseil
Municipal (de 1824 à 1895) et appartient toujours à la Ville de Fontenay. C’est
au cours de cette réunion qu’est prise la décision de former un Conseil
Supérieur de Châtillon de 25 membres, chargé d’administrer le territoire de la
Vendée Militaire au nom du Roy. Au cours de ce même conseil, il a également été
décidé que Stofflet serait nommé commandant du poste de Fontenay (fonction
qu’il n’aura guère l’occasion d’exercer).

Façade de l’Hôtel de Grimoüard, 11 rue
Pierre Brissot. La
grande salle de l’Hôtel de Grimoüard.
Globalement les soldats vendéens, contrôlés par leurs chefs, n’ont pas
commis beaucoup d’exactions, de pillages ou de beuveries comme ils avaient pu
le faire à La Châtaigneraie. Ils commencent à envisager de retrouver leurs
chaumières et le travail de la terre. Il reste un problème grave à régler : celui
des 3000 prisonniers. Tout au début, certains avaient souhaité les exécuter. Pour
les protéger, plusieurs personnes n’avaient pas hésité à protester
énergiquement. Par exemple, Madame de Grimoüard avait affirmé « Vous me
tuerez plutôt ». L’armée vendéenne n’avait en réalité que peu de choix car
il lui était matériellement impossible de les tenir en captivité. Il fallait
donc les tuer ou les libérer. La première solution étant contraire à leurs
principes, ils se décident à les libérer après leur avoir fait jurer sur
l’honneur de ne pas porter de nouveau les armes contre eux et après leur avoir
rasé le crâne pour les reconnaître éventuellement. 500 seulement sont gardés en
otages et envoyés à La Forêt-sur-Sèvre. Cette solution ne risquait pas de
modifier la position des officiers républicains et un soldat qui désobéit aux
ordres est passible du conseil de guerre. Alors les Vendéens les retrouveront
plus tard de nouveau en face d’eux.

Le champ de Foire de Fontenay.
Avant de partir, les Vendéens convoquent tous les habitants de Fontenay
à venir sur la nouvelle place du marché pour une séance de prestation de
serment à la Religion et à la Monarchie. Quelques-uns seulement s’y rendent, la
plupart des autres préfèrent rester chez eux, peut-être par peur de représailles
ultérieures au retour de Bleus.
Les chefs et le gros des armées quittent Fontenay-le-Comte le mardi 28
mai 1793. Les derniers trainards ne partiront que le 30.
Ainsi, la Prise de Fontenay va prendre place, dans l’Histoire des
Guerres de Vendée, au rang des actions héroïques mais aussi des batailles
inutiles, des territoires chèrement conquis et tout simplement abandonnés sans
combat ensuite.
Chantonnay le 28 février 2017
Maurice BEDON

LA BATAILLE DE LUÇON (14 août 1793)
On a coutume d’évoquer La Bataille de Luçon mais, en réalité, il y a eu
trois affrontements différents à cet endroit: le 28 juin 1793, le 30
juillet et le 14 août de la même année. C’est bien sûr du dernier, du plus
important, celui du 14 août 1793 auquel nous avons l’intention de nous
consacrer plus spécialement. Encore conviendrait-il mieux de parler de la
bataille « pour » Luçon que de la bataille « de » Luçon
puisqu’aucun des trois combats ne s’est déroulé dans cette ville mais dans des
communes situées nettement plus en avant.
Dès le début de la guerre, la prise de Luçon faisait partie des
objectifs des chefs de l’Armée Vendéenne. Bien sûr, cette ville était située en
dehors de la région insurgée mais elle avait l’avantage de posséder un port. Oh !
un tout petit port commercial, puisqu’il était tout juste relié à la mer
par un simple canal qu’il aurait été facile de couper. Mais une prise de Luçon
aurait fait sauter un verrou qui empêchait les Vendéens d’accéder à la mer. Ils
auraient pu ainsi occuper la côte, utiliser le port de l’Aiguillon-sur-Mer
(déjà plus sérieux), mais aussi attaquer le port des Sables d’Olonne en le
prenant à revers. Un tel accès à la mer a toujours cruellement fait défaut aux
Armées Vendéennes.

Le
port de Luçon vers 1900 (aujourd’hui comblé).
On considère généralement que l’affrontement du vendredi 28 juin 1793
constitue la première bataille de Luçon. A cette date, la plupart des armées vendéennes
avaient déjà commencé le siège de la ville de Nantes (28 et 29 juin). L’Armée
du Centre, commandée par Royrand et forte de 6 000 à 8 000 hommes, avait
surtout pour objectif de fixer sur place les troupes républicaines (1 700
hommes environ) pour les empêcher de participer à la bataille de Nantes en
surgissant sur les arrières de l'Armée de Charette aux Sorinières.
Le regroupement ayant eu lieu à Chantonnay, Royrand arriva par Bessay
et franchit le pont de Mainclaye vers 17 heures. Il divisa ensuite ses troupes
en deux colonnes : la première à l'Ouest se dirigea par la route de Corpe vers
les Magnils-Reignier et la seconde plus à l'Est par la route allant directement
vers la ville épiscopale.
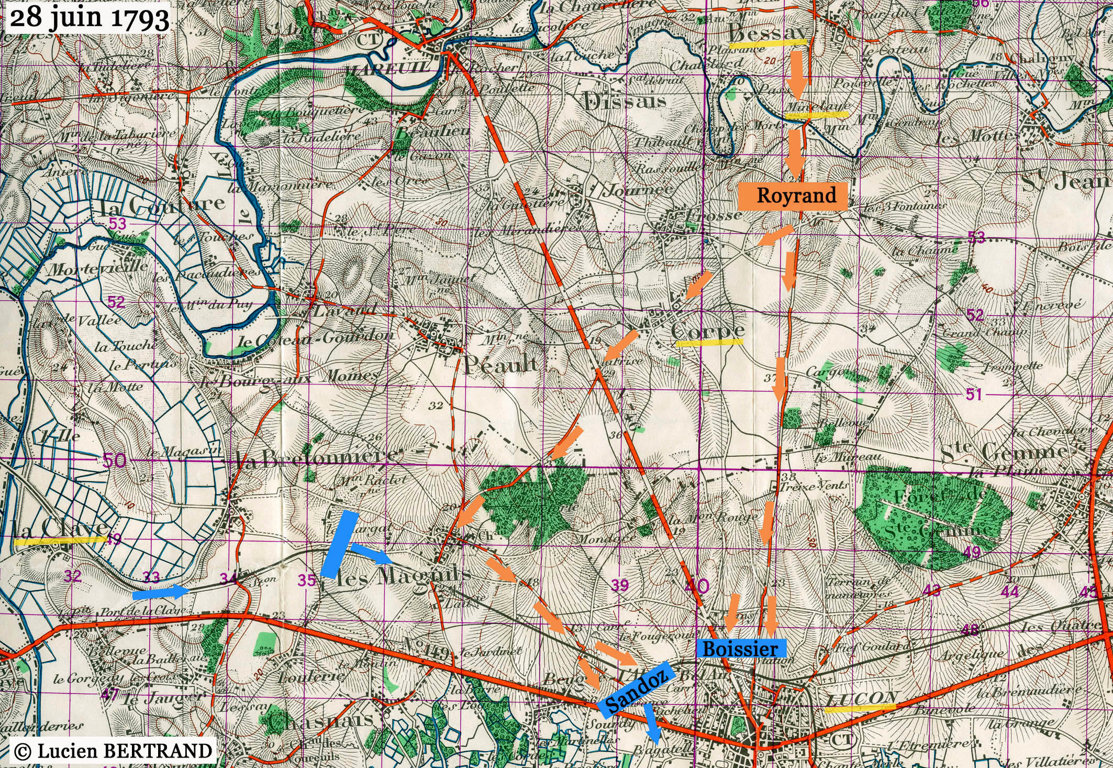
La première bataille de Luçon.
La première colonne, à l’ouest, réussit sans trop de difficultés à
faire plier les républicains commandés par le général Sandoz et ceux-ci se
sauvèrent jusqu'à Champagné-les-Marais. Toutefois, elle ne put exploiter son
avantage et pénétrer dans Luçon car elle fut prise à revers par un bataillon
arrivant par Port-La-Claye. L’autre colonne, celle de l’Est, se heurta à une
résistance farouche commandée par le général Boissier. Les Vendéens, perdant
tout espoir de percer facilement, ne purent qu’abandonner. Ils avaient quand
même rempli une partie de leur mission, retenir les troupes républicaines sur
place. Ces dernières viendront les poursuivre au-delà du Pont de Mainclaye
jusqu’au Nord du bourg de Bessay.

Le
château de Bessay gravure du comte de Montbail en 1843.
Le deuxième affrontement eût lieu en juillet 1793. Le 29 les Armées
Vendéennes quittèrent les Herbiers et se regroupèrent à Chantonnay pour
s’avancer vers Sainte Hermine. Une patrouille de gendarmes aperçut un groupe de
150 cavaliers d’avant-garde sur l’ancien cours royal Nantes-Bordeaux vers
Sainte Gemme-la-plaine. Le lendemain vers 11 heures, 25 hussards postés autour
du château de Bessay abandonnèrent leur poste pour aller prévenir le général
Tuncq à Luçon. Celui-ci plaça aussitôt son armée, composée de 2 400 hommes
environ, en position vers la forêt de Sainte Gemme. Ce même 30 juillet 1793, les
Vendéens, commandés par d’Elbée, Lescure, La Rochejaquelein, Talmont et Royrand,
après avoir pris Bessay et franchi le pont de Mainclaye, attaquèrent sur deux
colonnes dans la même plaine selon la même stratégie qu’au mois de Juin, mais
un peu plus à l’Ouest. Les Républicains commandés par Lecomte et Sagot
résistèrent et repoussèrent les assaillants. Après un combat particulièrement acharné
au corps à corps, la première puis la seconde colonne furent contraintes de se
replier et de repasser le pont de Mainclaye. La cavalerie du prince de Talmont
protégea leur retraite. Force était de constater que dans un paysage de plaine
où ils se sentaient mal à l'aise, les Vendéens n’avaient encore pas pu
s’accrocher au terrain.

Carte postale représentant Luçon
vers 1898. Maurice d’Elbée d’après le tableau de J-B Paulin-Guérin (1827).
Désireux de ne pas rester sur cet échec, les Armées Vendéennes sont de
nouveau hâtivement rassemblées à Sainte Hermine le 14 août 1793. Elles
totalisent aux environs de 40 000 hommes. A l’exception de Bonchamps, retenu par
une blessure, d’Elbée, La Rochejaquelein, Lescure, Stofflet, Marigny, Talmont et
Royrand sont là. Charrette a également décidé de participer à la prise de
Luçon. Aussi, ils tiennent un conseil de guerre sous la présidence du
généralissime d’Elbée. Celui-ci vient d’être élu à ce poste le 19 juillet,
quelques jours après que Jacques Cathelineau soit mort de ses blessures le 14
juillet. Ils se sont peut être réunis au château de Sainte Hermine (propriété
de Louis-Constantin Jousseaume marquis de la Brétesche). Le château,
généralement inhabité à cette époque, avait d’ailleurs déjà été utilisé par
l’état major des gardes nationaux républicains. D’autres auteurs, au nombre
desquels on compte l’abbé Billaud, pensent que cette réunion se serait tenue
dans une auberge du bourg de Sainte Hermine, l’auberge du Bon Pasteur.

Le château de Sainte Hermine construit en 1634.
En tous cas, suivant en cela une proposition de Lescure, on décide de
faire une attaque par groupes successifs dite en échelon. Malheureusement,
cette stratégie militaire exige, pour être réussie, d’être exécutée avec
précision, par des armées très bien organisées et bénéficiant surtout d’une
parfaite coordination entre elles. Comme toutes ces qualités militaires
n’étaient pas vraiment la spécialité des Vendéens et que leurs chefs ne se
faisaient pas confiance, le résultat n’était pas acquis d’avance. D’autant plus
que les Blancs vont se rendre compte tardivement qu’ils ne sont plus là en
région insurgée, que la population ne leur est donc pas favorable et que le
paysage de la plaine n’a rien à voir avec celui du bocage dont ils savent si bien
tirer parti. Vont-ils dans ces conditions éviter de refaire les mêmes
erreurs ?

Le
bourg de St Gemme-la-Plaine vers 1900 (en 1793 la flèche du clocher n’existait
pas, et elle s’est écroulée en 1931).
De son côté le général Tuncq, disposant de 8 000 hommes environ, en
laisse 2 000 en réserve dans la ville de Luçon. Il a la possibilité d’être renseigné
sur les mouvements de l’adversaire par quelques soldats installés dans le
clocher de la cathédrale. Il place donc 6 000 hommes à peu près aux mêmes
emplacements que lors des deux attaques précédentes ; c'est-à-dire sur une
ligne allant du bourg de Corpe à celui de Sainte Gemme-la-plaine en passant par
les fermes de Cargois, Bellevue, le Mureau et la forêt de Sainte Gemme. Et
c’est à cet endroit qu’il cache une grande partie de son artillerie.
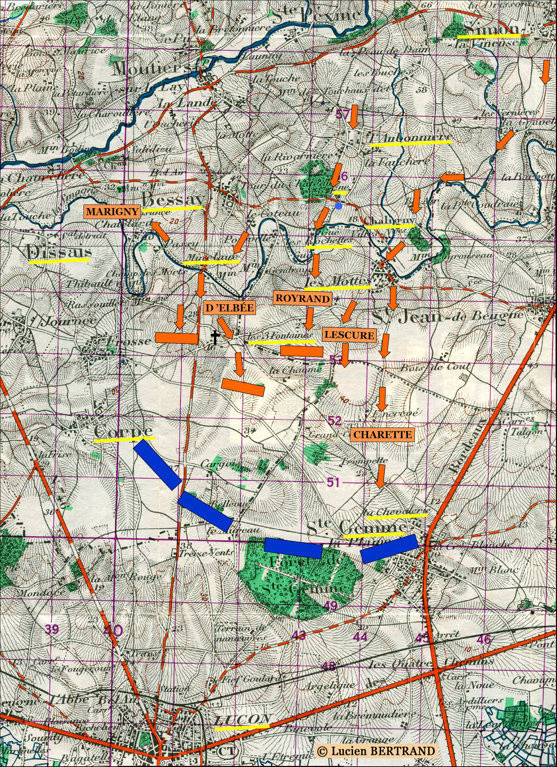
Plan
au début de la bataille de Luçon, le 14 aout 1793.
François-Athanase Charrette de la Contrie, soit par bravade, soit pour
démontrer la valeur combative de ses maraichins par rapport aux bocains, s’est
offert d’être le premier à affronter l’ennemi. Pour ce faire, il doit donc
emprunter l’itinéraire le plus court, celui le plus à l’Est, pour se rendre au
champ de bataille. En partant de Sainte Hermine, il traverse la paroisse
contigüe de Saint Hermand (aujourd’hui incluse dans le bourg de Sainte
Hermine). Puis il oblique à droite vers le Sud et traverse le bourg du
Simon-la-Vineuse avec 4 000 à 5 000 soldats environ.

Charrette
d’après le tableau de J-Baptiste Paulin-Guérin (1827). L’église
du Simon lors d’un mariage en costumes du XVIIIème
Par les chemins les plus directs, Charette se dirige vers la rivière la
Smagne. Il débouche sur l’actuelle voie communale des Touches aux Mottes (C4) et
passe ainsi devant le célèbre logis de Chaligny dans la commune de Sainte
Pexine (demeure d'Henri-Gabriel Regon de Chaligny).
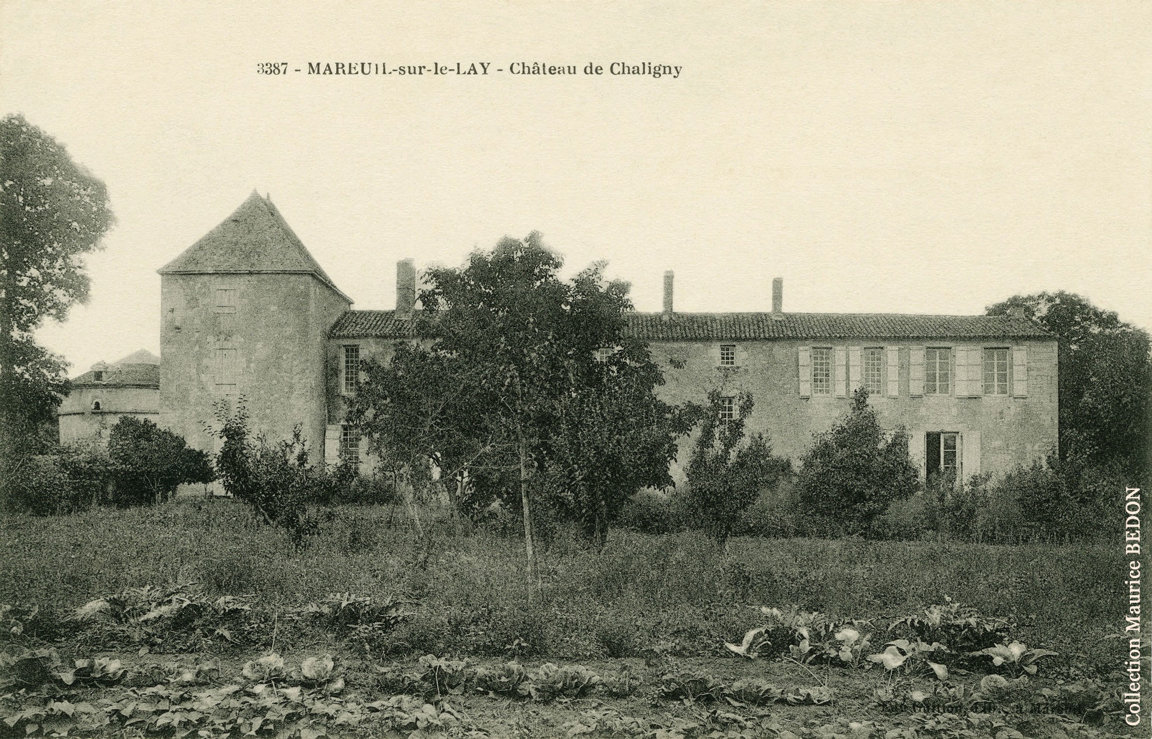
Logis
du Chaligny (XVIIème) vers 1900.
Sur cette même voie, il arrive aussitôt après à la Smagne qu’il
franchit sans difficulté à gué au lieu dit les Mottes. Au même emplacement, il
y a aujourd’hui un pont sur la rivière, (construit au milieu du XIXème
siècle) pour permettre le passage de la route de Bessay à Saint Jean-de-Beugné
(D 88).

Le pont des Mottes (XIXème).
Charrette traverse donc la rivière à gué dans ce lieu avec son armée,
d’autant plus facilement que nous sommes au mois d’août et que le niveau de
l’eau est bas. D’ailleurs, c’est une très belle journée d’été ; le soleil
est éclatant et il fait très chaud. Il arrive ainsi vers midi au village des
Mottes, situé à proximité immédiate. Il abandonne cette route pour aller dans
la direction plein Sud en prenant très largement le chemin se dirigeant vers
Saint Gemme-la-Plaine, en passant par les lieux-dits Encrevaire et Trompette. A
partir des Mottes, il se trouve désormais en paysage de plaine, c'est-à-dire totalement
à découvert et il peut deviner les troupes républicaines lui barrant la route environ
trois kilomètres plus loin à Sainte Gemme-la-Plaine.

Le
paysage de plaine que pouvaient voir les soldats de Charrette en se rendant à
la bataille, à gauche les tours de la Chevallerie et à droite l’église de Ste
Gemme.
Par ce trajet, il est forcément arrivé ici le premier. Or, pour une
bonne application de la stratégie prévue il aurait du attendre un peu, au moins
l’arrivée des autres armées. Peut être a-t-il voulu faire seul la décision qui aurait
entrainé la victoire ? En tous cas pour l’instant, il ne peut compter que
sur l’aide des soldats de Lescure qui le suivent. Il fonce tout de même directement
vers les troupes républicaines. La première rencontre a lieu sur les terres
situées avant les jardins du logis de la Chevallerie (propriété de la famille
Babin des Ardillers). C’est d’ailleurs dans cette demeure que le général
républicain Bard avait installé son quartier général lors d’une précédente
défense de Luçon.

La
cour intérieure du logis de La Chevallerie (XVIIIème).
Pendant ce temps, Royrand et l’Armée du Centre s’étaient dirigés un peu
plus loin à l’Ouest de Sainte Hermine, puis ils étaient descendus vers le Sud
en passant par le village de l’Aubonnière (commune de Sainte Pexine) et devant
le logis du même nom (propriété d’Augustin Genay de Chail). Ils avaient ensuite
emprunté un chemin longeant les bois du Chêne-Robin (actuelle rue de la
Citadelle).

L’ancien
logis de l’Aubonnière (XVI & XVIIIème) en partie écroulé depuis
1900.
Arrivés à la Smagne, ils avaient suivi le cours d'eau en direction de
l’aval pendant 300 mètres
environ et l’avaient traversé sans difficulté au gué dit des Rochettes. Peu
après ce franchissement, le général, en attendant l’arrivée de d’Elbée avec le
gros de l’armée, conformément au plan élaboré en commun, s’était efforcé de rester
à cet endroit pour mettre ses troupes à peu près en ordre de bataille.
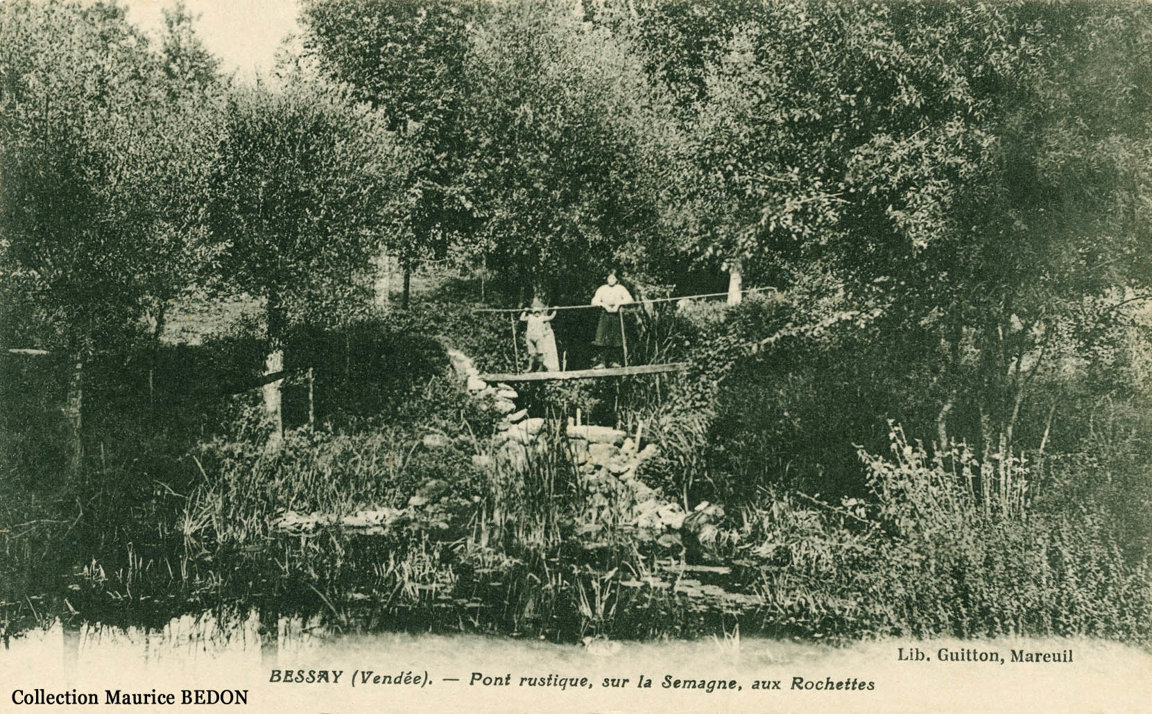
La passerelle au gué des
Rochettes vers 1905.
D’Elbée pour sa part était passé encore plus à l’Ouest, près du bourg
de Bessay et avait emprunté le pont de Mainclaye pour traverser la rivière. Il
s’était avancé pour essayer de mettre ses troupes en ligne. Il avait ainsi
perdu énormément de temps car les vendéens n’ont jamais eu les caractéristiques
d’une armée de métier et ne savaient pas bien se livrer à des exercices
militaires. De plus, ils n’avaient pas l’habitude de combattre en ligne et
rechignaient beaucoup à le faire. Leur chef devait d’ailleurs pester à ce
moment là contre Charrette qui était allé beaucoup trop vite.
La Rochejaquelein et Stofflet étaient également passés par le pont de
Mainclaye et s’étaient postés à l’Ouest de d’Elbée vers le lieu-dit Rassouillet.
Marigny quant à lui avait dépassé Bessay et poursuivi le chemin vers
l’Ouest le long de la Smagne en cherchant un gué. Il n’en trouva pas de
satisfaisant, s’égara dans les méandres de la rivière en direction du confluent
avec le fleuve Le Lay. Il avait donc préféré rebrousser chemin et venir passer
lui aussi par le pont de Mainclaye. Il arrivera finalement trop tard pour être
en réellement efficace dans la bataille.

Lithogravure
de Thomas Drake extraite de l’Album Vendéen (1856) et figurant la Bataille
de Luçon.
Charrette passe directement à l’attaque et rencontre les Républicains
qui se sont portés en avant pour lui barrer la route. Il fait reculer cette
première ligne mais pour l’instant les Républicains se contentent de le
contenir. Les hommes de Charrette, en arrivant à la forêt, aperçoivent alors devant
eux les canons cachés qui les mitraillent et derrière eux un grand vide au lieu
des autres troupes Vendéennes attendues. Ils s’imaginent à ce moment là être
trahis et arrêtent leur progression.

Cette
carte postale représente un escadron de dragons se rendant à l’exercice en juin
1914. Le cliché a été pris à peu près au même endroit que la gravure précédente
entre St Gemme et Luçon (donc pas à l’emplacement exact de la bataille). Mais elle
représente bien le paysage de la plaine».
Le général Tuncq pour sa part, se rend compte que d’Elbée n’est pas
encore prêt ou qu’il hésite à s’engager à cet endroit peu favorable à son armée.
Alors il fait donner toute son artillerie dans sa direction puis il envoie
aussitôt après plusieurs bataillons. Les Vendéens de d’Elbée marquent le pas
puis sont brusquement pris de panique et reculent. Les autres armées n’ont pas
le temps de rentrer vraiment dans la bataille. La panique se généralise, tous
n’ont plus qu’un objectif : refranchir le pont de Mainclaye et refluent vers
cet endroit. C’est durant cette période que meurent le plus de soldats Vendéens
fauchés par la mitraille de l’artillerie avancée jusque là. La Rochejaquelein
s’interpose et tente vainement de contenir les troupes républicaines. Les
combats font particulièrement rage vers le lieu dit Les Trois-Fontaines,
puisque c’est à cet endroit qu’il faut impérativement arrêter les Bleus pour
permettre l’évacuation par le pont.

La
croix des Trois Fontaines érigée par le Souvenir Vendéen en 1973.
Dans ce mouvement de panique, les soldats de Lescure et Royrand qui
sont en train de se replier en ordre sont à leur tour pris de panique.
Charrette, voyant ce qui se passe, abandonne le terrain conquis et vient
essayer de s’interposer entre les fuyards et les Républicains. Il réussit ainsi
à préserver une partie des troupes et leur permet d’arriver au pont de
Mainclaye. Malheureusement le passage est obstrué par une pièce de canon mal
engagée et restée en travers. Les hommes se bousculent au lieu d’essayer de
chercher un gué sur la Smagne, ce qui serait relativement possible en cette
saison. La panique cause encore de nombreuses pertes humaines à cet endroit. 4 000 à 5 000 morts environ resteront sur le champ de bataille alors que les Bleus
ne perdront que 100 à 200 soldats.
Le bataillon républicain « le Vengeur » se fera une sinistre
réputation en massacrant tous les blessés et en fusillant 700 prisonniers. Les
Vendéens rescapés de cet affrontement le lui feront payer lors de la bataille
du Camp des Roches, le 5 septembre 1793.
Les morts regroupés seront enterrés dans de larges fosses communes
creusées dans une prairie au Trois-Fontaines, le long de la route de Corpe à St
Jean-de-Beugné. En 1970 l’association Le Souvenir Vendéen, dirigée par Jean Lauprêtre,
fit construire un modeste calvaire de l’autre côté de la route à flanc de talus.
Il est représenté sur le plan par une croix latine noire à son emplacement
exact. Sur la plaque, installée sur le socle, on peut lire :
« Croix des Trois Fontaines / A la Mémoire / des 5000
Vendéens/ tombés devant Luçon/ le 14 aout 1793/ et enterrés pèle mêle sous le
pré / face à cette Croix/ Souvenir Vendéen 1973/ ».
Le pont est finalement dégagé et les Républicains
n’ont sans doute pas ordre de franchir la Smagne, mais les Vendéens ne le
savent pas et refluent toujours en désordre pour arriver au pont, le franchir
et évacuer les lieux le plus vite possible.

L’ancien
pont de Mainclaye vers 1905.
Le pont de Mainclaye que l’on peut voir sur cette carte postale de 1905
environ, datait du XVIIème siècle. C’est celui qui les Vendéens ont
emprunté le 14 aout 1793. Malheureusement les violentes inondations d’octobre
1960 l’ont endommagé et ont montré que la forme de ses arches contrariait énormément
l’écoulement des eaux. Il a donc été détruit et remplacé par un nouvel ouvrage,
situé 150 mètres
plus en aval. Les culées des arches de l’ancien pont ont été partiellement conservées
sur les berges. Et en 1980 le Souvenir Vendéen, placé à cette date sous la
présidence de notre ami Jean Lagniau (†), a fait poser à cet endroit une plaque
de bronze portant l’inscription visible ci-dessous.

La
plaque posée à l’ancien pont en 1980.
Dans ses « Souvenirs Vendéens », Amédée de Béjarry, officier de
Royrand dans l’Armée du Centre, nous raconte un incident survenu au début de
cette retraite :
« Une circonstance locale et
fortuite aggrava la déroute. Un seul chemin conduisait du pont à Bessay ;
il était étroit et encaissé. Au milieu était une fontaine. Les fuyards, dévorés
par la soif, se précipitèrent pour boire. En s’amoncelant autour de l’eau, ils
barrèrent le passage à une foule qui grossissait sans cesse. Au milieu de cette
masse humaine, l’artillerie dégagée de La Rochejaquelein voulut se frayer un
chemin, sans s’inquiéter des malheureux qu’elle écrasait. On se battit ;
plusieurs artilleurs furent tués : il fallut employer la force pour
rétablir l’ordre et, comme de coutume, les officiers se dévouèrent. On dégagea
la fontaine ; on l’entoura d’hommes solides, avec l’ordre de croiser la
baïonnette contre tout individu qui voudrait boire. (Un officier eut l’idée de
dire que la fontaine avait été empoisonnée par les Républicains. La peur du
poison fit plus que la consigne) ».
Le récit est extrêmement crédible puisque nous sommes au mois d’août
et qu’il fait très chaud. Cet incident, quand il était connu, était
généralement positionné à la fontaine Saint Bris, lieu de pèlerinage célèbre à
l’époque et situé dans la commune de Sainte Pexine. Pourtant, cela n’est guère
vraisemblable car celle-ci se trouve à plus de quatre kilomètres au Nord du
pont et n’est pas située près des endroits de passage des Armées Vendéennes. De
plus, Amédée de Béjarry habitant le château de La Roche-Louherie à Saint Vincent-Fort-du-Lay
(aujourd’hui Bournezeau), distant de huit kilomètres seulement, connaissait
évidemment la grotte Saint Bris et ses pèlerinages. Il n’aurait pas manqué de la
reconnaître et de l’indiquer tout à fait clairement.

La
Fontaine Saint Bris vers 1905, l’arceau est daté de 1721, une chapelle y a été
ajoutée en 1954.
Pour rechercher l’emplacement de la fontaine, il faut tout d’abord
tenir compte du fait que les souvenirs d’Amédée de Béjarry sont toujours
précieux mais que ses indications de localisation sont un peu approximatives, comme
nous avons déjà eu l’occasion de le constater ailleurs. N’oublions pas, à ce
sujet, que l’auteur du livre n’est que le fils du témoin oculaire, qu’il écrit
d’après des notes et 91 ans plus tard en 1884. De plus, les voiries ont
beaucoup évolué depuis plus de deux siècles et même l’ancien cadastre de 1821 (dit
napoléonien) raturé nous aide assez peu à retrouver les lieux anciens. En
effet, les terrains entre Bessay et la Smagne comprenaient au XVIIIème
et au début du XIXème siècle de nombreux fiefs de vignes qui ont été
ensuite remembrés.

La
Fontaine du Chêne-Robin aujourd’hui.
Au sortir du pont de Mainclaye, les Vendéens ont logiquement emprunté le
premier chemin à droite allant non pas vers Bessay au Nord mais au contraire
vers Sainte Hermine à l’Est (leur point de départ). Ils se sont donc dirigés, le
plus rapidement possible, en diagonale, suivant un axe allant du Sud-Ouest au
Nord-Est. De cette façon, Ils ont rejoint la route Bessay - Ste Gemme-la Plaine
(actuelle D 88). Et sur celle-ci ils ont du forcément passer entre le bois du
Chêne-Robin et la rivière La Smagne. D’autant plus que les soldats de l’Armée
du Centre (ceux d’Amédée de Béjarry) retrouvaient à cet endroit le chemin de
l’Aubonnière qu’ils avaient emprunté le matin pour se rendre à la bataille. Et
à ce point précis, tout près de la route, se trouve encore aujourd’hui la
fontaine du Chêne-Robin. Elle est représentée sur la carte par un point bleu à
l’emplacement exact. Et il nous paraît évident que le récit ci-dessus devient
possible à cet endroit. Ce dernier constituerait donc un Lieu de Mémoire lié
aux Guerres de Vendée et ABSOLUMENT MECONNU.
Lors du deuxième centenaire des Guerres de Vendée, le Conseil Général
du département, présidé alors par Philippe de Villiers, prit la décision de subventionner
les restaurations de certains monuments pour cette occasion. Nous avons
d’ailleurs eu l’honneur de rapporter personnellement le projet initial lors de
la séance du 19 juin 1992. L’ancienne église de Dissais venait d’être acquise
en 1991 par la commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais présidée par notre ancien
collègue Gérard Priouzeau. Elle fut restaurée dans le cadre des projets
départementaux et convertie en « musée des trois batailles de Luçon »
en 1993. Celui-ci permet de bien comprendre et imaginer les trois batailles qui
se sont déroulées dans la plaine voisine juste avant Luçon.

L’ancienne
église de Dissais en ruines vers 1900.
Toutefois, il est dommage que les sites, lieux de Mémoire ou édifices
ne fassent pas l’objet d’une signalisation routière comme nous en avons
l’habitude dans le bocage. Même les cartes de positionnement de ceux-ci sur
Internet ne sont pas toujours précises, aux Trois Fontaines il est inexact.
Chantonnay le 30 décembre 2016.

LA BATAILLE
DE GRAVEREAU
Dans les tous premiers jours du mois de mars 1793, l’existence de la
loi du 24 février prévoyant la levée en masse de 300 000 hommes était déjà
connue par la rumeur publique. La révolte grondait, tout d’abord dans les
Mauges (dans l’actuel département du Maine et Loire). Le décret établissant les
modalités d’application de cette loi parut le 8 mars. Il fixait notamment la
date du tirage au sort des appelés, prévue le mardi 12 mars 1793.
Le 11 mars le tocsin sonnait un peu partout au clocher des églises du
bocage. Le climat était particulièrement tendu, tout le monde était prêt à en
découdre. Les jeunes se rassemblaient, regroupaient des armes, allaient chercher
des chefs, multipliaient les embuscades contre les gardes nationaux ou les
simples provocations. Par exemple pendant la foire de l’Oie, le surlendemain 13
mars, ils venaient tous uriner sur le poste de garde républicain et
réussissaient à faire prisonniers les quelques soldats. Dans les environs, ils
parvinrent ainsi à convaincre Charles-Aimé de Royrand, ancien colonel de 70 ans
habitant le logis de la Brunière, qui devint le commandant en chef et
Louis-Célestin Sapinaud de Bois-Huguet, habitant le logis de la Verrie, qui fut
désigné comme adjoint.
Le premier « conseil de guerre » de ce groupe (qui deviendra
plus tard l’armée du Centre) se tint dans une maison du bourg voisin de Saint
Fulgent. Il décida, en prévision d’une attaque des Bleus, de
« fermer » le cours royal Nantes-Bordeaux, seule voie d’accès
nord-sud, en tenant le carrefour dit des Quatre-chemins de l’Oie et en
fortifiant le Pont Charron sur la rivière le Grand Lay.
Le 14 mars, au lendemain de la prise des Herbiers, les troupes vendéennes
se regroupaient à l’Oie. Elles venaient bivouaquer à l’Herbergement-Ydreau dans
l’enceinte fortifiée du vieux château féodal, construit aux XIIIème
et XVème siècles par les familles de Châteaubriant et de la
Trémoïlle.
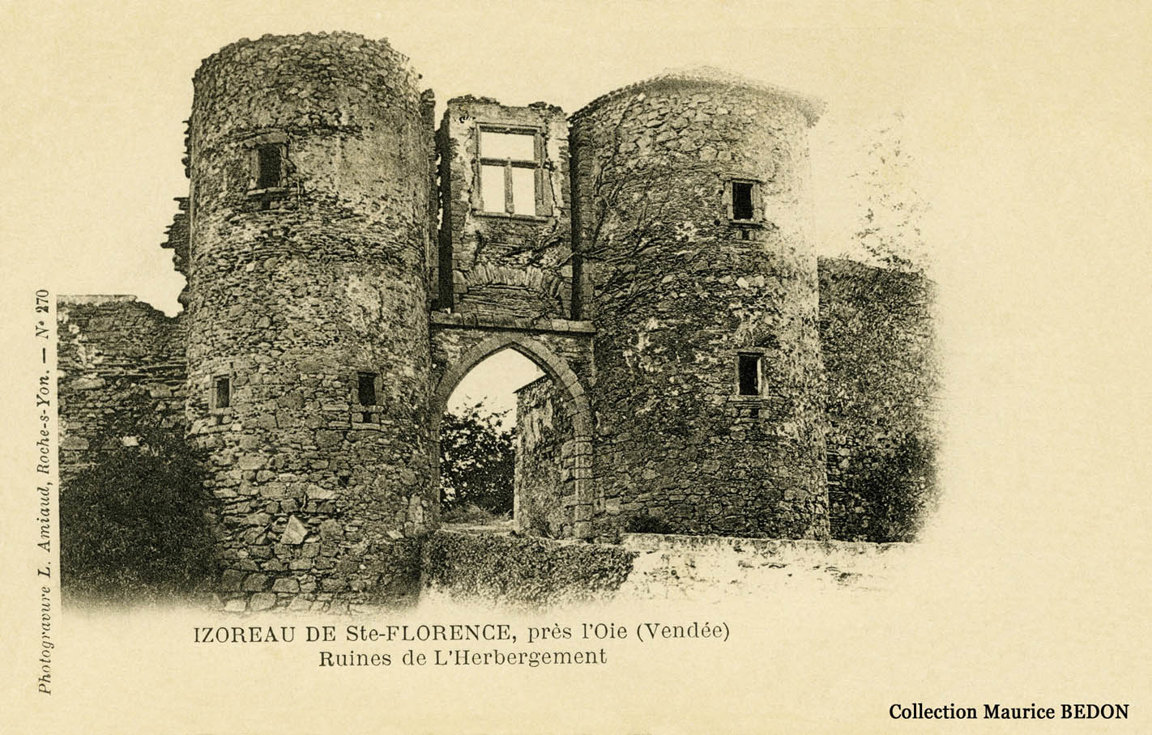
Le château de
l’Herbergement-Ydreau en 1900.
Cet édifice avait appartenu à partir de 1590 à la famille Sapinaud
seigneur de la Brethonnière. Et c’est le propre père du général Sapinaud de la
Rairie qui l’avait vendu en 1767 à Daniel-François de la Douespe seigneur du
Fougerais. Il s’agissait donc d’un ancien château familial, connu et
stratégiquement bien placé à proximité du carrefour des Quatre-chemins de
l’Oie. Ce sont les raisons pour lesquelles il deviendra par la suite camp
retranché, quartier général de l’armée du Centre et arsenal. Dans les textes du
XIXème siècle, il est indifféremment appelé « camp des Quatre-chemins »,
« château du Fougerais », « camp de l’Oie » et
« l’Herbergement ».

L’Herbergement-Ydreau, façade sur la
cour.
La première carte postale a été réalisée par Lucien Amiaud éditeur à La
Roche-sur-Yon au début de l’année 1900, sous le numéro 270. Elle nous montre
les restes de la porte fortifiée du château en ruines depuis l’incendie par la
colonne infernale du général Tuncq le16 juillet 1794. Depuis le début du XXème
siècle la fenêtre dominant la porte et la partie supérieure de la tour de
gauche se sont écroulées. La seconde carte est l’œuvre d’Eugène Poupin de
Mortagne-sur-Sèvre. Elle porte le numéro 115 et date de 1901. Le cliché,
représentant la façade du côté de la cour, est moins intéressant, mais
complémentaire.

Le Pont-Charron sur le Grand-Lay.
Pendant ce temps là à Chantonnay, le 15 mars 1793 à 8 heures du matin,
les commissaires Rouillé, Martineau et Mercicot, envoyés sur place par le
Directoire de la Vendée, écrivaient à leurs collègues pour exiger en
urgence : des armes, des cartouches, de l’argent, et 10 000 hommes
« pour venir à bout des insurgés, déjà maîtres de Mouchamps ». Peu
après, en fin de matinée, un groupe de ces insurgés, comme les appelaient les
commissaires, attaquait et prenait la ville de Chantonnay pratiquement sans
combat. Ils rencontrèrent les troupes républicaines cantonnées à Pont-Charron
avec 700 gardes nationaux. Ils furent repoussés assez vigoureusement. Toutefois
ils revinrent dans l’après midi du même jour avec des renforts commandés par de
Verteuil et du Champ Blanc. Et cette fois-ci, ils mirent les Bleus en déroute
qui abandonnèrent les munitions et la caisse du receveur contenant 3 400
livres. Des morts jonchaient le terrain parmi lesquels se trouvaient Pierre
Marchegay (de Lousigny) à Saint-Germain-de-Princay et Charles Querqui (du Châtelier)
à Puybélliard.
Le lendemain 16 mars, les Républicains revinrent à Pont-Charron par
Sainte-Hermine au sud mais ne parvinrent pas à reprendre la position et retournèrent
par la même route. Une partie des troupes se dirigea au passage, à l’ouest vers
la Réorthe en direction de Poëlfeu. Avec leurs canons ils bombardèrent le
château de La Roche-Louherie dans la paroisse de Puymaufrais (aujourd’hui
Bournezeau Saint-Vincent-Puymaufrais). Un groupe de soldats vint attaquer le
logis. Comme celui-ci n’était défendu que par trois vieux serviteurs, ils s’en
emparèrent facilement et le livrèrent aux flammes.

Le château de la Roche-Louherie vers
1900.
La gentilhommière de La Roche-Louherie, restaurée au XVIIIème
siècle, était occupée en 1793 par Charles-François de Béjarry, son épouse
Françoise de Regnon de Chaligny et leur nombreuse famille. Trois de leurs fils
furent officiers dans les armées vendéennes : Amédée, Alexandre et
Gaspard. Trois autres fils partirent en émigration dans l’armée des princes :
Benjamin, Prosper et Armand. Une fille périt dans les prisons du Mans. Enfin
quatre filles participèrent à la campagne d’outre-Loire : Antoinette,
Sophie, Aimée et Agathe.
Les ruines des bâtiments furent relevées au début du XIXème
siècle par Amédée de Béjarry qui avait survécu aux guerres de Vendée (il mourut
le 10 mai 1844). Le château, que nous pouvons voir sur la carte postale
ci-dessus a, pour sa part, été construit au même endroit vers 1875 par un
architecte nantais pour le petit fils du précédent (également prénommé Amédée).

Les grilles à l’entrée de la cour du château.
Les boulets de canons tirés par l’artillerie républicaine ont été
retrouvés au milieu des ruines de la gentilhommière lors des travaux de
reconstruction au XIXème siècle. Ils ont été ensuite conservés et
soudés aux piles métalliques constituant la clôture de la cour, comme on peut
le voir sur la photographie ci-dessus.

L’arche du pont de Gravereau.
Pour revenir à la bataille proprement dite, le lendemain de ce jour, le
17 mars 1793, le général Louis-Henri de Marcé (ci-devant comte) responsable de
la défense des côtes vint prendre en personne la direction des opérations. Avec
des gardes nationaux de La Rochelle et de Rochefort et les restes du 6ème
régiment d’infanterie, il attaque Pont-Charron. Malgré une énergique
résistance, débordés par le nombre, les Vendéens qui gardaient le pont sont
repoussés et laissent 40 morts sur place. Le soir même le général de Marcé
s’empare de Chantonnay pratiquement sans combat. Deux jours plus tard, le mardi
19 mars au matin il reçoit des renforts et dispose ainsi d’une armée assez
nombreuse (3 600 hommes selon Chassin, 2 400 selon Emile Gaborit), de 100
cavaliers et 8 canons. Sans laisser de temps de repos à ses troupes il décide
de quitter Chantonnay vers midi et de se diriger vers le nord pour faire sa
jonction avec les troupes attendues de Nantes. Pour ce faire, il reprend tout
naturellement le « cours royal » Nantes-Bordeaux (actuel RD 137)
seule possibilité sérieuse de traverser rapidement la région.
Les 200 hommes de son avant-garde, placés sous les ordres de l’adjudant
général Fresat, traversent le bourg de Saint Vincent-Sterlanges sans incident
et arrivent peu après au pont de Gravereau. Le pont n’est pas détruit mais sans
doute rendu infranchissable par un fossé ou une solide barricade. Vers quatorze
heures, le passage est rétabli et l’armée toute entière peut ainsi franchir la
rivière « Le Petit Lay » et poursuivre son avancée. Il est possible qu’en
attendant, les chevaux soient passés par le gué du moulin de Gravereau situé à
proximité immédiate.
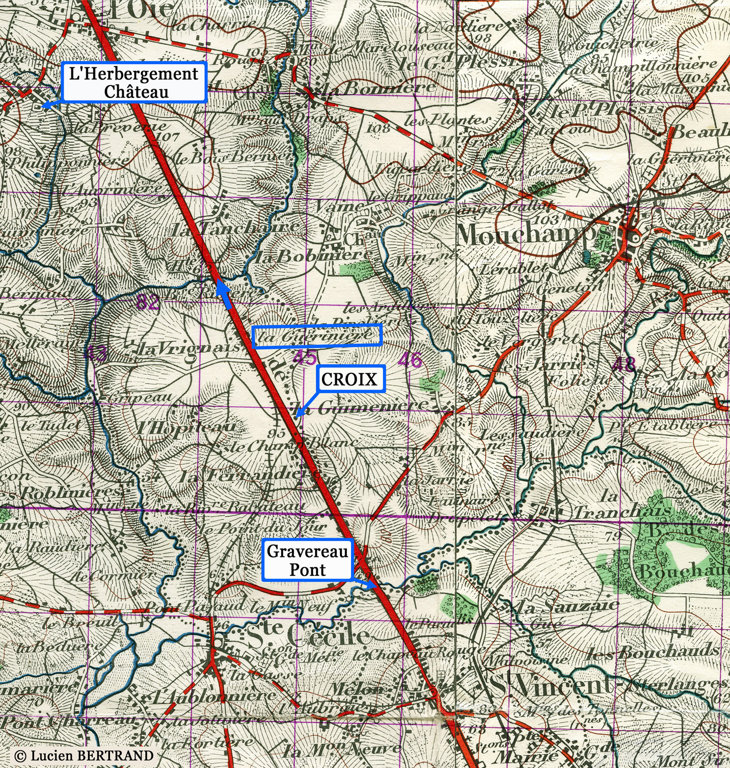
Carte de la Bataille dite de Gravereau.
Quatre kilomètres plus loin l’armée, après avoir traversé le village de
la Ferrandière (commune de Mouchamps), arrive sur la colline de La Guérinière
(commune de l’Oie). L’avant-garde de son côté est parvenue jusqu’au pont suivant
sur le Ruisseau du Parc. Ici aussi, il faut rétablir le passage obstrué et beaucoup
de temps est encore perdu. Le général de Marcé, arrivé à son tour à la
Guérinière, envisage à ce moment de bivouaquer pour la nuit dans cet endroit
calme et assez bien situé.
A cet instant, on aperçoit sur la colline en face, de l’autre côté du
ruisseau, en avant de la Tanchère, de vagues mouvements de troupes. Le général
donne aussitôt l’ordre de tirer plusieurs coups de canon dans cette direction.
Le commissaire du gouvernement en mission Niou lui déconseille fortement car il
est persuadé que ces hommes que l’on aperçoit sont en fait ceux de la légion
nantaise qui viennent, comme prévu, à leur rencontre. Et comme pour lui donner
raison on entend dans le lointain l’air du célèbre chant de la Marseillaise.
Ils font donc cesser le feu et envoient l’aide de camp Dardillouze en reconnaissance.
Ayant réussi à s’approcher discrètement, celui-ci voit nettement les paysans
vendéens et entend distinctement les paroles inattendues de cette curieuse
marseillaise qui disent :
« Allons les
armées Catholiques
Le jour de gloëre est
arrivé :
Contre nous de la République
L’étendant sanglant est
levé, etc... »
Ce chant devenu célèbre avait été transformé par
l’abbé Lusson, curé de Saint Georges-de-Montaigu.

La RD 137 actuellement.
La photo ci-dessus, prise au lieu dit La Guérinière en direction de
Gravereau, représente la RD 137 Nantes-Bordeaux aujourd’hui. Pour retrouver sur
cette photo le « cours royal » du XVIIIème siècle il faut
l’imaginer sans la chaussée bitumée, sans les lignes et signaux routiers, sans
les poteaux électriques, sans les arbres et la végétation au bord de la route
(celle-ci étant récente). Il faut enfin enlever mentalement la banquette à
droite qui avait été réalisée pour le chemin de fer à voie étroite, autrement
dit le Tram, de la ligne Montaigu à L’Aiguillon-sur-Mer. Ce dernier circulait à
cet emplacement durant la première moitié du XXème siècle.
Quand l’éclaireur revient au rapport, deux heures ont encore été
perdues à attendre. Les premiers Vendéens ont déjà attaqué l’avant-garde au
niveau du pont sur le ruisseau. Celle-ci devant l’attaque frontale tient le
coup et conserve la position. Pendant ce temps, tous les Vendéens, commandés
par de Royrand, Sapinaud de la Verrie et Amédée de Béjarry, cachés par les
haies ont progressé dans les champs et sont prêts à encercler l’armée
républicaine. Cette dernière, en position de simple repos d’attente, s’étire
tout le long de la route. Il faut préciser que les soldats hésitent à quitter
la route, le seul endroit fiable dans le contrée, d’autant qu’il a plu un peu
avant et que les terres agricoles sont détrempées en ce mois de mars.
Les Vendéens, qui ont pris le temps d’encercler cette armée toute en longueur
sur la route, profitent de leur supériorité numérique pour attaquer partout en
même temps vers 18 heures. La résistance est très inégale. Certains points
résistent mieux : l’avant-garde au niveau du ruisseau, l’état-major à la
Guérinière, et l’arrière-garde près du pont de Gravereau.
Par contre, ailleurs les Vendéens enfoncent facilement le dispositif.
Les premiers soldats fuyant vers le sud gênent ceux qui voudraient résister. L’artillerie
n’est plus positionnée pour ce genre d’attaque. Il faut préciser que les
troupes arrivées en renfort à Chantonnay étaient des soldats tout juste
incorporés, sans expérience militaire et de plus épuisés par quarante
kilomètres de marche. La nuit commence à tomber rapidement, le général est
débordé et la panique est maintenant générale. Les Bleus se sauvent en abandonnant
tout sur la route. Ils ne pensent plus qu’à repasser le pont de Gravereau vers
lequel ils se précipitent en désordre. Ils se sauveront ensuite en désordre, toujours
vers le sud et ne pourront être regroupés qu’à Marans.
A trois heures du matin les Vendéens sont totalement
maîtres du champ de bataille. Ils peuvent récupérer à cet endroit tous les
fourgons de l’armée contenant les vivres et surtout des fusils, de la poudre
ainsi qu’un canon. Ils vont pouvoir désormais remplacer leur faux par un fusil
et disposer d’artillerie .Les historiens du XIXème siècle évaluaient
le nombre des morts à 750 environ, républicains pour les deux tiers au moins. A
notre époque on estime que les chiffres de 400 morts républicains et 30
vendéens seulement seraient plus proches de la réalité.
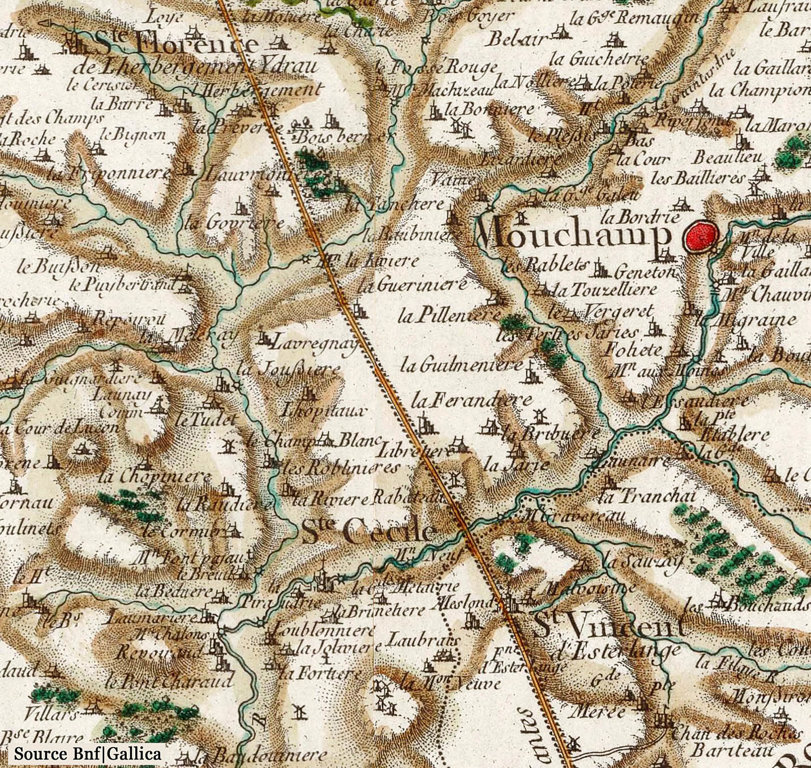
Fragment de la carte de Cassini du
XVIIIème siècle.
Le résultat de cette bataille ne fut connu dans la capitale que
quelques jours plus tard, le 23 mars 1793. Les membres du Comité installés,
comme la Convention, au palais des Tuileries à Paris, recherchèrent sur une
carte l’endroit précis de ce premier grand affrontement. Ils utilisaient bien
entendu à cette fin les cartes tracées au cours du XVIIIème siècle
par Cassini. C’est précisément le fragment concerné qui est reproduit ci-dessus.
Quand ils eurent trouvé Gravereau sur la carte et s’être rendu compte qu’il se
situait dans le nouveau département de la Vendée, ils prirent l’habitude de ne
parler que de ce dernier. Et c’est ainsi que toute l’Insurrection de l’Ouest (à
l’origine plutôt angevine) devint désormais et pour tous « La Guerre de
Vendée ».
Les armées vendéennes emportèrent leur butin au château de
l’Herbergement-Ydreau. Et celui-ci devint alors un camp de regroupement, un
arsenal et le quartier général de l’armée du Centre.
Dans les jours qui suivirent les troupes de Royrand parcoururent les
environs de Chantonnay pour s’assurer que leurs ennemis n’y avaient pas laissé
de petites garnisons de soldats. Au début du mois d’avril suivant les Bleus
essayèrent bien par deux fois de reprendre Pont-Charron mais en vain, car ils
furent repoussés à chaque fois par les 800 paysans commandés par Amédée de
Béjarry.

La croix de La Guérinière.
En 1949, l’association « Le Souvenir Vendéen »
décida d’installer un calvaire pour rappeler le souvenir de cette bataille et
en marquer l’emplacement. Entre plusieurs endroits possibles, ils choisirent
d’installer la croix au sommet de la colline de la Guérinière à peu près à
l’emplacement où devait se trouver l’état-major républicain. Le préfet de la
Vendée avait essayé, sans succès, d’empêcher l’inauguration car il craignait
que, peu après la libération à la fin de la seconde guerre mondiale, elle ne
suscite des réactions farouchement hostiles. La croix qui a été installée est
l’œuvre de l’architecte Louis Esgonnière du Thiboeuf (Bournezeau). Sur la photo
ci-dessus, très récente, on peut s’apercevoir que le double cœur vendéen en
bronze a été volé.

La plaque sur le socle de la Croix.
La belle plaque de bronze posée sur le socle de la croix porte
l’inscription suivante : « Ici fut remportée // le 19 MARS 1793 // par les
gars du bocage // commandés par // Royrand et Sapinaud // LA VICTOIRE // qui
donna son nom // Aux Guerres de Vendée // souvenir vendéen 1949.

Animation historique lors de
l’inauguration.
En 1993, dans le cadre des commémorations du bicentenaire des Guerres
de Vendée organisées par le Conseil Général, des travaux étaient envisagés au
monument de la Guérinière. Il était prévu de reculer la croix, située trop près
de la grande route et d’aménager autour un parking, une mini aire de repos et
un espace paysagé. Il s’avéra en fin de compte que le calvaire, de par son état
et sa conception d’origine, ne pourrait pas être déplacé sans dommage. Le reste
des travaux fut réalisé mais le nouvel emplacement prévu pour la croix est
resté vide. La cérémonie d’inauguration était prévue le 5 septembre 1993, le
même jour que la bénédiction du nouveau monument du camp des Roches à Saint
Germain-de-Princay. La cérémonie à la Guérinière commençait par une animation
représentant un combat entre troupes républicaines et vendéennes.

Un groupe d’acteurs de l’animation.
La photo ci-dessus représente, à la suite de l’animation lors de
l’inauguration, le groupe des acteurs costumés issus des bénévoles du spectacle
du Puy-du-Fou.

L’inauguration des aménagements de la
Guérinière.
Le cliché ci-dessus montre cette fois-ci la cérémonie d’inauguration
proprement dite. Philippe de Villiers Président du Conseil Général coupe le
ruban qui, selon les usages du pays, est tricolore. Deux petites Vendéennes lui
ont présenté les ciseaux sur un coussin. Il est entouré, de gauche à droite par
votre serviteur (à cette date Conseiller Général du canton de Chantonnay),
Michel Crucis Sénateur-Maire de Chantonnay, Emmanuel Catta Président du
Souvenir Vendéen, Bertrand de Villiers Conseiller Général du canton des Essarts
et Ernest Soulard Maire de l’Oie. Conformément à la coutume, le ruban est
soutenu par les élus ayant participé activement au projet. Philbert Doré-Graslin,
un des principaux initiateurs, n’est malheureusement pas visible sur cette
photo. On aperçoit au fond les participants, comptant environ 300 personnes et
les cars. La manifestation, commencée au monument de Pont-Charron à Chantonnay
devait se poursuivre ensuite à Saint Germain-de-Princay.
 Le site actuel de la Guérinière.
Le site actuel de la Guérinière.
Sur cette dernière photo on peut voir le site actuel de la Guérinière
en bordure de la RD 137. On distingue la croix à gauche, l’aire de repos et
tout à droite le pupitre en bois portant des indications sur le déroulement de
la bataille du 19 mars 1793.
Chantonnay
le 24 octobre 2016

LA BATAILLE DU CAMP DES ROCHES
5 septembre 1793
Après le
douloureux et meurtrier échec lors de la tentative pour prendre la ville de
Luçon le 14 Août 1793, les Vendéens avaient la volonté de prendre leur
revanche. Aussi, le nouveau Généralissime Maurice-Louis Gigost marquis d’Elbée
avait décidé, pour déstabiliser les Républicains, d’attaquer un camp retranché
établi dans le bas bocage vendéen, dit « Le Camp des Roches ».
Ce dernier
avait en effet été installé au lieu-dit Les Roches Barritaud essentiellement
sur le territoire de la commune de Saint-Germain-de-Princay. Toutefois, à
priori, rien ne nous indique que le village proprement dit ou le vieux château
appartenant à la famille de Beauharnais, situés à proximité immédiate, aient
été inclus dans le périmètre retranché.

Le camp
s’étendait en réalité des deux côtés du cours royal Nantes-Bordeaux et était
également traversé par le chemin dit des Petites Roches. Il allait au nord
jusqu’au village des Garnaudières de Saint-Vincent-Sterlanges. Il avait été
construit à cet endroit précis : - Tout d’abord parce qu’il permettait
ainsi de contrôler le seul axe routier valable traversant le département du
nord au sud ; - Ensuite parce d’ici il suffisait de verrouiller : le
pont de Gravereau au nord sur la rivière Le Petit Lay et celui de Pont-Charron
au sud sur la rivière Le Grand Lay pour éviter les incursions ; - Enfin
parce qu’il permettait d’intervenir d’ici au centre du bocage vendéen, aux
Herbiers, à Saint Fulgent, ou aux Essarts.
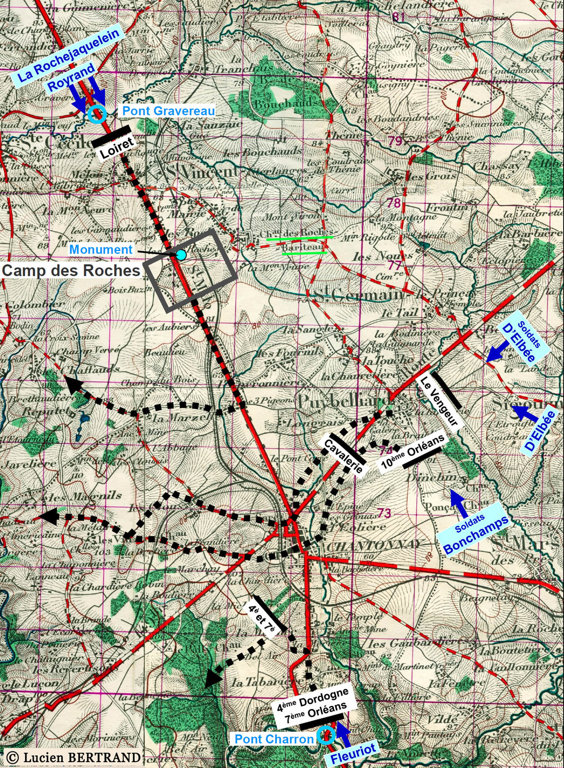
Le général
Royrand responsable de l’armée du centre et donc du secteur de Chantonnay avait
invité les autres généraux à le rejoindre aux Herbiers. Au début du mois de septembre,
18000 Vendéens étaient déjà rassemblés à cet endroit. L’attaque était prévue à
l’aube du 5 septembre 1793.
Les Républicains
connaissaient la menace et ils étaient informés par leurs éclaireurs et leurs
postes avancés des mouvements de troupes suspects, vers Saint-Prouant et
Monsireigne. L’état-major républicain avait donc établi son plan de défense en
disposant ses troupes aux endroits possibles des attaques : à Saint-Vincent-Sterlanges
au nord, à Puybélliard à l’est et à Pont-Charron de Chantonnay au sud. Tout le
côté ouest n’était pas défendu, mais, comme prévu, il n’a pas été attaqué. En
l’absence du général Tuncq, la bataille était commandée par le général Lecomte.
Ce dernier avait demandé au général Chaldos de le rejoindre, mais retenu à Fontenay
avec environ 3500 hommes, il ne pourra pas venir l’aider.
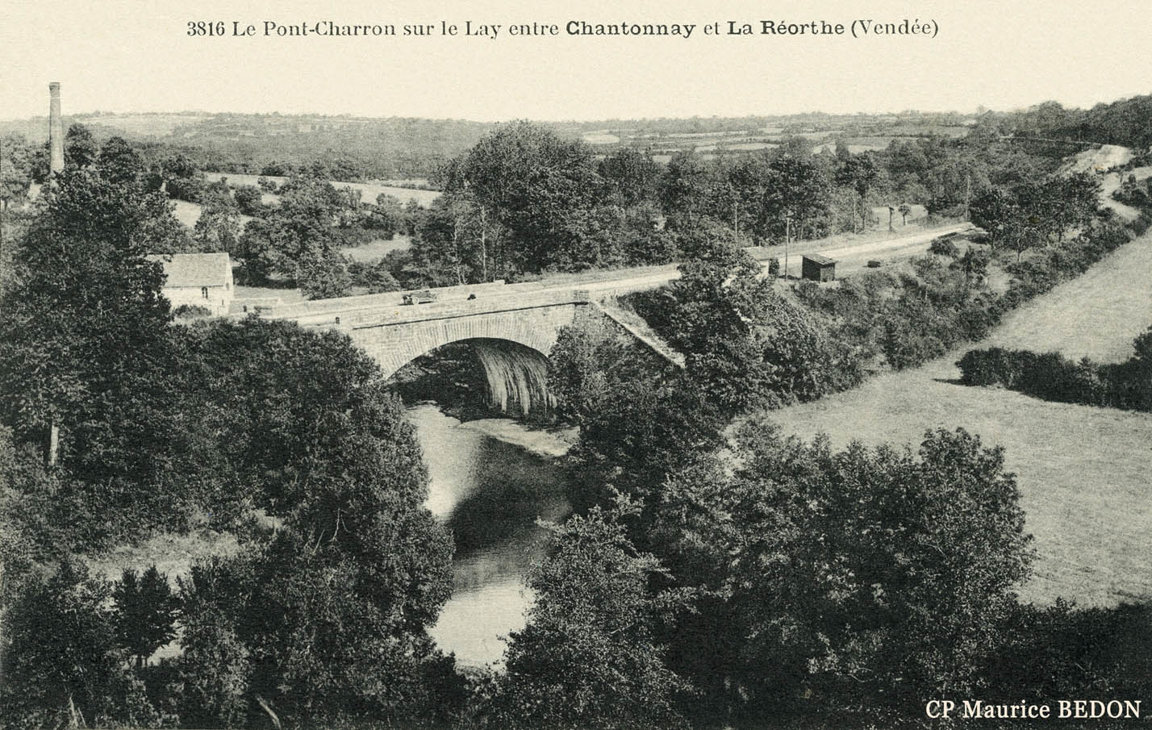
AU SUD, le général Lecomte avait envoyé le
7ème bataillon d’Orléans renforcer le 4ème bataillon de
la Dordogne qui avait en charge la garde du poste de Pont-Charron. Blessé,
Bonchamps n’avait pas pu venir mais il avait envoyé son armée sous les ordres
de Fleuriot. Ses troupes ont alors fait un mouvement tournant et arrivent par
le Boupère, Chavagnes-les-Redoux, Bazoges-en-Pareds. A partir de ce dernier
endroit, la partie principale de l’armée commandée par Fleuriot avec l’aide de
d’Autichamps avance par La Jaudonnière pour prendre le poste de Pont-Charron.
L’autre partie se dirige vers Saint-Mars-des-Prés puis Puybélliard.
A Pont-Charron,
les soldats bleus, dès qu’ils aperçoivent les paysans couvrir en très grand
nombre le sommet de la colline, vers le lieu dit le Lion situé à moins de 2
kilomètres, se sauvent en direction de Chantonnay sans tirer un coup de fusil
ni utiliser le canon. L’adjudant général Marceau s’efforce de les regrouper et
de leur faire reprendre position sur les hauteurs de la Tabarière, puis du
Riadet mais en vain car il est déjà trop tard. Il fait alors retraite en
direction des hauteurs de la Mouhée un peu plus loin vers l'ouest, où il
parvient un temps à leur faire garder cette position. Mais il est trop tard,
les Vendéens ont déjà commencé à investir le bourg de Chantonnay.

Les hauteurs de la Mouhée, le château n’a été
construit qu’en 1896.
L’adjudant-général
Marceau, voyant qu’il y a plus important à faire ailleurs, part alors avec un
groupe de soldats rejoindre les troupes à Puybélliard, en contournant
Chantonnay par le sud au lieu dit la Barbotière (appelé depuis le XIXème
siècle Le Moulinet) puis par les villages de l’Eolière et des Grouas. Sous la
pression de plus en plus forte des Blancs, les troupes restées à la Mouhée
finiront par abandonner totalement le terrain et se sauver dans les bois du
château du Pally situés à 1 km 500 derrière eux à l’ouest puis rejoindre
Bournezeau.

A l’EST, le général Lecomte avait dès le
début de la bataille envoyé le 10ème bataillon d’Orléans avec les
bataillons Le Vengeur, l’Egalité et l’Union repousser les vendéens à
Puybélliard. C’est effectivement à cet endroit que convergent trois armées
vendéennes. Au centre, le Généralissime d’Elbée lui-même avec ses Angevins
arrive par Chavagnes et Sigournais. A gauche les autres soldats de d’Elbée
arrivent par Saint-Prouant, Chassay-l’Eglise. A droite, ce sont les autres
soldats de Bonchamps qui viennent par Saint-Mars-des-Prés et les hameaux de
Ponsay et de Din-Chin. N’oublions pas qu’à la fin du XVIIIème siècle
il n’y a qu’une route vraiment digne de ce nom « le cours royal »
Nantes-Bordeaux (actuelle RD 137). Les grandes routes Bournezeau-Chantonnay-La Chataigneraie-Parthenay
(actuelle RD 149 bis) et Chantonnay-Pouzauges-Bressuire (actuel RD 160 bis)
n’existent pas encore puisqu’elles ont été construites au milieu du XIXème
siècle. Le passage par Puybélliard étant pratiquement inévitable, les Bleus
avaient donc logiquement concentré des forces à cet endroit.

Le bataillon
de Vengeur réussit dans un premier temps à faire reculer les assaillants
vendéens ; mais ils arrivent toujours de plus en plus nombreux et les Républicains
reculent à leur tour. L’adjudant général Marceau veut faire donner la cavalerie
qui est en position entre Chantonnay et Puybélliard, mais celle-ci refuse de
s’engager. Les récits de l’époque relayés par les historiens du XIXème
siècle nous affirment qu’ils l’ont fait sous « les prétextes aussi coupables
que frivoles ». En réalité, il est très facile de comprendre pourquoi la
cavalerie ne s’est pas engagée. Le terrain entre Puybélliard et Sigournais est
essentiellement couvert par les nombreux petits fiefs du vignoble de la
« Folle » de Sigournais et de petits jardins séparés par
d’innombrables murs en pierres sèches. Ces célèbres « murgets »
étaient bâtis par les propriétaires avec les nombreuses grosses pierres
trouvées dans le terrain et qui gênaient les cultures. D’ailleurs, on les
aperçoit sur la carte postale reproduite ci-dessous, en bordure du chemin. Ce
cliché a été pris vers 1910 sur le chemin de Sigournais à Puybélliard au même
emplacement où se sont déroulés une partie des combats. Le paysage n’avait
guère changé depuis 1793. La cavalerie se retire donc tout simplement parce que
le terrain n’est absolument pas approprié à une charge de cavalerie.

Les combats
sont particulièrement rudes à Puybélliard. Le général Lecomte y a envoyé en
renfort les 3ème et 6ème bataillons de la Charente
Inférieure. Ceux-ci repoussent encore une fois les Vendéens mais sous la
pression de plus en plus forte, les Bleus sont obligés de décrocher et reculent
de manière désordonnée en direction de Chantonnay. A cet endroit, ils
rencontrent alors une partie des troupes de Fleuriot qui, remontant depuis la
Tabarière, sont déjà arrivées jusque là. La bataille devient alors un ensemble
de simples corps à corps non planifié et parfaitement confus, ce qu’en terme
militaire on appelle « une bataille de soldats ». D’autres Vendéens
poursuivent leur marche en direction du Camp des Roches qui n’est plus distant
que de 4 km.
AU NORD, à proximité du Camp des Roches
proprement dit, le général Lecomte a envoyé 150 cavaliers et le bataillon du
Loiret. Ceux-ci en prévision de l’assaut se sont installés à la sortie au nord
du bourg de Saint-Vincent sur les terrains dominant la vallée du Petit Lay.
Pour les atteindre, les Vendéens doivent donc franchir la rivière sous le feu
de l’ennemi. Le pont de Gravereau, en partie détruit, avait été partiellement
rétabli par le général de Marcé à la veille de la bataille de Gravereau le 19
mars 1793. Il était donc en partie utilisable. De plus, au début du mois de
septembre, on pouvait encore facilement passer à gué sur la chaussée du moulin
de Gravereau situé à proximité immédiate.

L’entrée de
Saint-Vincent-Sterlanges au XVIIIème siècle était assez peu
différente de celle visible sur cette carte postale vers 1910, à l’exception
toutefois du calvaire et des poteaux télégraphiques. On aperçoit bien le cours
royal se dirigeant à perte de vue en direction des Quatre Chemins de l’Oie.
Royrand,
dont le quartier général était à Montaigu, était revenu du conseil de guerre
des Herbiers par Vendrennes et avait regroupé la majeure partie de ses soldats
à L’Oie. L’Armée du Centre avait en effet établi dans cette commune, depuis le
16 mars 1793, un camp fortifié et un arsenal dans l’enceinte du château féodal
de l’Herbergement-Ydreau (dit camp des Quatre Chemins). Arrivé à Gravereau à 5
heures du matin, Royrand est prêt à attaquer mais il attend d’entendre tonner
au sud les canons de Pont-Charron pour se coordonner avec les autres armées. Il
attend en vain puisqu’à Pont-Charron les Bleus se sont sauvés comme nous
l’avons dit plus haut. Il se résout finalement à attaquer mais il sait que son
rôle consiste seulement à contenir ses adversaires à cet endroit. L’attaque
devient difficile car les Bleus sont en bonne position sur les hauteurs de
Saint-Vincent et derrière la rivière le Petit Lay. Il marque le pas et doit
faire donner l’artillerie de Rostaing pour pilonne les positions des Bleus.
Après l’arrivée d’Henri de La Rochejaquelein il intensifie l’attaque et
repousse les Bleus en direction du Camp des Roches qui n’est distant que de 2
km.

Quand
Royrand arrive à son tour au Camp des Roches, qu’il a fait pilonner par son
artillerie, il est largement dégarni de ses troupes et la plus grande confusion
y règne déjà. Toutefois, les redoutes du camp tentent encore de résister. Ici
aussi la bataille se transforme en un combat au corps à corps farouche. Il est
tard, la nuit tombe, les Bleus finissent par abandonner le camp et font
retraite en direction de Chantonnay. Ils rencontrent alors leurs collègues qui
de leur côté fuyaient Chantonnay en espérant pouvoir se refugier au camp. Ils
se sauvent tous en prenant les chemins qui se dirigent vers l’ouest en
particulier celui des Trois-Pigeons, La Salverse, La Marzelle. Ils continueront
leur route par Saint-Hilaire-le-Vouhis puis Bournezeau jusqu'à La
Roche-sur-Yon.
Toutefois,
les combats se poursuivent encore, surtout aux abords de Chantonnay du côté de
Puybélliard mais dans un désordre total. Des compagnies républicaines entières
ont déjà abandonné le terrain. Il est 9 heures du soir, seul le général Lecomte
résiste encore au milieu des fragments de quelques bataillons presque cernés.
Une heure plus tard, comprenant que tout est perdu, il abandonne et part par la
route de Chantonnay à Saint-Hilaire-le-Vouhis. La bataille est terminée.
S’apercevant que certains Bleus sont montés aux arbres pour se cacher dans les
feuillages, les Vendéens vont chercher des lanternes pour les descendre plus
facilement. Les trois cents hommes du bataillon le Vengeur considérés comme
responsables des massacres de Luçon vont tous être exécutés.
Les
estimations les plus généralement admises fixent aux alentours de 4500 le
nombre de tués dans cette bataille (2/3 de Bleus et 1/3 de Blancs). Certains
historiens parlent de 2000 morts, d’autres sont allés jusqu’à 7000. Les Vendéens
récupèrent à cette occasion : 60 véhicules de vivres ou de munitions, plusieurs
canons et beaucoup de fusils. Cette victoire vendéenne entraîne la destitution
du général Tuncq mais ces résultats sont sans lendemain malgré son coût en vies
humaines. En effet, quelques jours plus tard, le général Lechelle vient
incendier Bournezeau et quelques villages environnants. Et, dès le 15 septembre,
le général Beffroy réussit à reprendre Chantonnay presque sans combat. Ses
soldats en profitent pour incendier le château du Pally à Chantonnay et celui
de Sigournais.
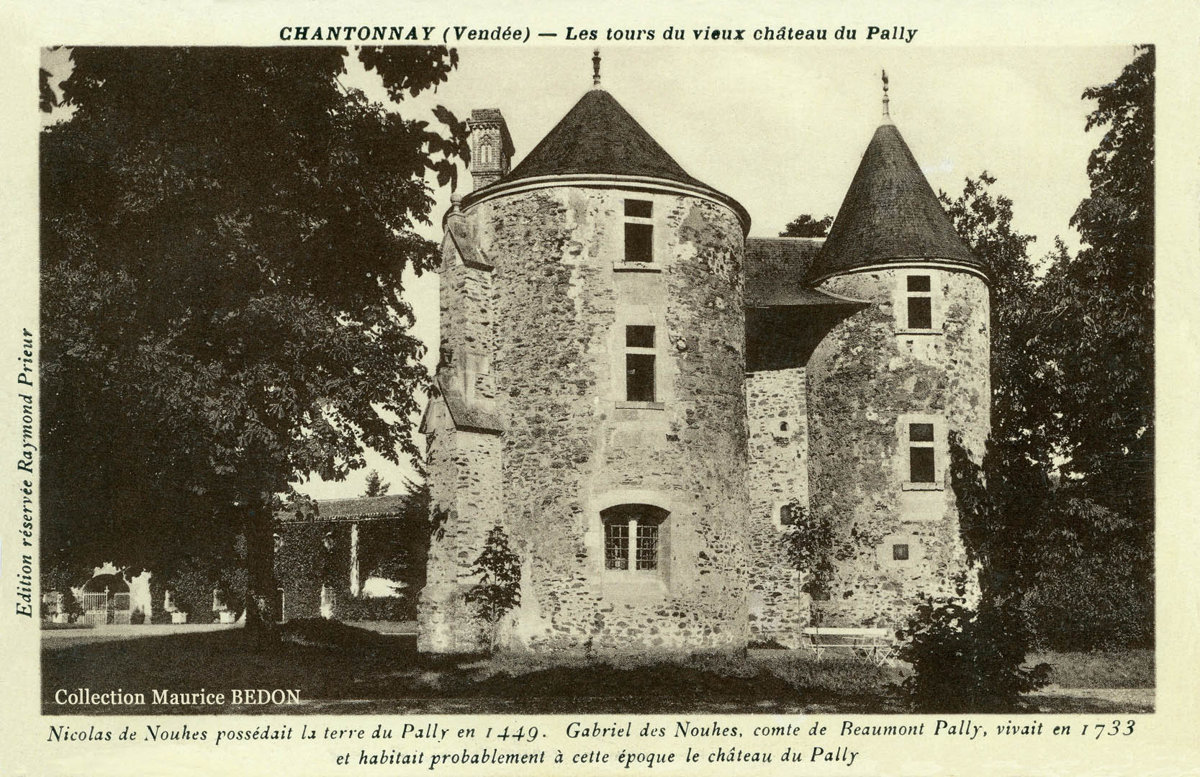
Les restes du vieux château du Pally
Si on
réfléchit aux conséquences de ce combat sur le terrain, on est amené à se
demander à quels endroits ont pu être enterrés ces très nombreux cadavres. Officiellement,
nous ne le savons pas. Les traditions orales viennent tout de même nous fournir
quelques indications plus ou moins fiables. A la sortie nord de
Saint-Vincent-Sterlanges, en direction de Gravereau un grand champ, sur la
gauche, a la réputation de contenir les corps des Vendéens. C’est possible
puisque nous sommes ici pratiquement à l’emplacement des combats. En outre,
indication fort précieuse et significative, le lieu-dit situé juste en face
porte, depuis le XIXème siècle, le nom de : « Le
Paradis ». Un autre champ attenant à de la RD 137 et le chemin des Petites
Roches, devant le monument actuel est désigné comme contenant les corps des Républicains.
Ce n’est pas du tout impossible. On sait par ailleurs qu’en 1880, l’historien
local Louis Brochet a découvert non loin, près d’un fossé, un squelette avec un
fusil brisé, un chapelet et une cuiller en étain. Enfin un troisième champ
entre Chantonnay et Puybélliard, près du lieu-dit Pierre Brune, était également
censé contenir des morts des guerres de Vendée. Malheureusement quand on a
installé, à cet endroit, la zone industrielle, à notre connaissance, il n’a
rien été trouvé !

Dans le
cadre de la préparation par le département de la Vendée des commémorations du
bicentenaire des Guerres de Vendée en 1993, l’association « Le Souvenir
Vendéen » souhaitait élever un monument de granit en forme d’obélisque à
l’emplacement du Camp des Roches (c'est-à-dire dans la commune de
Saint-Germain-de-Princay), pour rappeler le souvenir de cet événement. Le Vice-Président
Philbert Doray-Graslin et votre serviteur, à l’époque Conseiller Général du
canton de Chantonnay, s’étaient chargés du suivi du dossier, de la surveillance
des travaux et du financement par le département. La plaque gravée sur
l’obélisque porte l’inscription suivante : « Ici était établi / LE
CAMP DES ROCHES / conquis par les Vendéens / le 5 septembre 1793 / Souvenir
Vendéen 1993 ».

La photo
ci-dessus nous montre l’inauguration et le dévoilement de la plaque puis la
bénédiction du monument, le 5 septembre 1993. On reconnaît sur la photo, de
gauche à droite : Le chanoine Loiseau représentant de l’Evêque de Luçon
(habillé pour la Bénédiction), le Maire de Saint Germain-de-Princay Gustave
Gautron, Philbert Doray-Graslin vice-président du SV, votre serviteur, le
Président de l’association Le Souvenir Vendéen Emmanuel Catta (de dos) et enfin
Philippe de Villiers, Président du Conseil Général (en
partie caché).

La photo
ci-dessus et la suivante ont été prises le Samedi 7 septembre 2013 lors de la
cérémonie d’anniversaire des 20 ans du monument. Cette sympathique
manifestation avait été organisée par Ghislaine Herbreteau Présidente de
l’Association : « Les Brigands du Bocage ». Les participants
avaient tout d’abord procédé au dévoilement d’une plaque posée en l’honneur de
Gaspard de Béjarry au logis de Froutin, avant de participer à un dépôt de gerbe
au Camp des Roches, puis d’assister à la messe célébrée par l’abbé Loddé dans
l’église paroissiale de Saint-Germain-de-Princay et enfin d’écouter une
conférence de l’historien Reynald Sécher intitulée « du Génocide au
Mémoricide ».
Chantonnay le 12 Mai 2016

Dans un premier article
figurant sur « Les pages d’Histoire » du nouveau blog en construction
de « La Chouette de Vendée » nous avions évoqué les circonstances et
le lieu du décès du général Louis-Célestin Sapinaud de la Verrie.
Depuis cette date,
plusieurs lecteurs (et des plus illustres) nous ont demandé s’il y aurait une
suite. Aussi, nous avons pensé poursuivre précisément le même récit en nous
interrogeant :
OU
EST LA TOMBE DE SAPINAUD DE LA VERRIE ?
Nous avions vu dans le
précédent article que l’adjudant-général Canier avait franchi de nuit la
rivière Le Grand Lay au gué non défendu de la Salissonnière. Il s’était ensuite
avancé pour prendre à revers le poste vendéen installé au Pont Charrault dans
la nuit du 24 au 25 juillet 1793, vers trois heures du matin. Le général Sapinaud
accompagné d’une trentaine de cavaliers avait surgi à ce moment-là et avait été
tué. Avec lui, Jouffrien de Bazoges et vingt autres cavaliers étaient restés
sur le terrain.

Conformément aux ordres
qu’il avait reçus, Canier prit alors le chemin suivi par les Vendéens, mais en
sens inverse, pour se rendre à Pont-Charron et prendre ici aussi les Vendéens de
ce poste à revers. Pendant ce temps, son supérieur le Général Tuncq, arrivant
de Sainte Hermine par le cours royal, avec 1200 fantassins et 80 cavaliers,
attaqua frontalement Pont-Charron. Les Vendéens, découragés par la mort de leur
général, fléchirent, abandonnèrent le terrain mais se regroupèrent à peu de distance
au nord pour résister à une avancée dans le bocage. Les Bleus investirent
Chantonnay, capturèrent des bestiaux et peut-être même incendièrent les
premières maisons du bourg, mais ils ne s’y installèrent pas à demeure. Dans
son livre « Souvenirs Vendéens » Amédée de Béjarry y fait allusion : « Ceux-ci
(les Bleus) ne l’osèrent pas. Entrés dans le bourg, ils prirent à la hâte ce
qu’ils trouvèrent et repassèrent le Lay, n’osant pas essayer de garder des
postes importants qui leur auraient permis de porter en avant leur ligne
d’opération ». De son côté Louis-Dominique Ussault (un des dix cavaliers
de l’entourage de Sapinaud rescapé) en a fait le récit suivant : « J’y perdis mon cheval et fus blessé.
Trois heures après l’affaire, je me transportai sur le lieu du combat près de
la Fenestre et les Gaubardières et fis enlever vingt-deux cadavres qui furent
déposés dans le cimetière de Chantonnay ». Ussault nous a déjà démontré
qu’il usait souvent d’une large approximation géographique. La Fenestre et les
Gaubardières sont respectivement à 1
km 600 et 1
km 400 du lieu du combat. Il est également peu probable
qu’il ait eu la possibilité et le temps de faire transporter les corps
« trois heures plus tard » c'est-à-dire en fin de journée du 25
juillet, mais bien plutôt le matin du 26 juillet. En revanche, il vient
confirmer la tradition orale selon laquelle les corps auraient été emportés au cimetière
de Chantonnay et non à celui de Saint Philbert. Ce qui est, à priori,
surprenant car le cimetière de Saint Philbert est situé à peine plus d’1 km alors
que celui de Chantonnay est à 4
km 500. Mais cette décision était somme toute logique
car Saint Philbert-du-Pont-Charrault, situé au-delà du Lay, n’appartenait pas à
la Vendée Insurgée. Enterrer les corps à Saint Philbert aurait donc équivalu à
les placer en territoire ennemi.

Aussi, le lendemain 26,
quelques Vendéens partirent à la recherche des corps de Sapinaud et de ses
vingt et un compagnons. Ils les ramenèrent à Chantonnay et les inhumèrent dans
une fosse commune creusée au cimetière de la ville. Ce dernier était situé à
cette époque à l’emplacement de l’actuelle place Carnot (dénomination peu
opportune). La tradition orale, transmise par la famille Décran, fossoyeurs de
père en fils, affirme qu’ils ont été placés « à peu de distance derrière
le calvaire au milieu du cimetière ».

Cadastre de 1824
A l’époque de la
Restauration, il n’y a pas eu à notre connaissance de transfert des corps ni
même de projet de monument commémoratif. Par contre la tombe a
vraisemblablement été respectée, d’autant plus que la commune ne manquait pas
de place. En revanche, à partir du milieu du XIXème siècle la place
manqua cruellement dans le cimetière, au point que l’on commença à enterrer les
morts dans le champ attenant au sud. De plus, la Municipalité de l’époque,
comme le gouvernement, étaient peu favorables au souvenir des guerres de
Vendée. Il est donc très vraisemblable que le terrain fut réutilisé à ce moment
là. Comme on le faisait couramment à l’époque, on opéra une réduction de
squelette. C'est-à-dire que les ossements furent très probablement regroupés et
enterrés plus profondément au même endroit, selon l’usage.
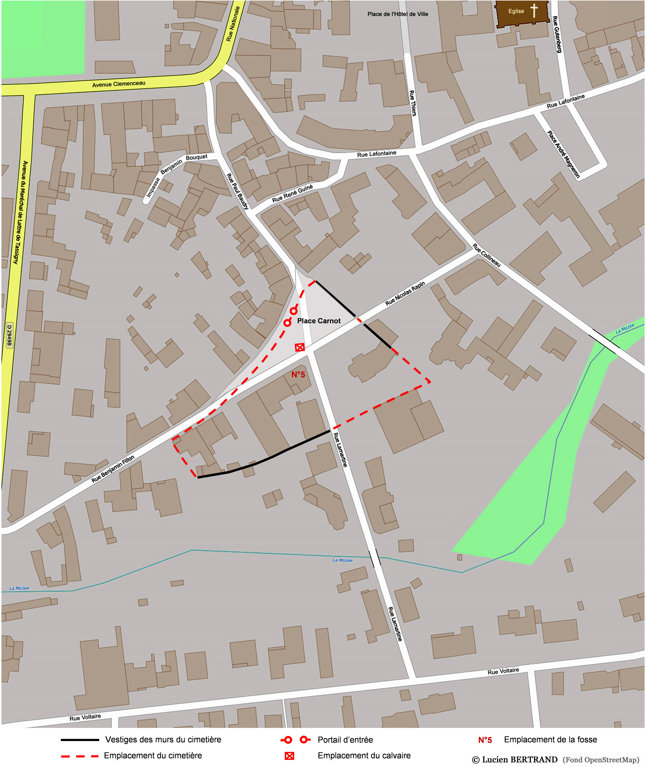
De toute façon, en 1878
la commune de Chantonnay ouvrit le grand cimetière actuel, dans la plaine de
Charlère, en bordure de la route de la Châtaigneraie. A partir de ce moment là,
les familles eurent dix ans pour éventuellement y transférer les corps de leurs
défunts inhumés dans le vieux cimetière. La partie ouest de cet ancien
cimetière devint une place publique (le champ de foire aux cochons) inaugurée
le 14 juillet 1890. La partie orientale fut lotie pour construire une série de
maisons et coupée au centre par la nouvelle rue Lamartine. En réalité, les frères
Brochet, industriels, achetèrent tout le terrain et y construisirent à partir
de 1891 leurs deux maisons, leur atelier et les petites maisons de la cité
ouvrière. Ainsi, la première maison faisant l’angle (actuel numéro 5 place
Carnot) fut pratiquement construite au dessus de l’ancienne fosse contenant le
corps de Sapinaud de la Verrie. Comme la commune de Chantonnay ne possédait pas
d’ossuaire à cette date (il ne fut construit qu’en 1910), les maçons enfouirent
très certainement les ossements plus profondément au même endroit comme ils en
avaient alors l’habitude. Il ne devait évidemment rester de ces ossements déjà
déplacés que quelques petits éléments et de la poussière, mais il est très
probable qu’ils s’y trouvent encore. Il n’existe donc plus aujourd’hui, à
proprement parler, de tombe de Sapinaud de la Verrie. On pourrait toutefois
envisager qu’une inscription à cet endroit puisse en perpétuer le souvenir.

Sur la photo ci dessus,
cette maison est visible au centre avec ses ouvertures en briques rouges,
l’arbuste et le stop marquant l’emplacement du calvaire. Ajoutons que par une
coïncidence amusante cette construction est aussi la maison natale de l’auteur
de ces lignes.
Chantonnay
le 25 mars 2016

LA MORT DE SAPINAUD DE LA VERRIE

Dans le bulletin N° 4 de la revue « Le Cri
de la Chouette » en 2013, nous nous étions interrogés sur l’emplacement
exact de la tombe de Sapinaud de la Verrie à Chantonnay. Nous allons compléter
ces propos en évoquant ici les circonstances mêmes de la mort de celui-ci. Cet
événement avait été rappelé, les 1er mai 2013 et 8 mai 2014, quand
l’association « les Brigands du Bocage » avait procédé au
débroussaillage de la croix de Pont-Charron, située rue du Bazar, au village de
la Tabarière à Chantonnay.
Le contexte général de ce décès est désormais
connu. En Juin 1793, le général Royrand, responsable de l’Armée du Centre,
installé à Montaigu, avait chargé son adjoint Louis-Célestin Sapinaud de Bois
Huguet dit «de la Verrie » de surveiller les ponts sur le Lay parce qu’ils
étaient considérés à l’époque comme « la Porte du Bocage ». Ce
dernier avait alors installé son propre quartier général à Chantonnay au Grand-Logis,
demeure de Constant Marchegay de Ludernière. Cette demeure, qui existe encore,
a été jusqu’à ces dernières années la résidence de Monsieur Michel Crucis
sénateur-Maire de Chantonnay et Président du Conseil Général (3 avenue Henri
Rochereau).
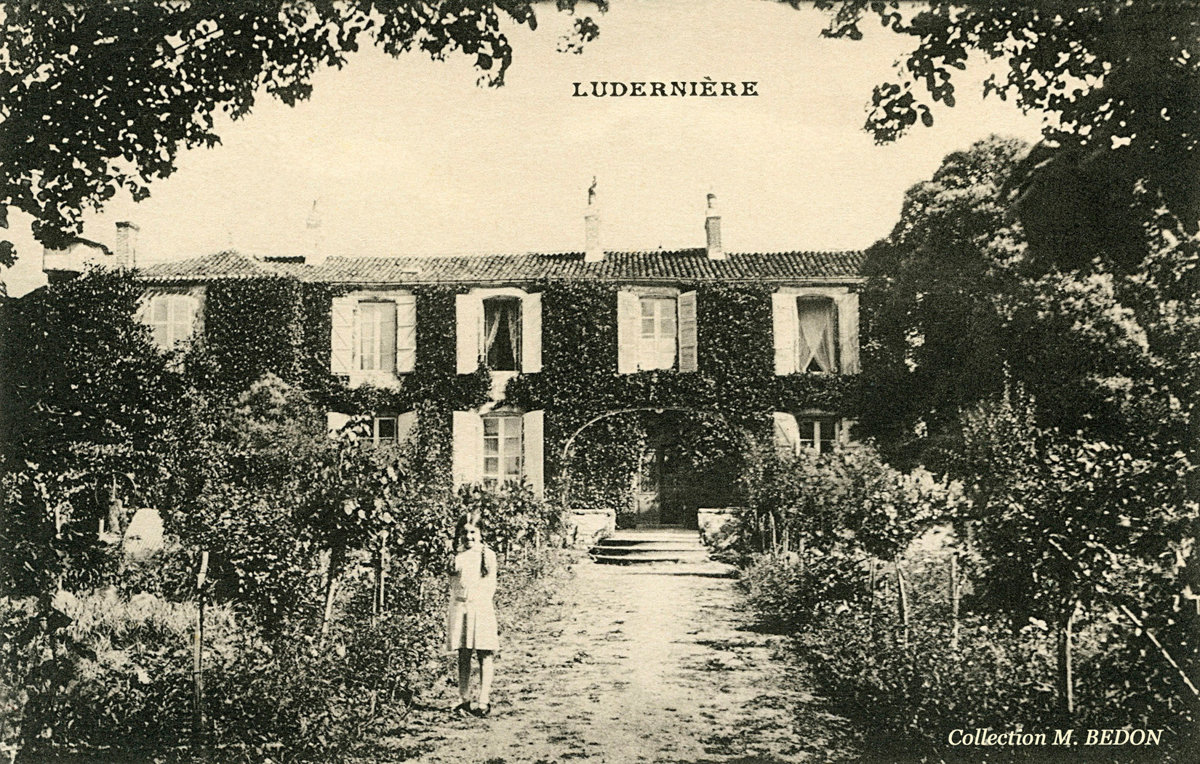
Or, dans la nuit du 24 au 25 juillet 1793,
vers trois heures du matin, les Bleus, commandés par Canier et sous la conduite
d’un guide félon, franchirent la rivière le Grand Lay au gué de la
Salissonnière (7). Ils s’avancèrent ensuite pour prendre à revers les avant-postes
vendéens de Pont-Charrault (situé en aval). Les renseignements météorologiques
du mois de juillet 1793 nous apprennent que cette nuit la pleine lune avait
encore 96 % de sa luminosité. Prévenu en pleine nuit, alors qu’il dormait à son
quartier général de Chantonnay, Sapinaud se précipita à cheval et se dirigea
tout d’abord vers Pont-Charron au sud. Ce fameux pont à une seule arche faisait
l’admiration générale des environs et avait été construit par les ingénieurs du
roy Louis XV, vers 1750, sur le cours royal Nantes-Bordeaux (actuel RD 137).

A partir de là, les renseignements sont peu
précis, voire divergents. Le 3 octobre 1948, le Souvenir Vendéen a inauguré un
calvaire sur les hauteurs de Pont-Charron qui porte l’inscription
suivante : « En souvenir des Vendéens du Bocage et de leur général
Sapinaud de la Verrie glorieusement tombés au Pont-Charron, 19 mars et 25
juillet 1793, Souvenir Vendéen 1948 » (2). Ce texte a souvent porté à
confusion. En réalité, le Souvenir Vendéen a voulu commémorer à cet endroit les
différents combats de Pont-Charron et évoquer par la même occasion la mort de
Sapinaud de la Verrie. Toutefois, l’inscription ne dit pas expressément que ce
dernier soit mort précisément à Pont-Charron. De la même manière la gravure
ci-dessous, extraite de l’Album Vendéen et intitulé Le Pont-Charron, laisse penser
qu’il s’agit du combat durant lequel est mort Sapinaud, mais sans l’affirmer
vraiment.

Amédée de Béjarry (II) dans son livre « Souvenirs
Vendéens » écrit:« … il se retourna vers l’autre pont, se portant en
toute hâte sur le lieu de l’attaque. Mais, ne sachant où était l’ennemi, il
envoya...quelques hommes, pour reconnaître le terrain. Ils n’avaient pas fait
deux cents pas qu’ils aperçurent, dans un pli de terrain, un corps républicain,
couché à plat ventre. Les éclaireurs firent volte-face et l’ennemi, se voyant
découvert, fit sur ces quelques hommes une décharge qui ne les atteignit
pas ; mais une balle alla frapper derrière eux le pauvre général, qu’ils
virent tomber et se débattre sans pouvoir le secourir. Sapinaud fut achevé à
coups de sabre par les cavaliers républicains ». N’oublions pas toutefois que
l’auteur n’est que le fils du témoin oculaire et qu’il écrit 91 ans après
l’évènement, en 1884.
De son côté le comte de La Boutetière écrit:
« …Cette nuit même, Sapinaud était sorti de Chantonnay avec une vingtaine
d’hommes pour faire une reconnaissance du côté du gué... Dans un chemin
encaissé, sinueux, les deux troupes se trouvèrent subitement face à face à une
demi-portée de fusil ; en un instant le feu de Républicains eut dispersé
le petit nombre de leurs ennemis. Sapinaud, qui marchait à la tête des siens,
était tombé mortellement frappé de plusieurs balles ». Ici aussi l’auteur
écrit beaucoup plus tard en 1868 et en faisant appel à différents souvenirs.
Notons également que d’autres historiens
confirment la fusillade mais la placent « vers les Gabardières ». En
outre, les traditions orales n’ont retenu que le sabrage et le décès à la ferme
du Gué (près de Pont-Charrault). Aussi, nous allons essayer de préciser le
parcours à l’aide d’un plan :
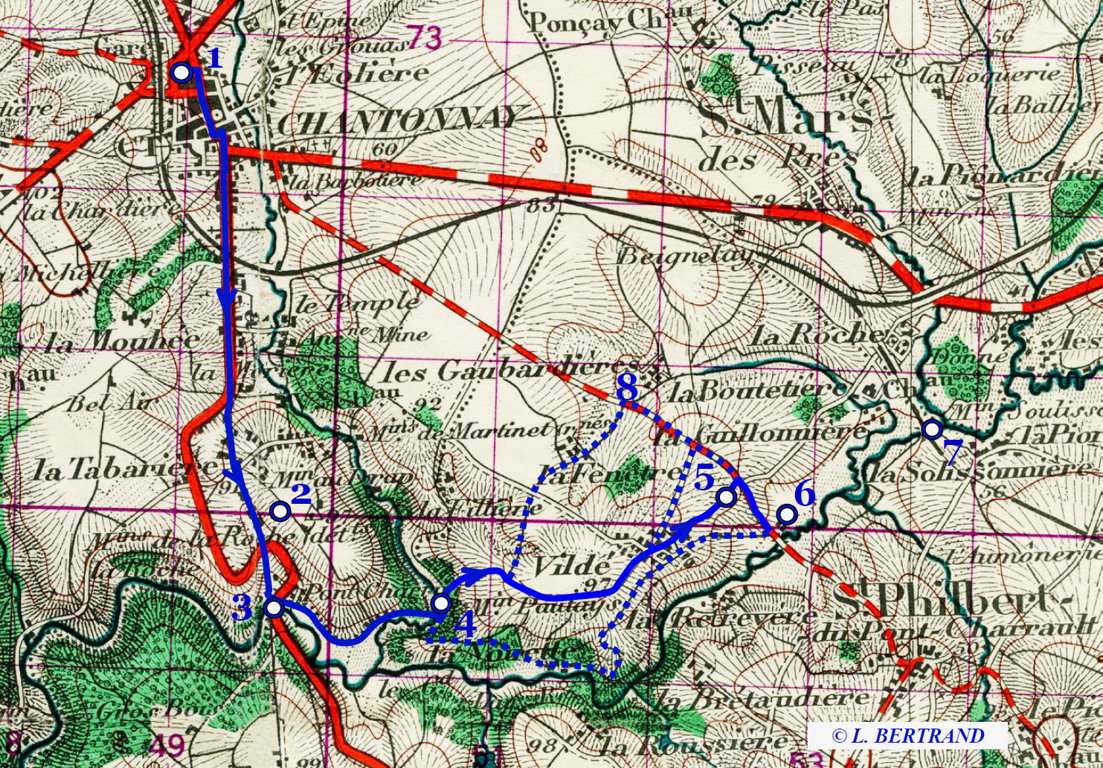
Nous savons donc avec certitude que Sapinaud,
partant de Ludernière à Chantonnay (1) a évidemment emprunté le cours royal par
la Tabarière pour se rendre tout d’abord au poste de garde de Pont-Charron (3).
Trouvant le secteur parfaitement calme il se dirigea ensuite directement vers
Pont-Charrault (en amont du Grand Lay). Pour cela, il n’avait d’autre solution
que de prendre le chemin de la ferme de Moinet et d’aller ensuite traverser la
rivière La Mozée au gué près de Pautay (4). A partir de là, il avait trois
possibilités :

1. Le chemin au nord :
Celui-ci aurait le mérite de passer effectivement à côté des Gabardières (8).
Cependant, on voit mal pourquoi il aurait pris ce chemin qui allait précisément
dans la direction opposée à celle de Pont-Charrault. Il faut sans doute prendre
le « vers les Gabardières » comme une large approximation ;
2. Le chemin au sud :
Celui-ci aurait le mérite d’aller directement à Pont-Charrault et au Gué mais
il s’agissait d’un très mauvais sentier particulièrement difficile. Or, la
rapidité était le principal objectif de la troupe vendéenne dans cette affaire
(à cheval) ;
3. Le chemin au centre : Il
s’agit là aujourd’hui du parcours le plus évident et le plus facile, surtout en
pleine nuit. Toutefois cette route actuelle a été aménagée à la fin du XIXème
siècle en privilégiant ce chemin parmi les autres conduisant auparavant à Vildé.
Il a en outre l’inconvénient d’être plus long.
4. Le chemin
intermédiaire : C’est en fait la route la plus ancienne qui, dans son
prolongement se dirige vers la Boutetière et Saint Mars-des-Prés. Il ne faut
pas oublier que les cavaliers avaient eu l’occasion de reconnaitre plusieurs
fois le terrain les jours précédents et qu’il faisait relativement clair cette
nuit là.
Par conséquent, nous avons la conviction que
Sapinaud et ses hommes seraient passés par le village de Vildé et le quatrième
chemin. De ce fait, la rencontre avec les soldats républicains et la fusillade
auraient eu lieu juste avant le croisement avec la route de Chantonnay à Saint
Philbert-du-Pont-Charrault, au bas de la côte (5). Et ainsi, Sapinaud aurait pu
effectivement être achevé à coups de sabre 200 mètres plus loin, à
la ferme du Gué à proximité du pont de Pont-Charrault (6).
En 1980, le Conseil Municipal a décidé de
donner le nom de « rue du général Sapinaud de la Verrie » à la route
qui conduit du Pont-Charrault à la place de l’église de Saint-Philbert.

NB. Les chiffres entre parenthèses renvoient
aux emplacements sur la carte ci-dessus.


Sur la première photo on aperçoit l’arrière
du calvaire dans le site de Pont-Charron. Le cours royal correspond à la voie
visible juste devant le calvaire et à celle qui monte au sommet de la colline à
gauche, les autres voieries sont des XIXème et XXème
siècles, de même que la carrière de pierre. La seconde photo représente la
cérémonie du bicentenaire le 5 septembre 1993 devant la croix. On y reconnaît
de gauche à droite : Emmanuel Cata Président du Souvenir Vendée, Dominique
Souchet, Philippe de Villiers Président du Conseil Général, Jacques marquis de
Lespinay (propriétaire du terrain), Michel Crucis Maire de Chantonnay et
Maurice Bedon Conseiller Général du canton.
Chantonnay le 12 mars 2016
Maurice
BEDON
 Photo d’Auguste de Chabot.
Photo d’Auguste de Chabot.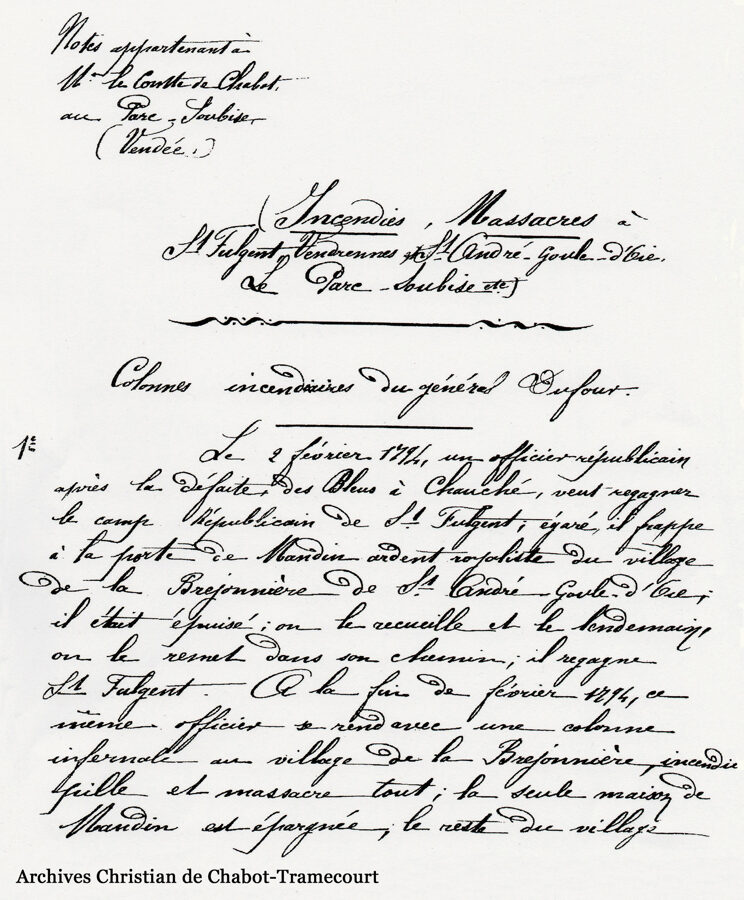 Texte original du comte de Chabot .
Texte original du comte de Chabot .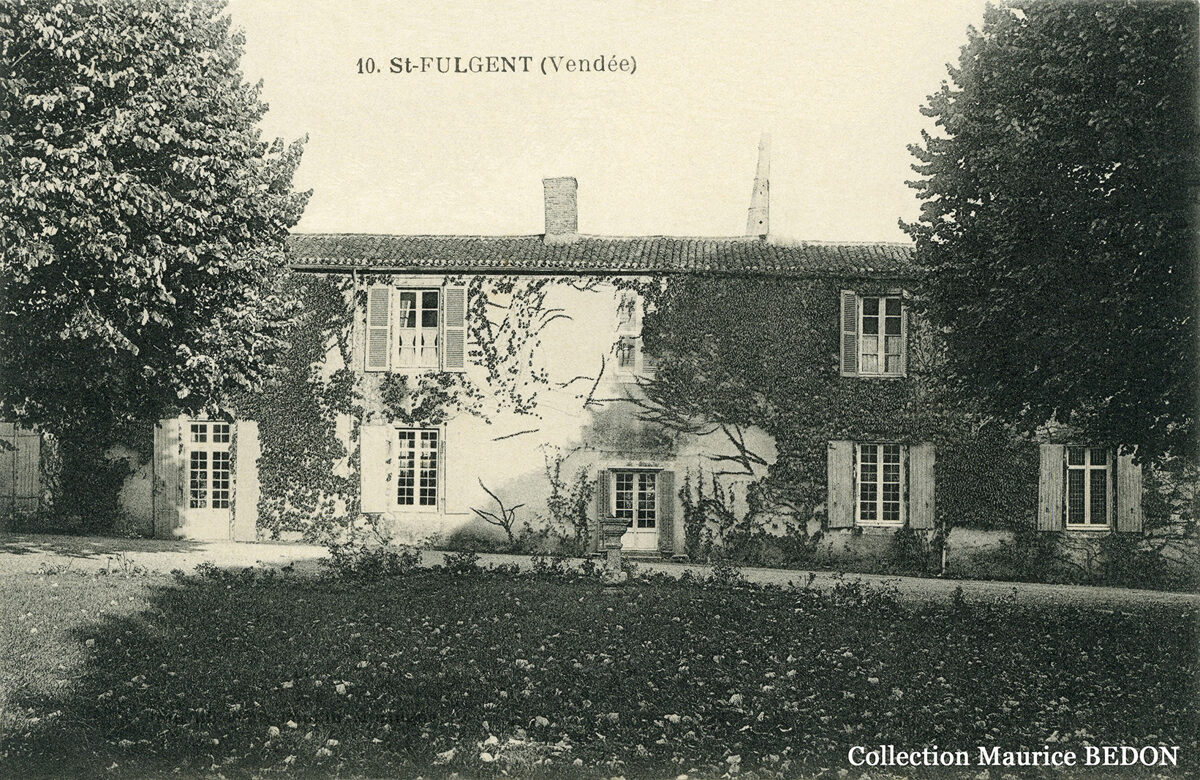 Le grand logis vers 1905.
Le grand logis vers 1905.

 Le bourg de Mouchamps vu du Petit Lay .
Le bourg de Mouchamps vu du Petit Lay . Le château du Parc Soubise.
Le château du Parc Soubise. La forêt du Parc Soubise .
La forêt du Parc Soubise .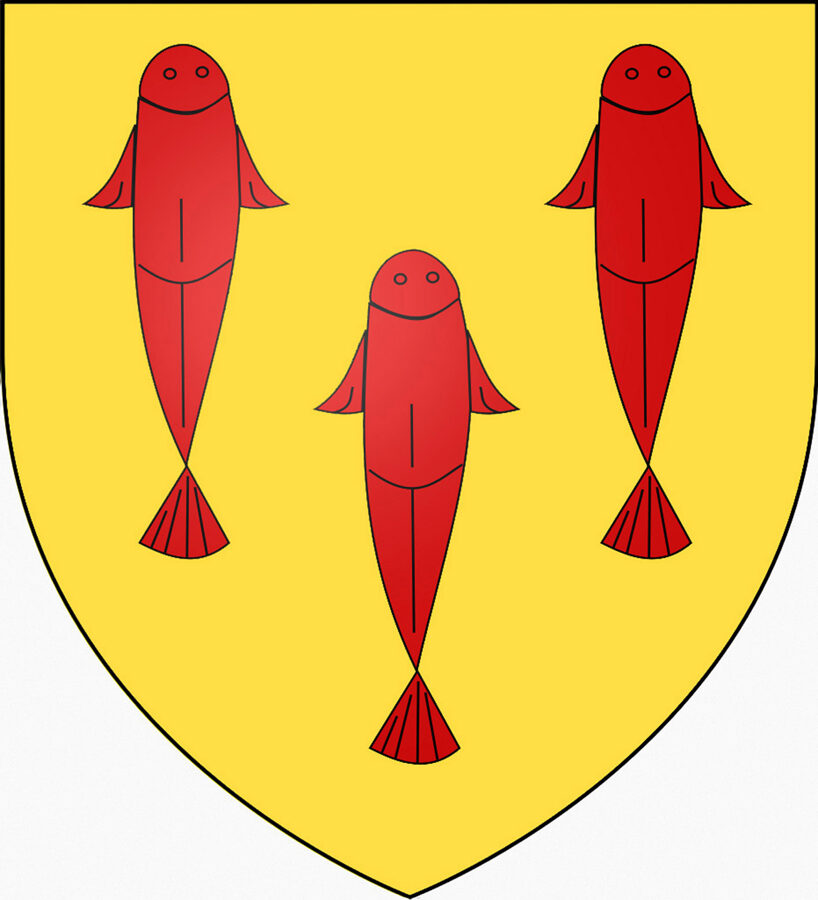 Les Armoiries de la famille de Chabot.
Les Armoiries de la famille de Chabot.
 Éditions La Chouette de Vendée
Éditions La Chouette de Vendée







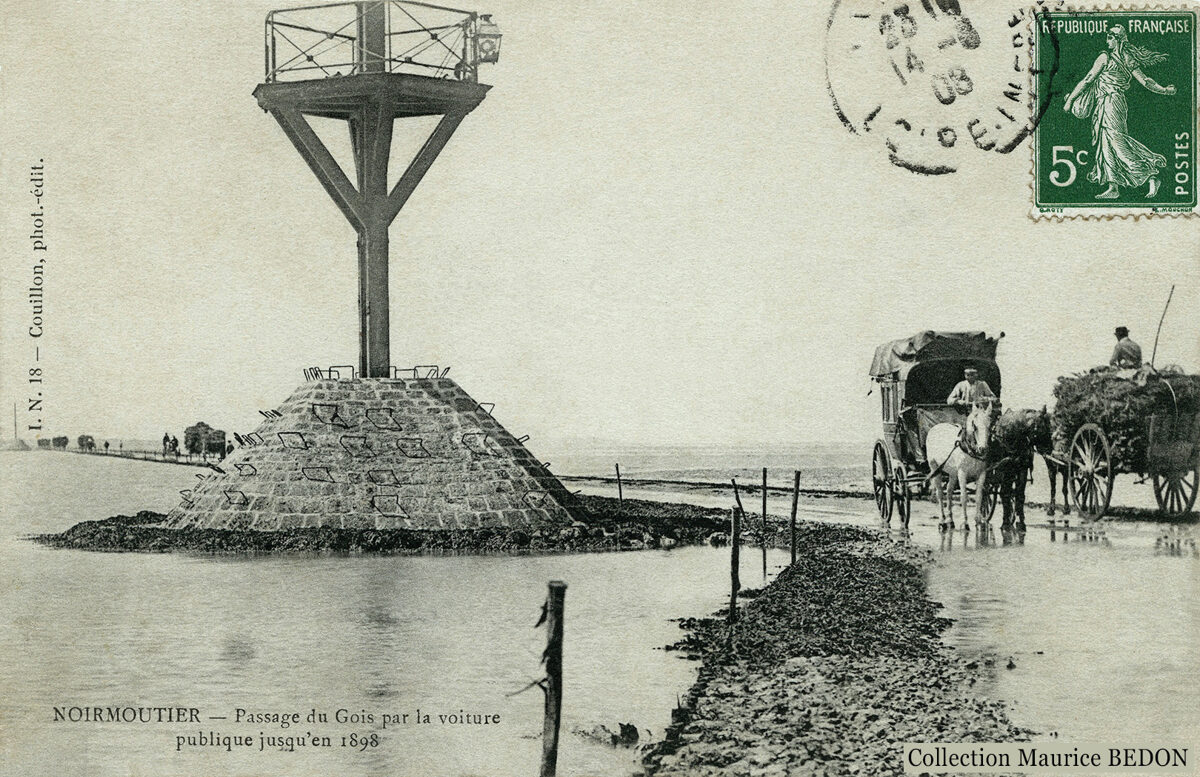


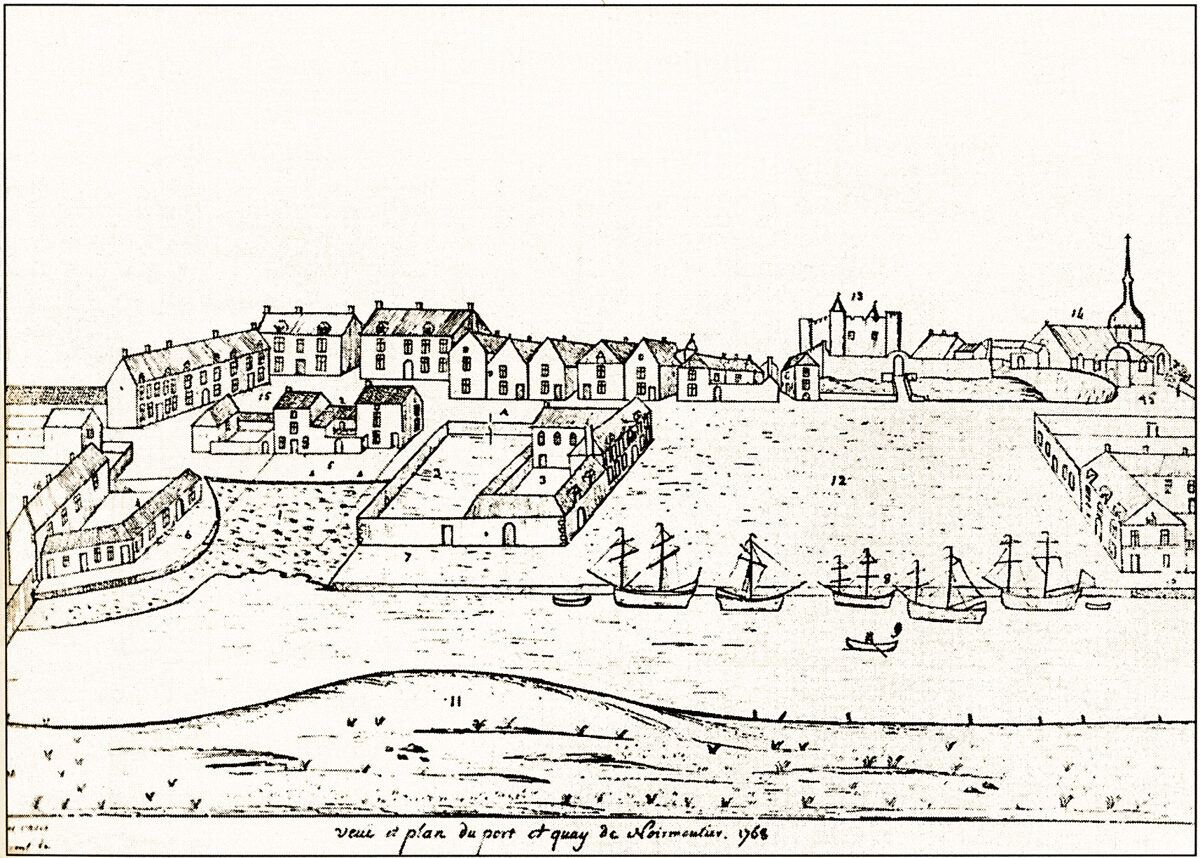






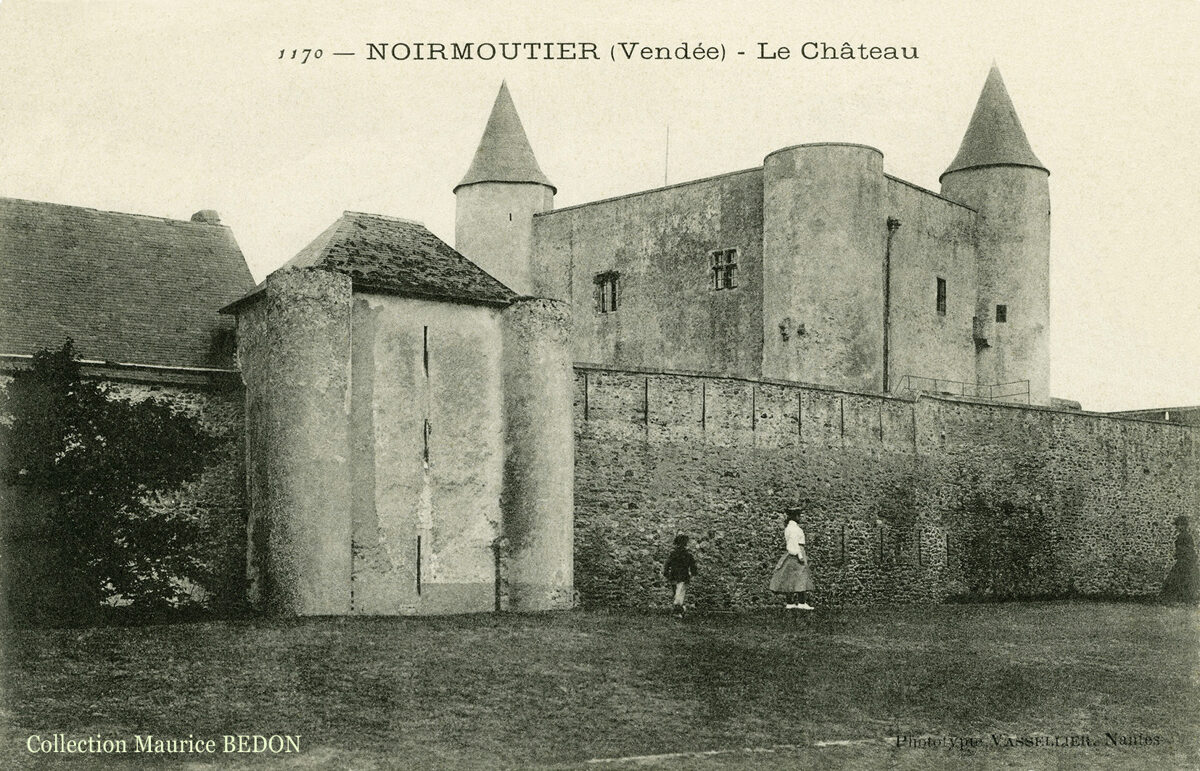





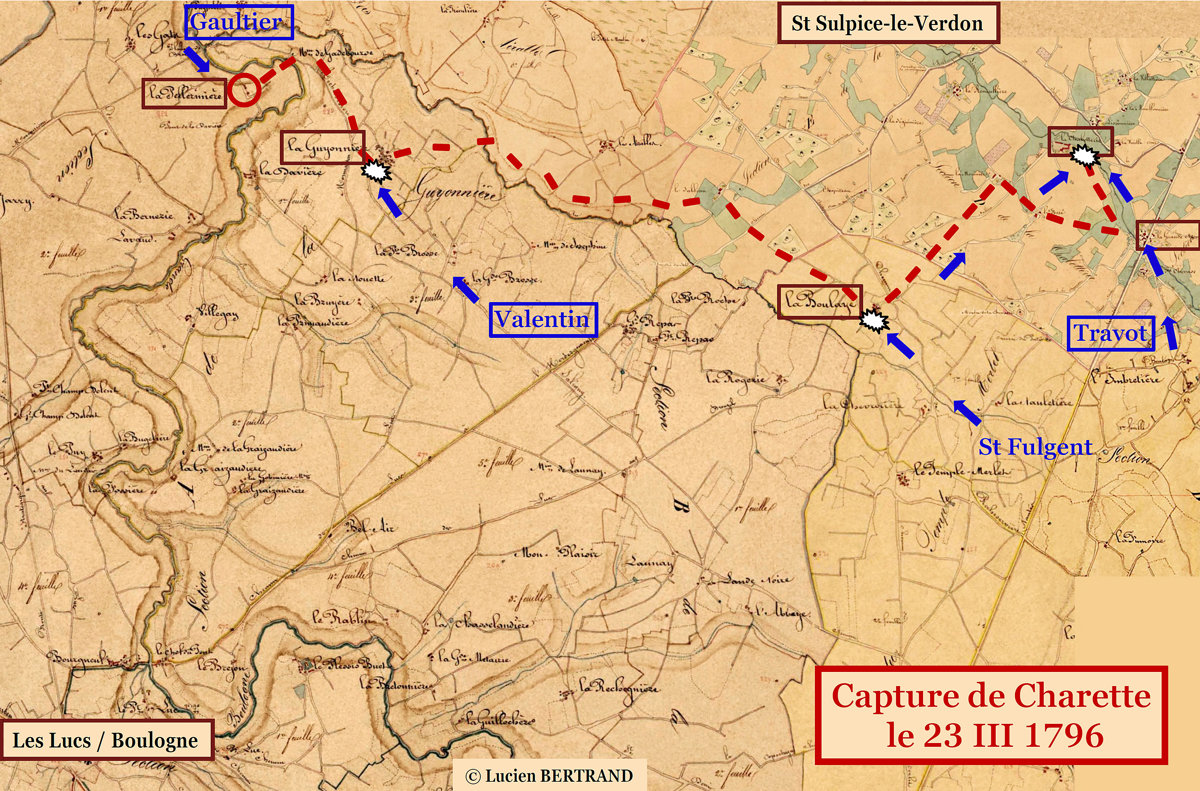



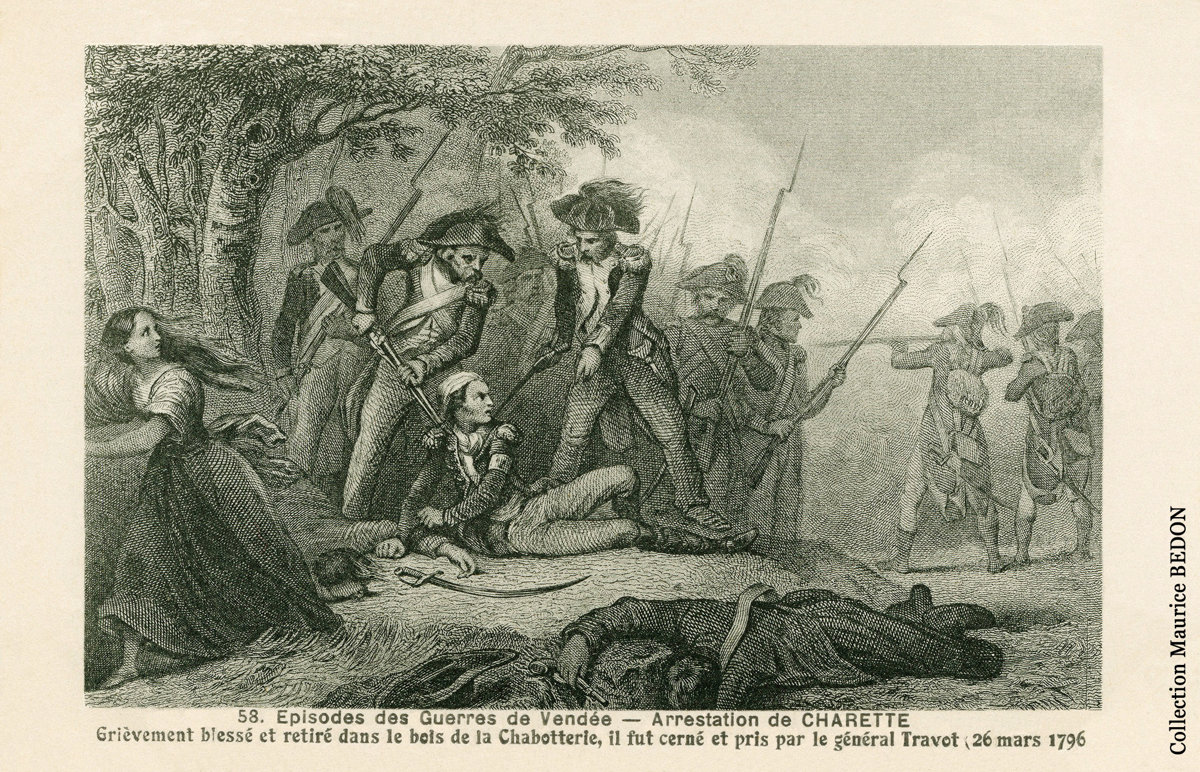




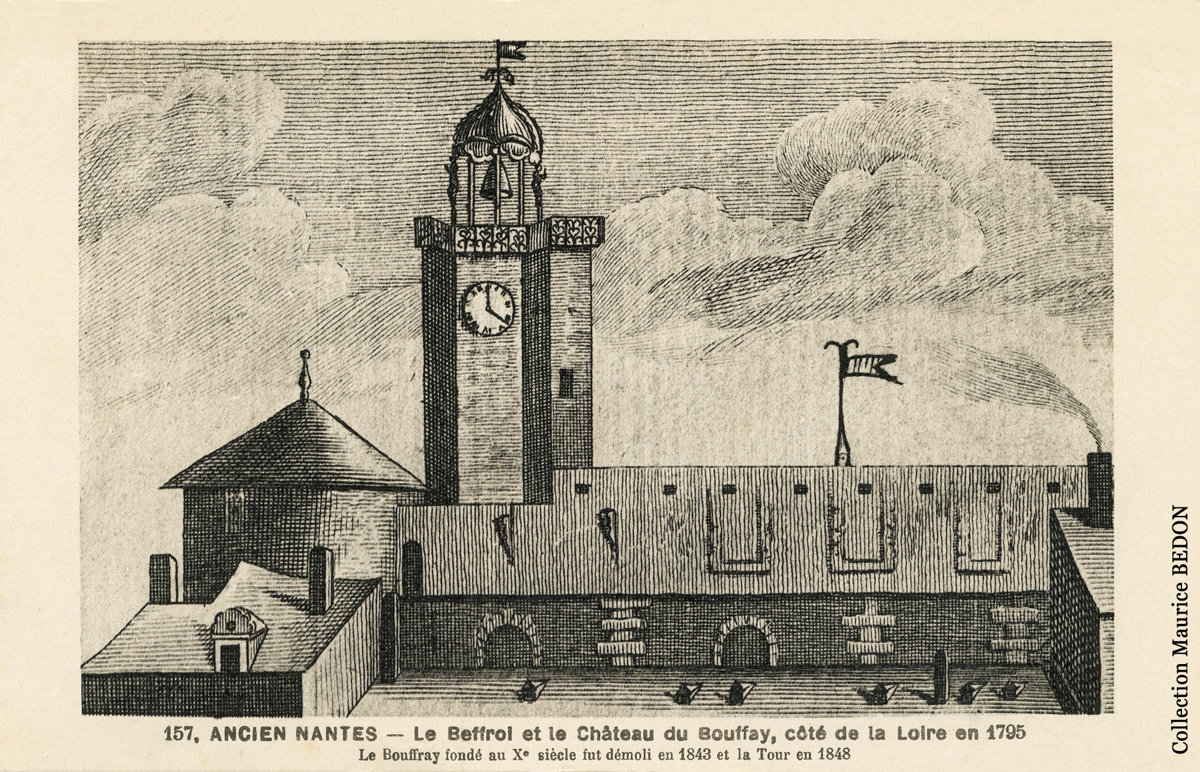





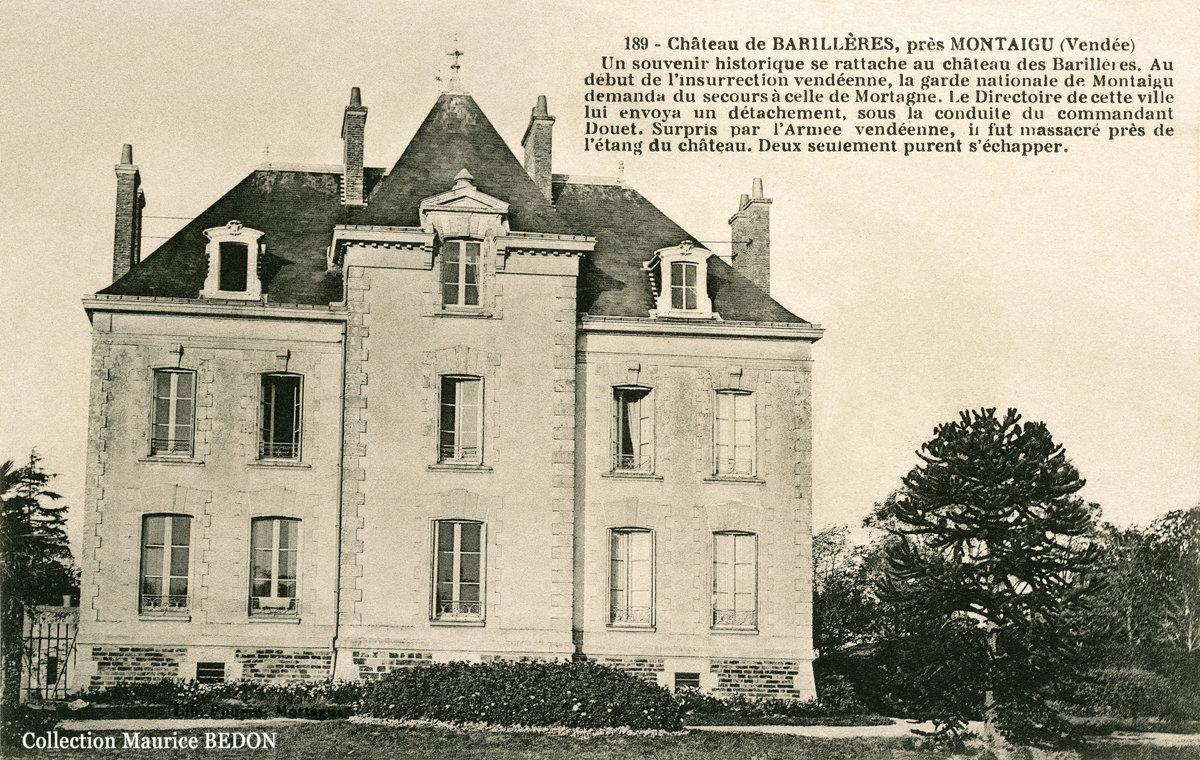
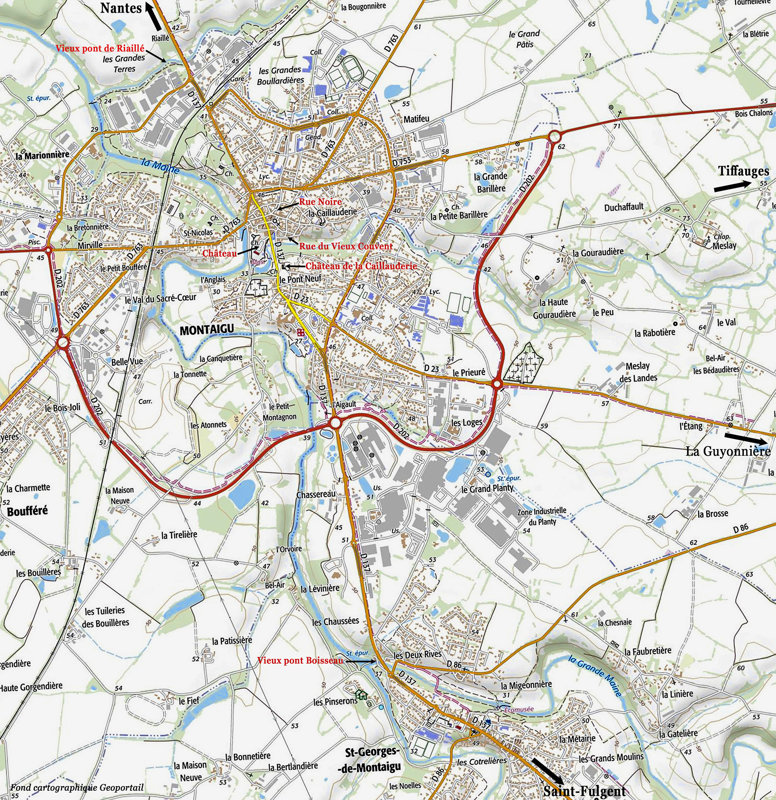 Montaigu et ses alentours.
Montaigu et ses alentours.
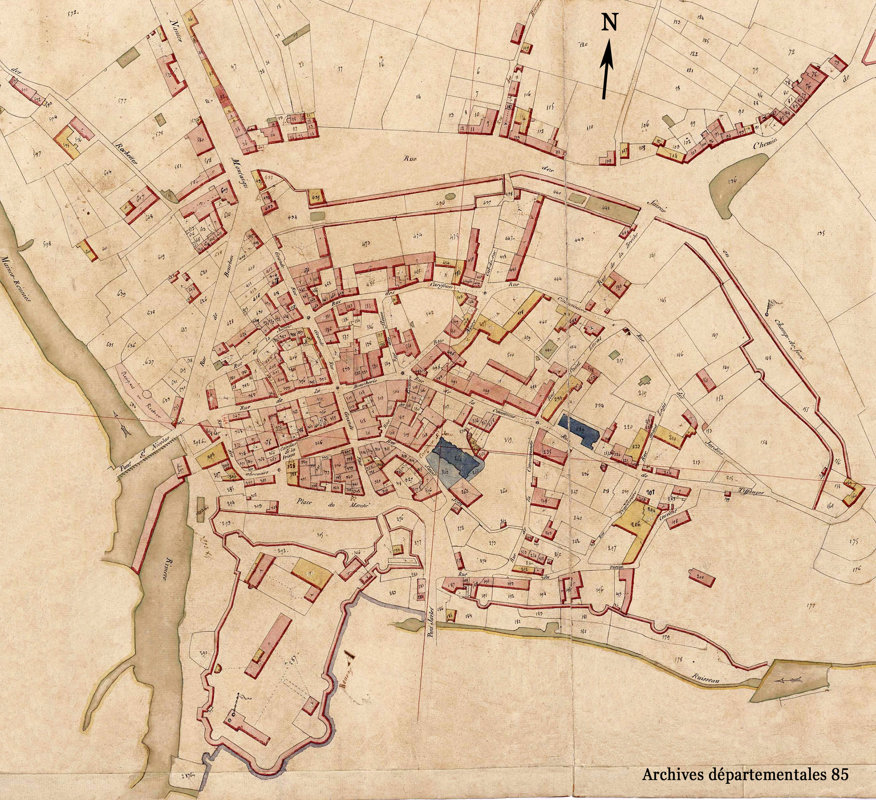
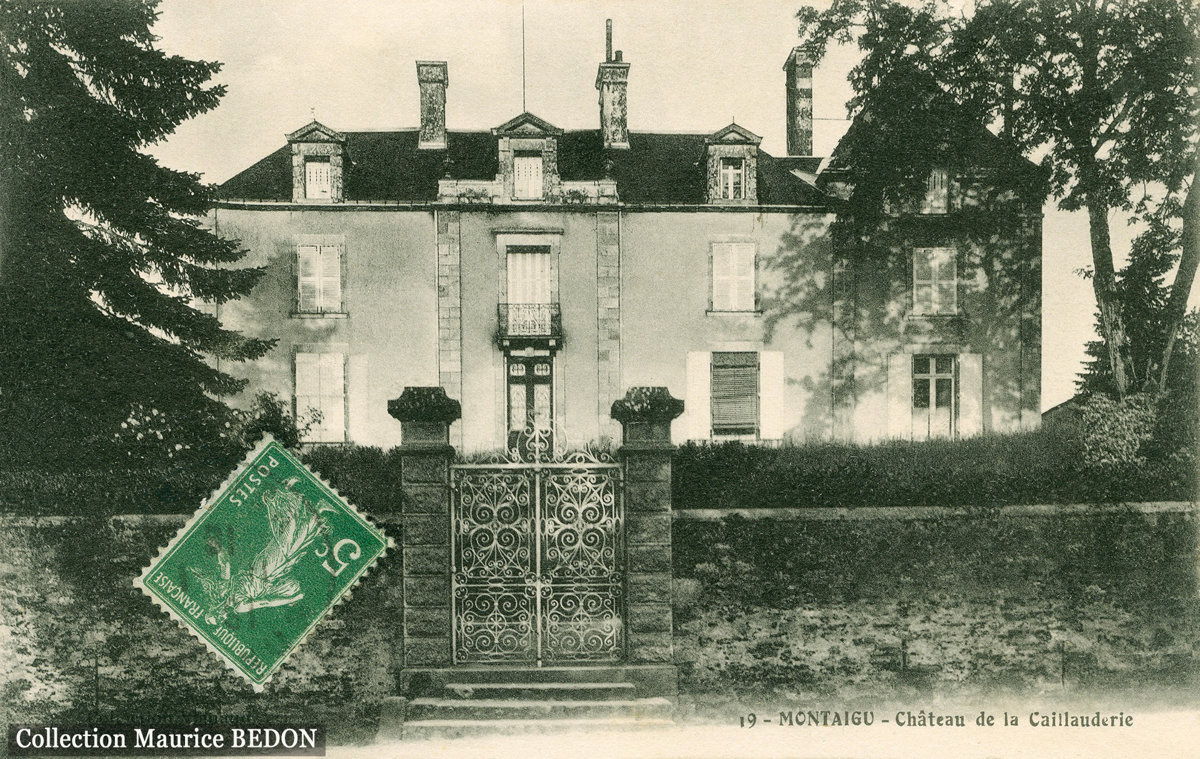
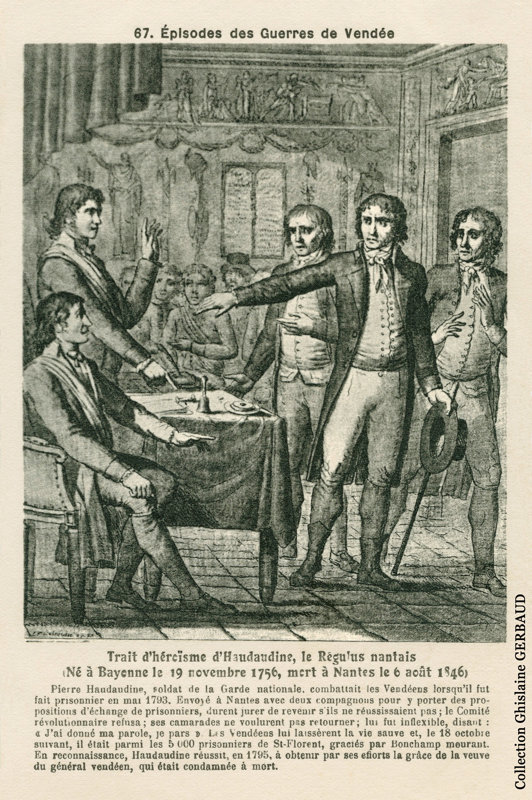





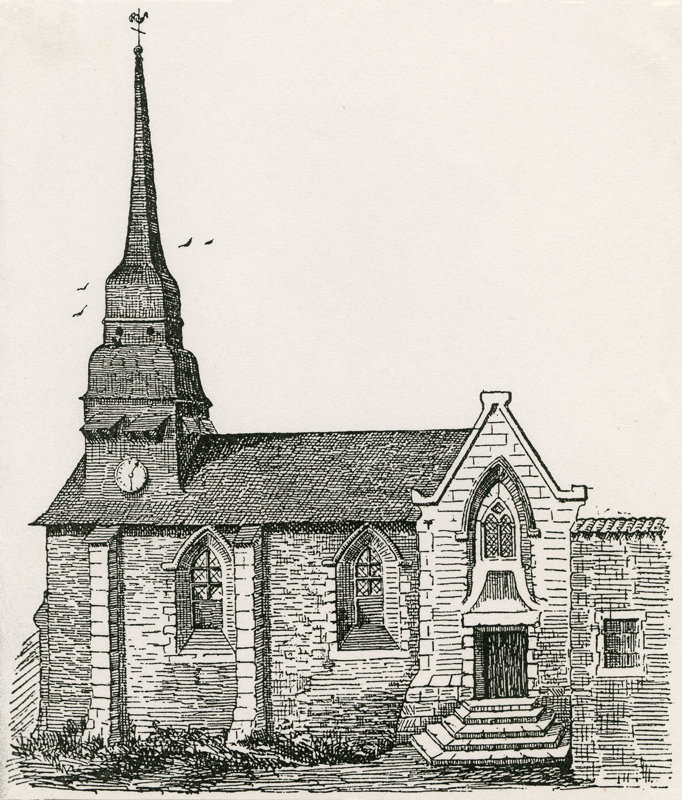












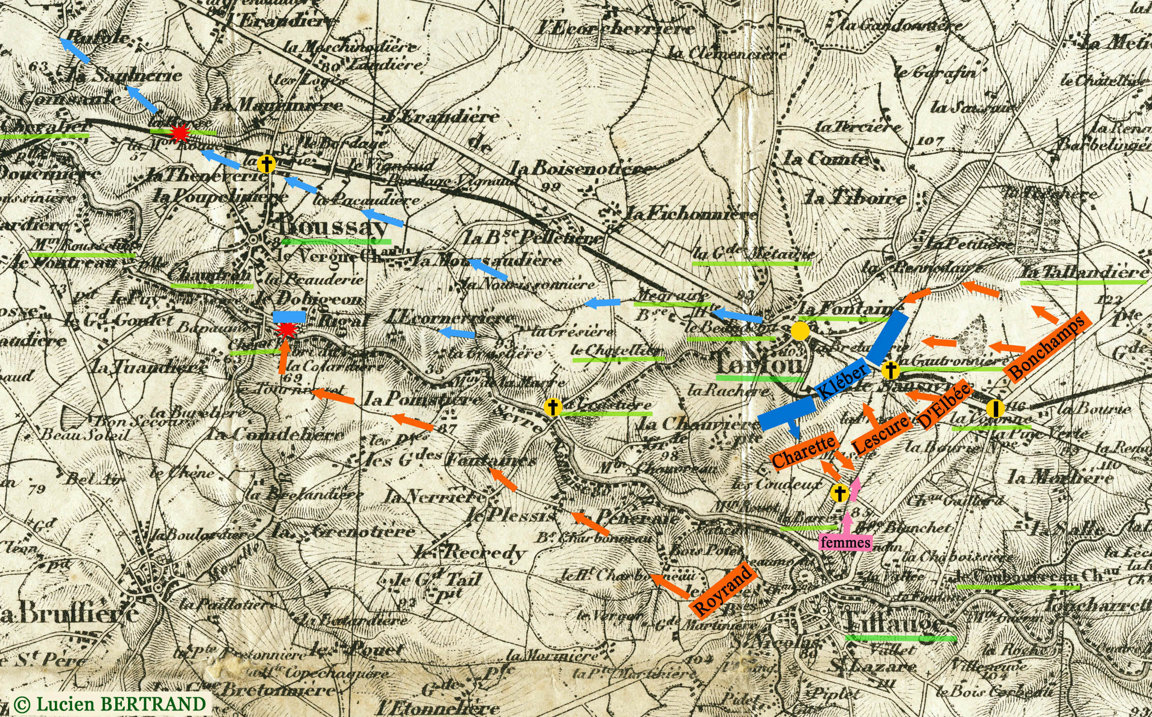










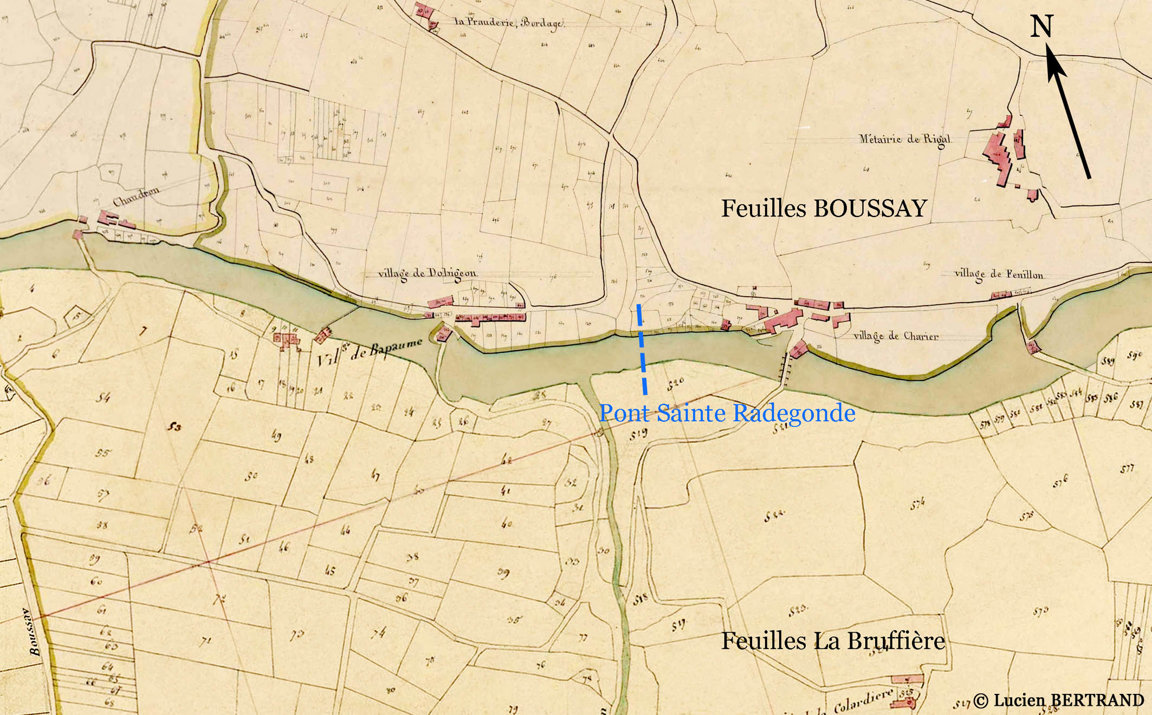

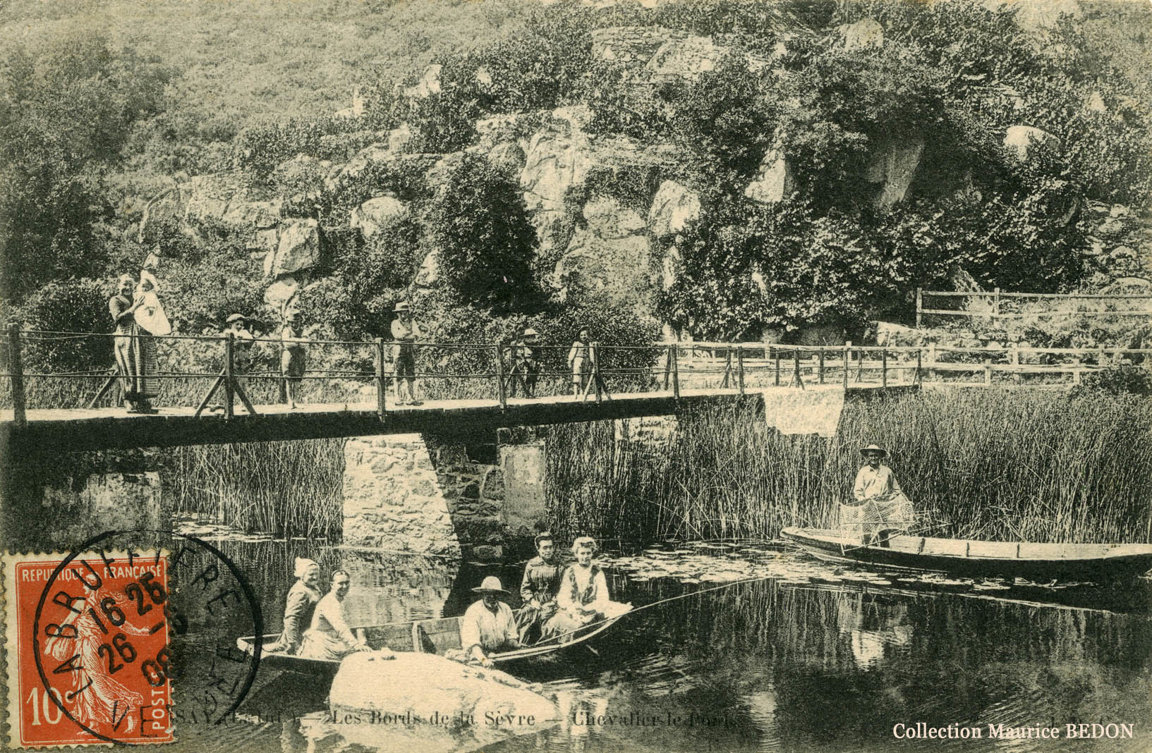

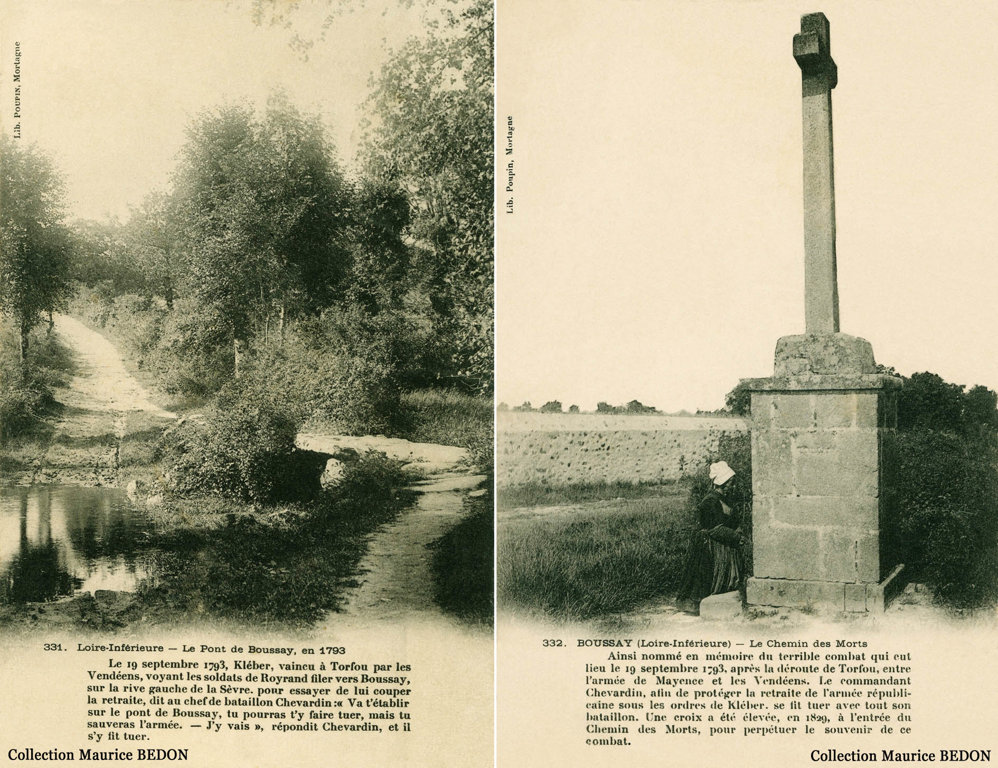
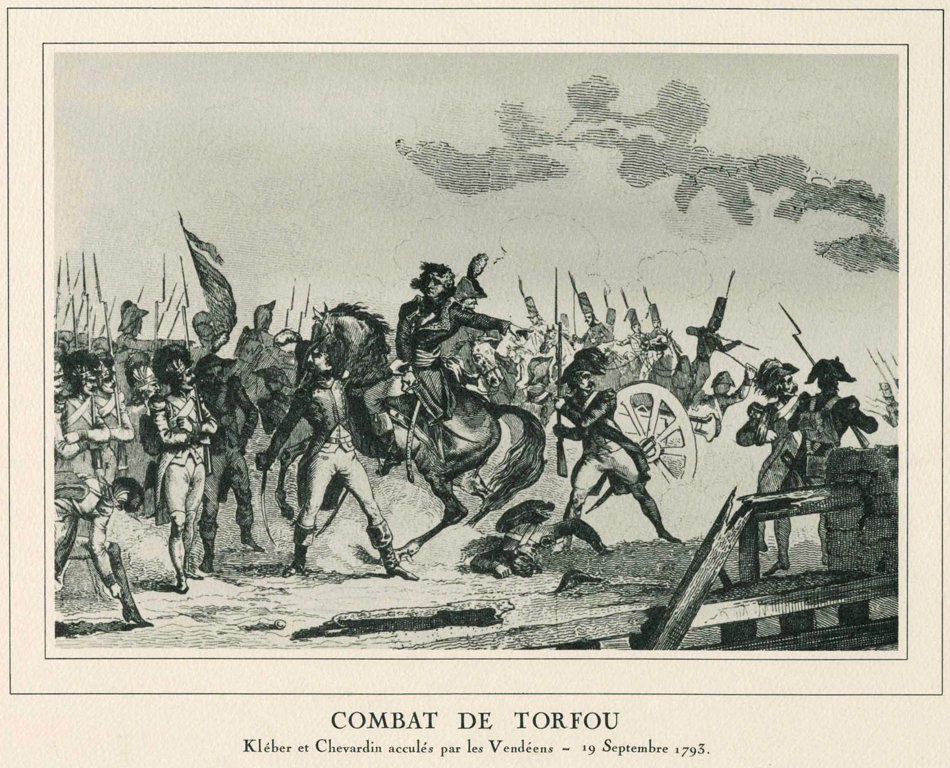




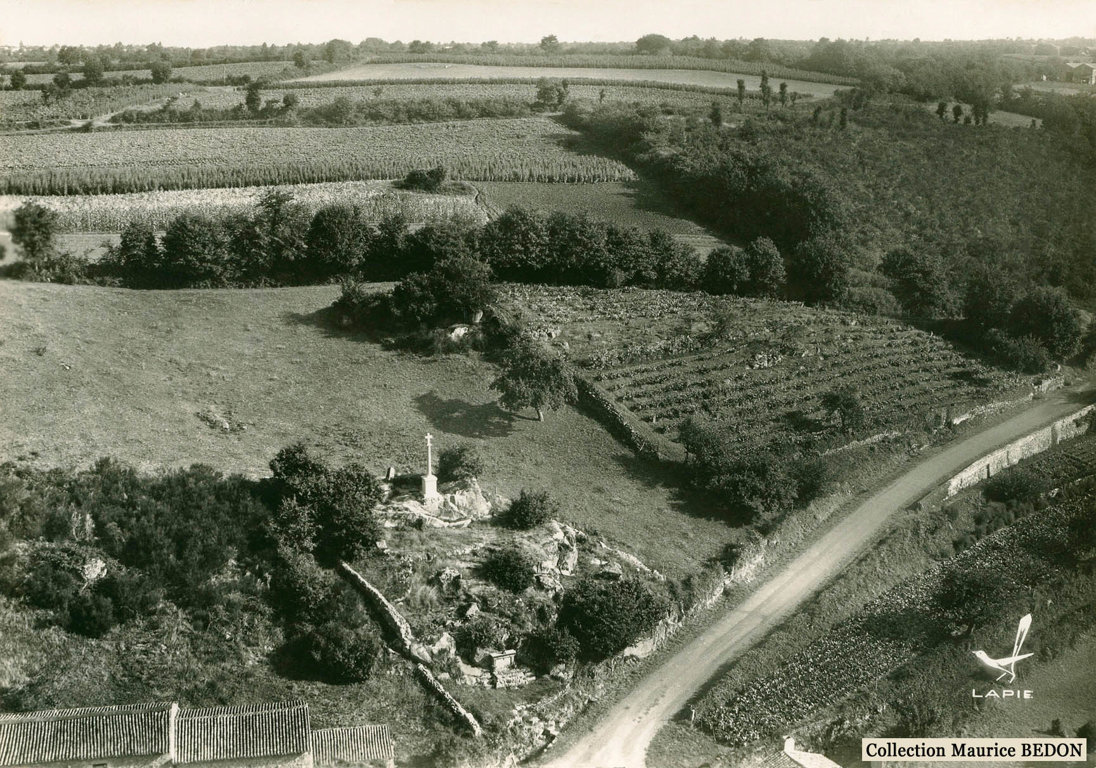


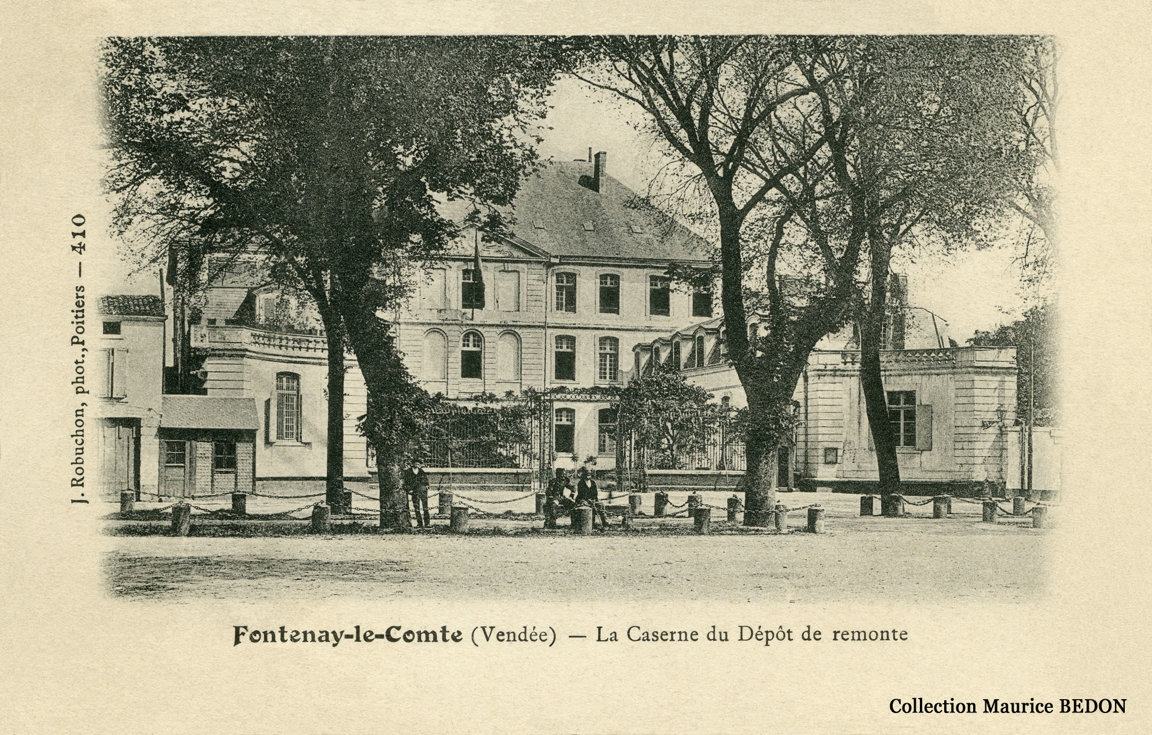
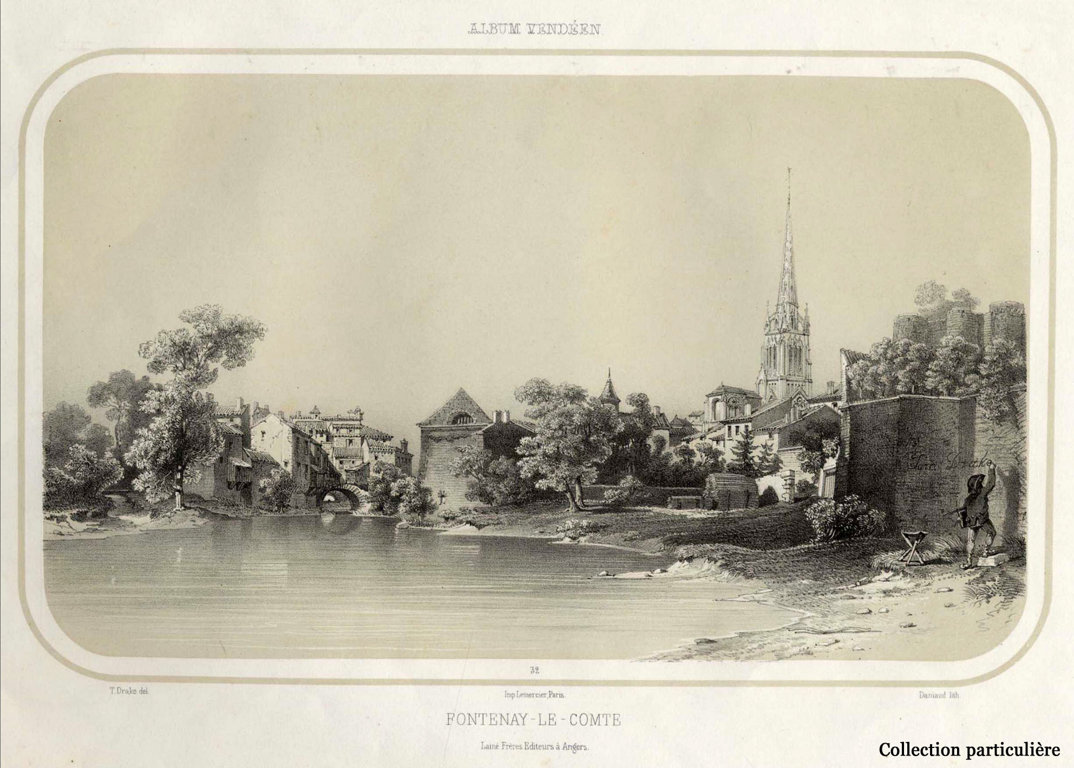
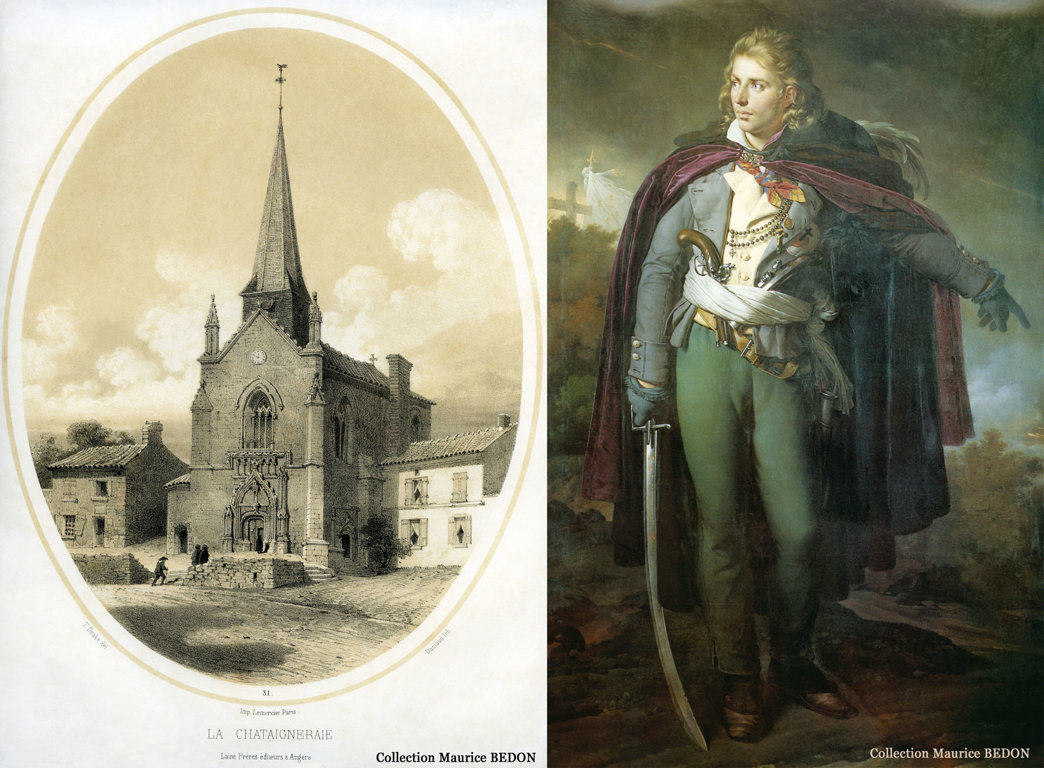





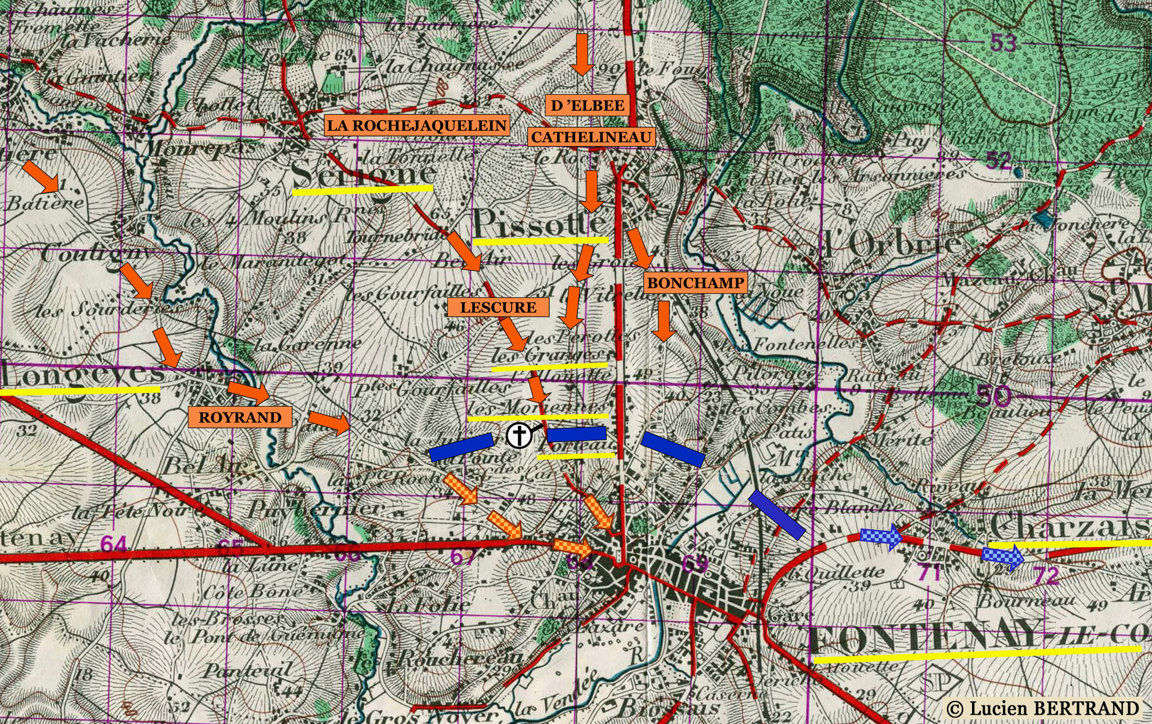


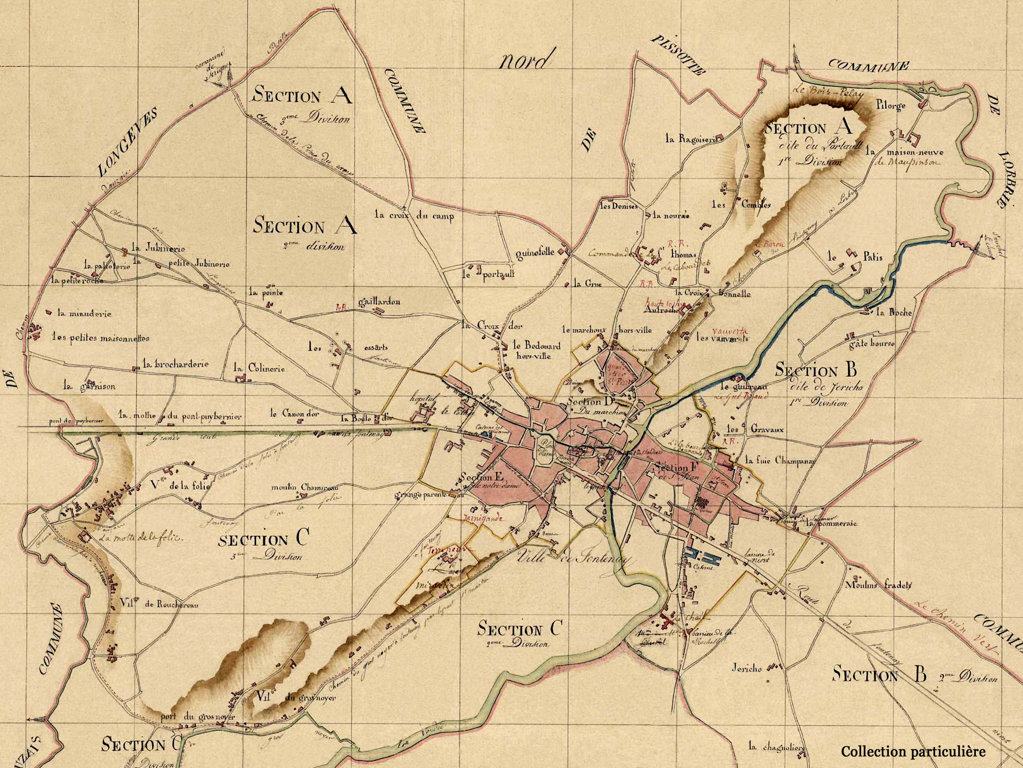

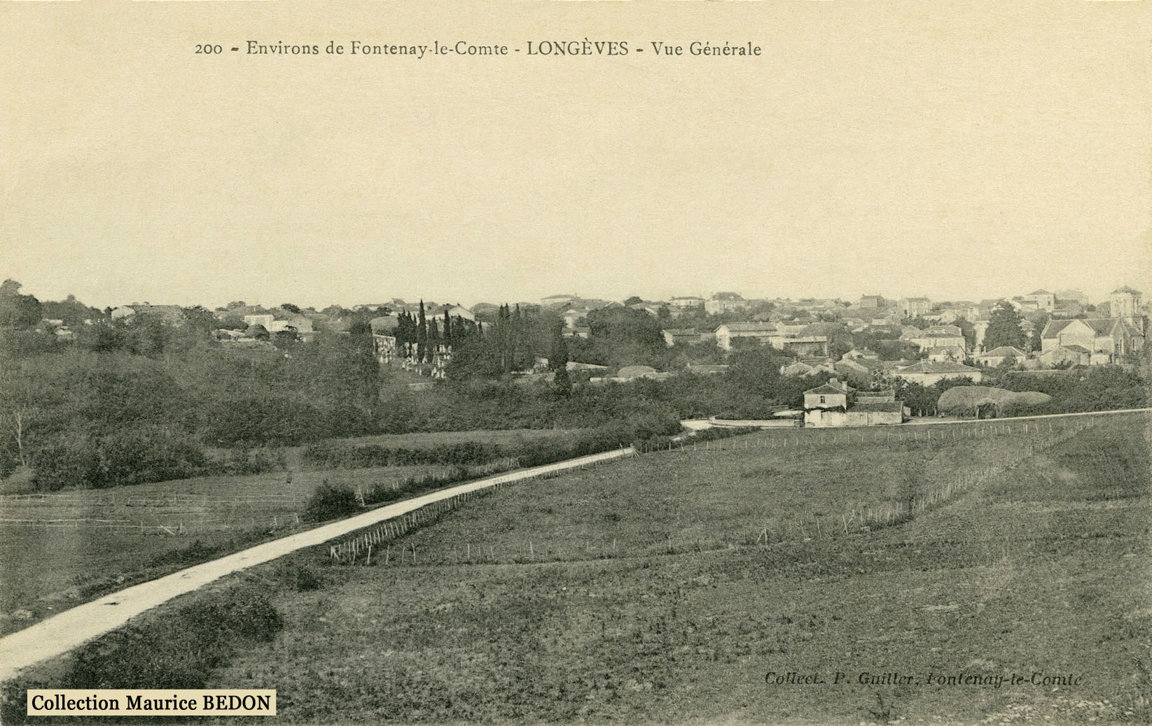

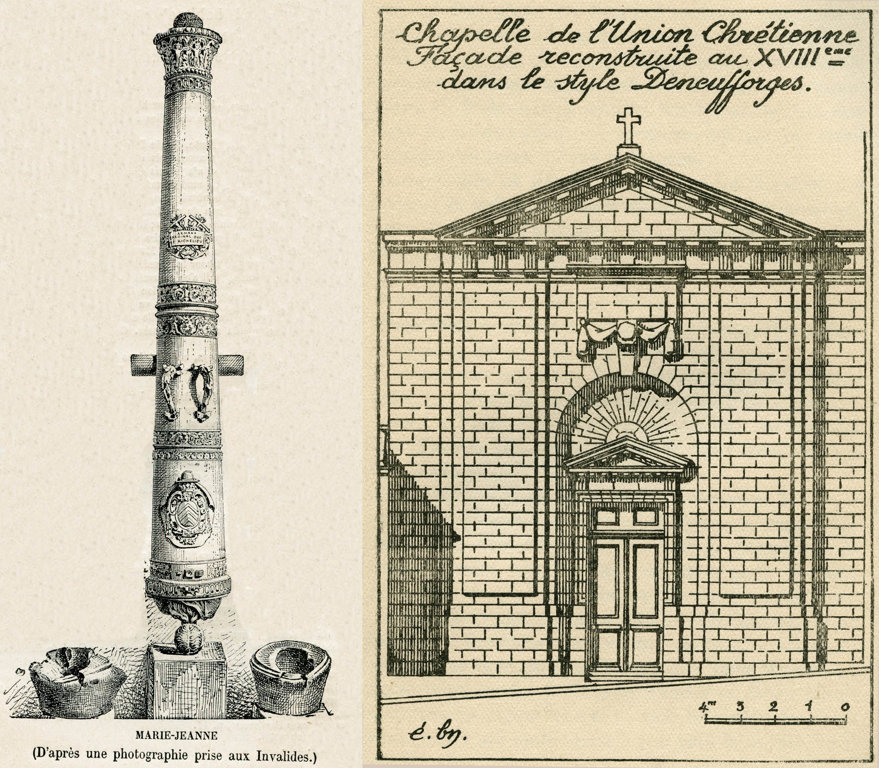


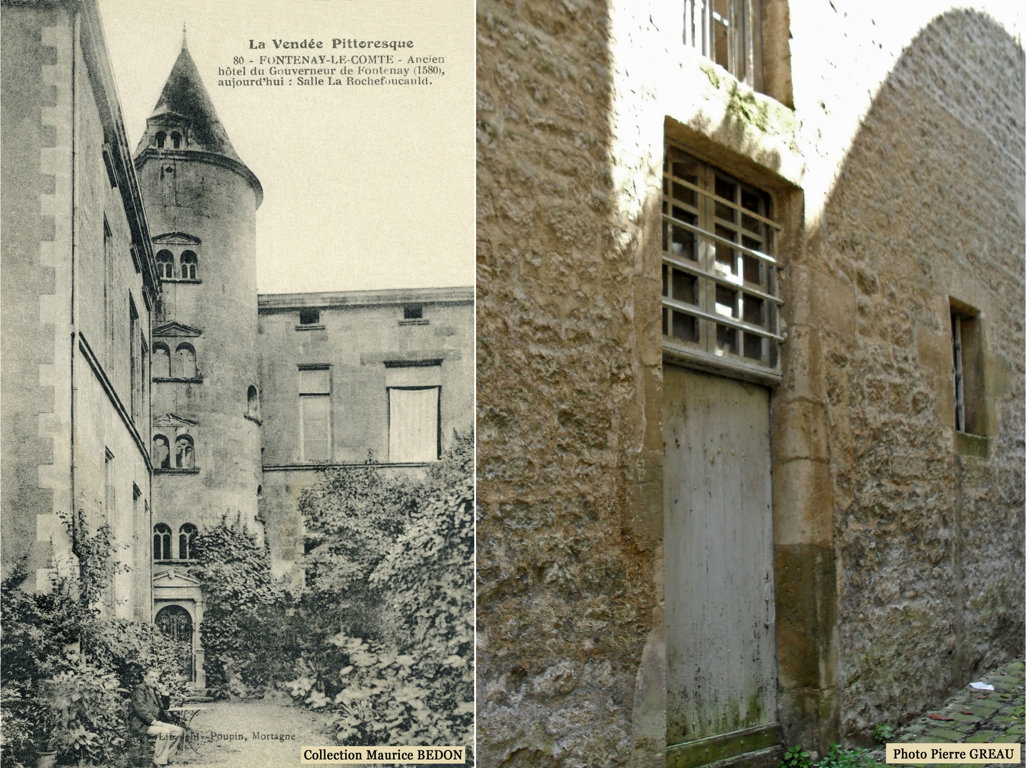

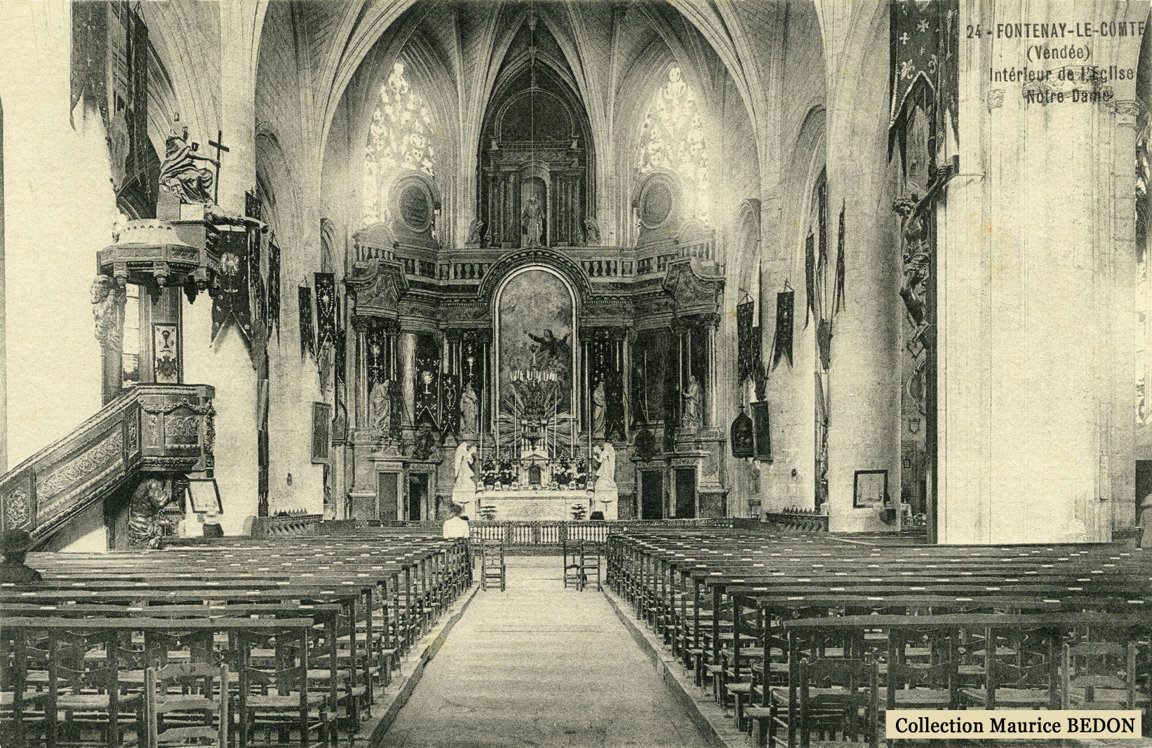



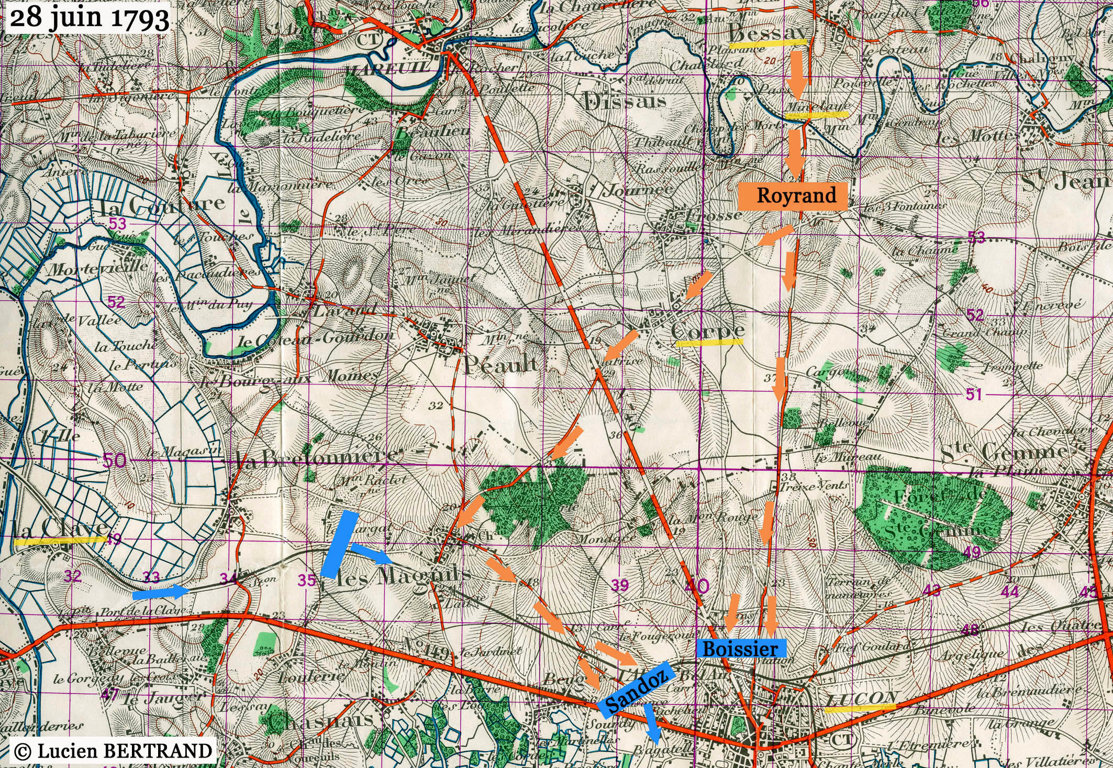




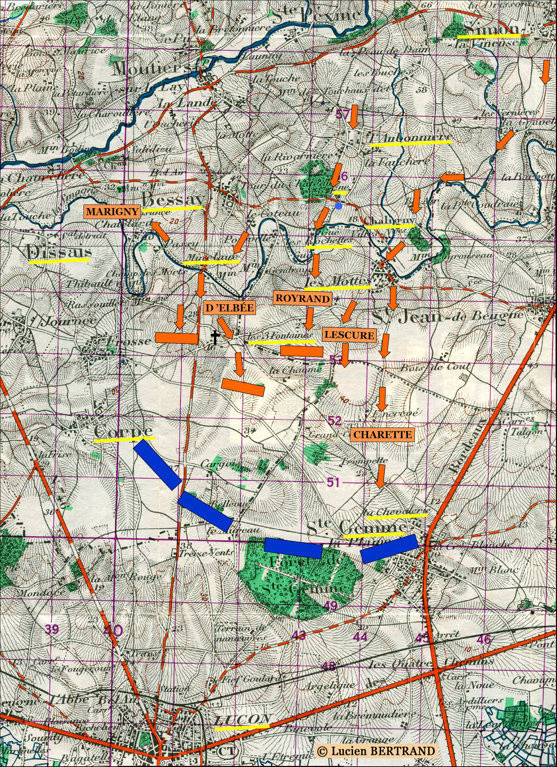

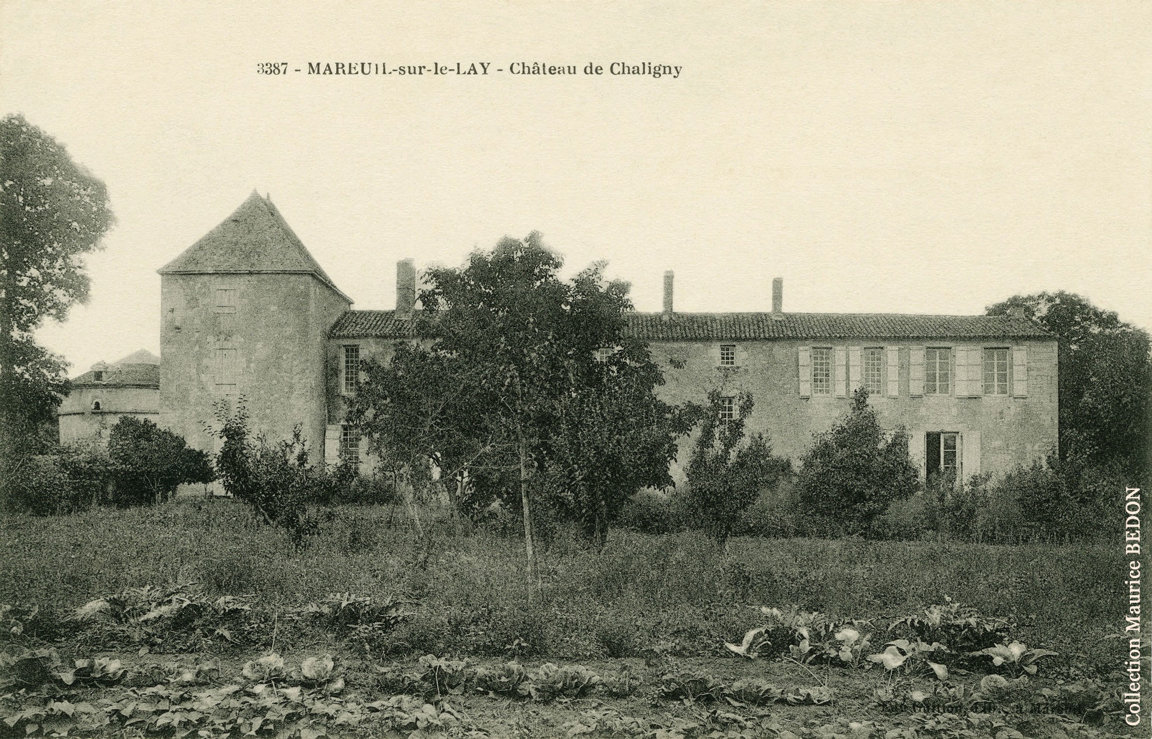




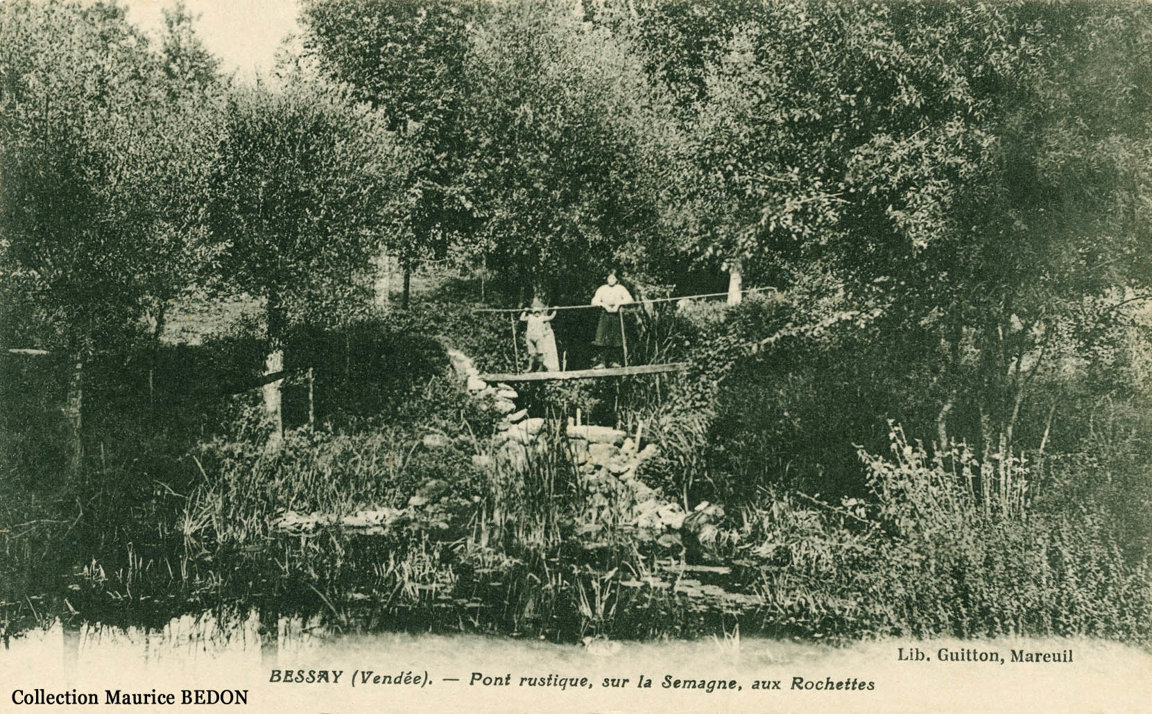








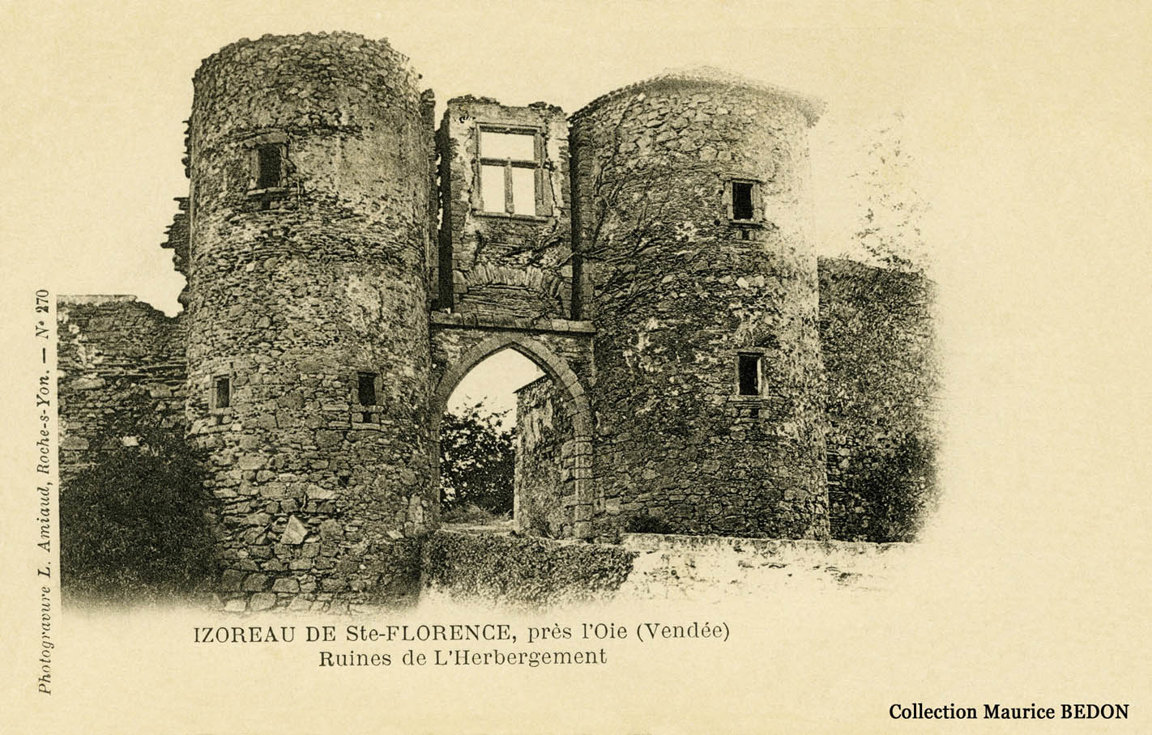





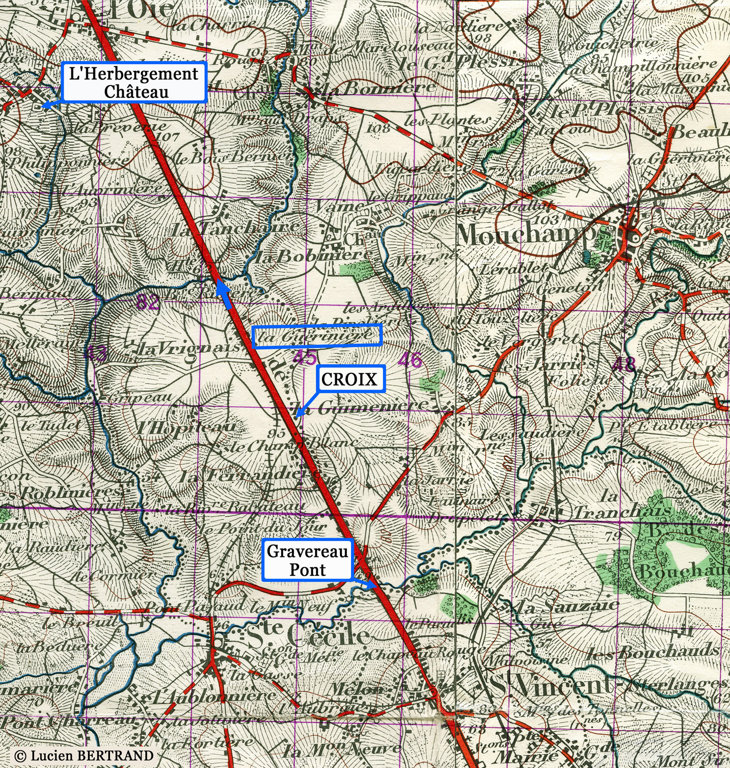

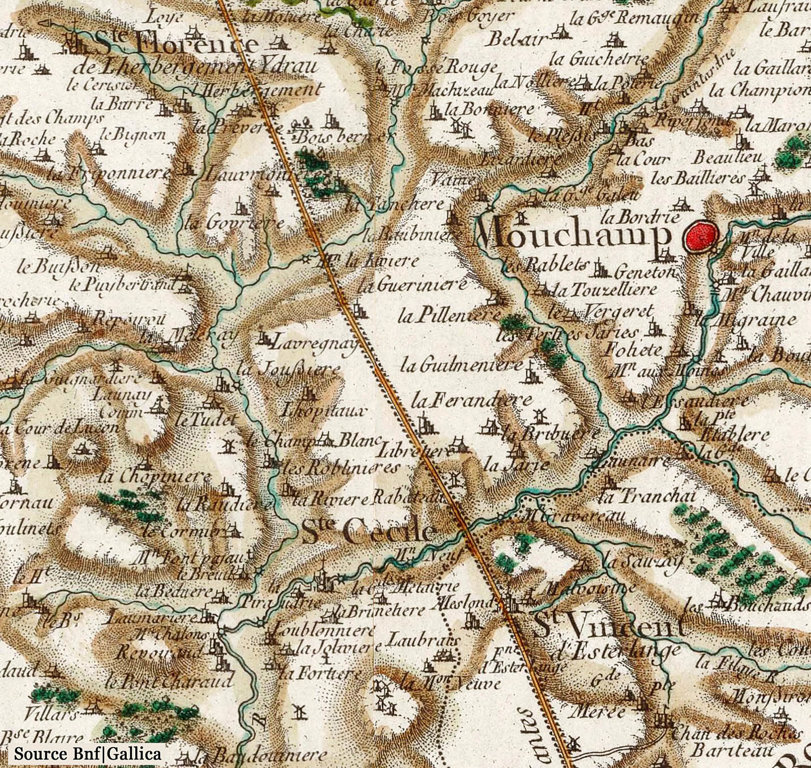





 Le site actuel de la Guérinière.
Le site actuel de la Guérinière.